
- •Содержание введение
- •Методические рекомендации
- •Изложение теоретического материала
- •1. Филология, лингвистика и семиотика
- •2. Лингвистика и ее составляющие. Место введения во французскую филологию среди других лингвистических дисциплин. Задачи курса
- •3. Системы различных знаков
- •Значение
- •4. Принципы структурирования языка
- •5. Некоторые общие положения лингвистики
- •6. Уровни языковой структуры. Единицы строя языка
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •2. Французский вокализм Классификация гласных
- •Основные особенности французского вокализма
- •3. Французский консонантизм
- •Классификация согласных
- •Основные особенности французских согласных
- •4. Явления речевой цепи
- •Изменения фонем
- •Чередование
- •Связывание и сцепление
- •5. Интонация
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •Тема 3 письменность: Графика и орфография
- •Изложение теоретического материала
- •1. Виды письма
- •2. Французская система письма
- •3. Графика и орфография
- •4. Типы графем во французском языке
- •5. Асимметрия французской графической системы
- •6. Графические принципы
- •7. Орфография и ее функции в языке
- •8. Принципы орфографии
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •2. Формальная характеристика
- •3. Функции пунктуации
- •4. Особенности французской пунктуации
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •Тема 5 Грамматика
- •Изложение теоретического материала
- •1. Виды грамматик
- •2. Теоретическая грамматика. Виды теоретических грамматик
- •3. Функциональный подход
- •4. Особенности грамматического строя французского языка
- •План содержания
- •План выражения
- •План функционирования
- •5. Грамматические категории частей речи
- •6. Синтаксис
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •Тема 6 Лексика
- •Изложение теоретического материала
- •1. Единицы языка и мышления
- •2. Язык, культура и концептуализация
- •3. Лексикология
- •Семасиология
- •Ономасиология
- •Асимметрия лексического знака
- •4. Особенности лексики французского языка1
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •Тема 7 Французский язык в современном мире
- •Изложение теоретического материала
- •1. Французский язык среди других языков мира
- •2. Формы существования и социальные функции языка
- •3. Три ареала и три этапа распространения романских языков
- •4. Зоны распространения французского языка
- •5. Французский язык как средство международного общения
- •6. Языковая ситуация во Франции
- •Литература
- •Вопросы, задания, упражнения
- •Ключи к тестам
- •Требования к экзамену
- •Экзаменационные вопросы
- •Краткая хрестоматия
- •Основные лингвистические термины, используемые в работе
- •Введение во французскую филологию
Ключи к тестам
№ 1: 1–в, 2–а, 3–а, 4–в, 5–б, 6–в, 7–а, 8–б, 9–б, 10–б.
№ 2: 1–б, 2–б, 3–а, 4–б, 5–а, 6–б, 7–б, 8–в, 9–в, 10–в.
№ 3: 1–б, 2–в, 3–б, 4–б, 5–б, 6–а, 7–в, 8–б, 9–в, 10–б.
№ 4: 1–а, 2–а, 3–б, 4–а, 5–а, 6–в, 7–б, 8–в, 9–б, 10–а.
№ 5: 1–а, 2–а2), 3–в, 4–а, 5–а, 6–в, 7–б, 8–б, 9–а, 10–г, 11–б, 12–в, 13–б, 14–б, 15–а, 16–а, 17–в, 18–в.
№ 6: 1–б, 2–б, 3–б, 4–б, 5–б, 6–а, 7–а, 8–б, 9–б, 10–а.
№ 7: 1–в, 2–б, 3–б, 4–а, 5–а, 6–а, 7–а, 8–б.
Требования к экзамену
Образовательный стандарт объединяет две дисциплины: «Введение во французскую филологию» и «Историю французского языка» в общий курс «История языка и введение в спецфилологию». Курс завершается итоговым экзаменом. Один из теоретических вопросов экзамена, носящий проблемный характер, относится к курсу «Введение во французскую филологию».
Ввиду широты проблематики экзаменуемый имеет возможность выделить наиболее важные и интересные с его точки зрения моменты, должен показать глубокое понимание материала, уметь реагировать на контраргументы и вопросы экзаменатора, быть готовым ответить на один-два дополнительных вопроса (по всему курсу), носящих прикладной, практический характер.
Экзаменационные вопросы
Филология, лингвистика и семиотика. Лингвистика и ее составляющие. Место введения во французскую филологию среди других лингвистических дисциплин. Задачи курса.
Системы различных знаков. Принципы структурирования языка.
Некоторые общие положения лингвистики. Уровни языковой структуры. Единицы строя языка.
Французский язык в современном мире. Три ареала и три этапа распространения романских языков. Зоны распространения французского языка.
Формы существования и социальные функции языка. Французский язык как средство международного общения. Варианты французского литературного языка.
Языковая ситуация во Франции. Французский язык и иностранные языки. Языковая политика и вопросы культуры речи.
Особенности и тенденции развития французских гласных и согласных.
Явления речевой цепи. Особенности французской интонации и ударения.
Французская графика.
Основы французской орфографии.
Французская пунктуация.
Особенности грамматического строя. Виды грамматик. Теоретическая грамматика. Виды теоретических грамматик. Функциональный подход.
Особенности грамматического строя французского языка. Грамматические категории частей речи. Синтаксис.
Французская лексика. Единицы языка и мышления. Язык, культура и концептуализация.
Лексикология. Особенности лексики французского языка.
Краткая хрестоматия
Распределение материала по темам
Тема 1. Общие положения: Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994 (Introduction : Une discipline et son objet).
Тема 2. Фонетика: Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993 (La transcription phonétique du Nouveau Petit Robert. Tendances dans l’évolution du système des sons. Choix de présentation de la phonétique).
Тема 3. Письменность: Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992 (Orthographe).
Тема 4. Пунктуация: Grevisse M., Le bon usage : grammaire française avec des remarques sur la langue française d’aujourd’hui (Emploi des signes de ponctuation et des signes typographiques).
Тема 5. Грамматика: Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994 (La grammaire dans tous ses états. L’analyse grammaticale).
Тема 6. Лексика: Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993 (Évolution du lexique. Le sens des mots).
Тема 7. Французский язык Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La
в современном мире: grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992 (Français. Registres de langue).
Delbecque N. (Éd.), Linguistique cognitive : comprendre comment fonctionne le langage, Bruxelles, De Boeck, Duculot, 2002 (La classification et l’étude comparée des langues).
Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994
Introduction
Une discipline et son objet
Les grammaires ont toujours été conçues comme une activité réflexive sur le fonctionnement et sur l’usage des langues. Une activité réflexive au double sens du terme : d’une part, le discours grammatical ordinaire se caractérise par sa réflexivité, puisque le langage y est l’instrument de sa propre description ; d’autre part, les descriptions grammaticales procèdent d’une réflexion méthodique sur l’architecture et le fonctionnement des langues.
Chacun connaît intuitivement sa langue et la pratique spontanément sans pour autant être capable d’en produire une description raisonnée. Or c’est précisément cette familiarité qui, à la faveur de l’ambiguïté de l’expression connaître une langue, nous cache souvent des données problématiques et nous empêche de poser les vraies questions. C’est un fait connu qu’un même objet est susceptible de plus d’une description, surtout s’il est complexe. Tout dépend du point de vue auquel on se place, car c’est lui qui détermine le choix des propriétés dites pertinentes. Un poisson, par exemple, ne présentera pas les mêmes caractéristiques saillantes pour un zoologiste, un cuisinier ou un pêcheur. Et comme à l’intérieur d’une même discipline les perspectives évoluent, se diversifient et parfois se concurrencent, c’est de ces choix initiaux que dépendent, en grammaire comme ailleurs, les problématiques, les méthodes d’analyse et l’évaluation de leurs résultats.
Les langues sont des moyens de communication intersubjectifs et ce que l’on appelle le langage n’est autre que la faculté, proprement humaine et liée à des aptitudes cognitives biologiquement déterminées, d’apprendre et d’utiliser les systèmes symboliques que sont les langues. L’usage actuel des deux termes, notamment sous l’influence de l’anglais (qui ne dispose que du seul terme language), est si flottant qu’on ne peut leur assigner que des définitions justifiées par des choix théoriques. L’option proprement linguistique en la matière a été clairement formulée par E. Benveniste [1966 : 19] :
« Le langage, faculté humaine, caractéristique universelle et immuable de l’homme, est autre chose que les langues toujours particulières et variables, en lesquelles il se réalise. C’est des langues que s’occupe le linguiste, et la linguistique est d’abord la théorie des langues. Mais [...] les problèmes infiniment divers des langues ont ceci de commun qu’à un certain degré de généralité ils mettent toujours en question le langage. »
En effet, dans la mesure où ils interfèrent avec l’objet de leurs propres investigations, le langage et les langues intéressent aussi les historiens, les sociologues, les ethnologues, les psychologues et les philosophes. Mais pour les linguistes, les langues en tant qu’outils de communication constituent un objet d’étude en soi : à partir de l’observation de leurs usages et de leurs productions, ils se proposent de les décrire comme des systèmes symboliques et communicatifs que l’on peut caractériser par la nature de leurs éléments et par les règles qui en régissent les combinaisons dans les énoncés.
Les linguistes francophones utilisent couramment, à l’instar de Saussure et de la tradition post-saussurienne, le terme de langue pour opposer la langue comme institution sociale et moyen de communication commun à ses usagers au discours qui recouvre toutes les réalisations individuelles résultant de l’utilisation de ce système.
Bibliographie. — M. Arrivé et alii, 1986, articles langage, langue et sémiotique – E. Genouvrier, J. Peytard, 1970, p. 89–93 – E.H. Lenneberg, Biological Foundations of Language, N.-York, J. Wiley & Sons, 1967 – J.-C. Milner, 1989, p. 40–45.
1.1. Les langues, instruments de communication
S’inspirant d’un modèle mathématique de la télécommunication, R. Jakobson [1963 : 213-214] définit l’« acte de communication verbale » à partir de six facteurs constitutifs :
– un destinateur (ou locuteur) et un destinataire (ou allocataire) disposant d’un code commun et qui échangent leurs rôles en cas de dialogue,
– un réfèrent à exprimer sous forme d’un message,
– un contact qui assure la transmission du message.
L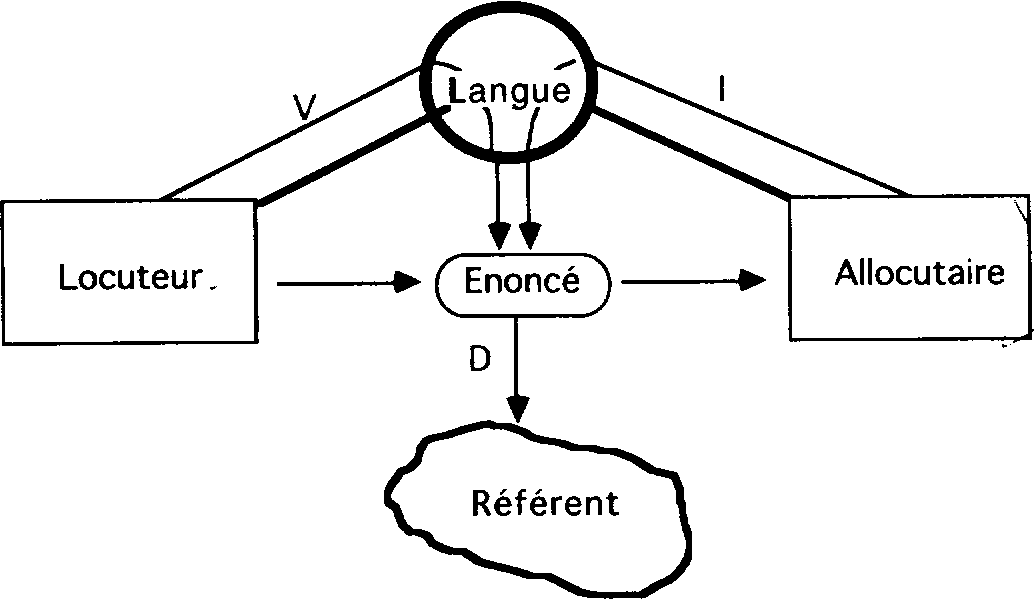 e
schéma suivant reformule l’analyse jakobsonienne en l’adaptant
aux spécificités de la communication langagière :
e
schéma suivant reformule l’analyse jakobsonienne en l’adaptant
aux spécificités de la communication langagière :
Dans ce schéma, V symbolise le processus de la verbalisation (production d’un énoncé), I celui de l’interprétation de l’énoncé et D le rapport référentiel qui unit l’énoncé à ce qu’il désigne et aux actes de langage qu’il sert à accomplir.
Les interlocuteurs utilisent le code commun qu’est la langue. Un contact, combinaison d’un canal physique et d’une connexion psychologique, permet au locuteur d’adresser des énoncés (messages) à l’allocutaire. La situation de communication comprend, outre les éléments précédents, le cadre spatio-temporel de l’acte de communication, les individus, objets et éléments qui le peuplent ainsi que les connaissances supposées partagées par les interlocuteurs.
Ce qui est transmis, c’est un énoncé : une forme linguistique signifiante dont l’interprétation requiert une double aptitude. L’allocutaire doit, bien sûr, connaître le sens codé des formes linguistiques simples et complexes (mots, groupes de mots, phrases et types de phrases). Mais il lui faut aussi procéder à des calculs (ou inférences) à partir de la signification proprement linguistique de l’énoncé et des connaissances qu’il estimera pertinentes pour aboutir à une interprétation plausible de cet énoncé dans la situation ou il lui a été adressé (XVIII : 3). Par exemple, pour reconnaître le réfèrent particulier, supposé univoquement identifiable, de la description définie (VI : 2.2.1) la directrice dans Je le dirai à la directrice et pour déterminer l’acte de langage accompli au moyen de cet énoncé (Est-ce une promesse ? un défi ? une menace ? ou un simple constat ?). La description de h communication verbale ordinaire ne peut donc se satisfaire d’un modèle sémantique d’encodage/décodage fondé sur une théorie classique du signe linguistique (XVIII : 1.1). Il faut lui adjoindre un modèle de l’activité inférentielle qui simule les calculs interprétatifs du sujet parlant (voir p. ex. VI : 5.1.2 et XIX : 3) à la manière de H.P. Grice [1975] et plus récemment de D. Sperber et D. Wilson [1989].
Instrument privilégié de la communication humaine, une langue se prête à de multiples usages. R. Jakobson [1963 : 213–221] distingue six « fonctions du langage », axées chacune sur un élément de son schéma de la communication. Trois de ces fonctions correspondent à l’idée communément admise que les langues servent d’abord à parler de tous les aspects de la réalité :
► La fonction référentielle (également dite cognitive ou dénotative) permet d’évoquer tout ce qui forme le contexte de la communication entendu comme l’univers infini des référents réels, possibles ou imaginaires : êtres, objets, propriétés, événements, etc.
► La fonction métalinguistique permet au locuteur de faire de sa langue ou d’une autre langue l’objet de son discours. Il s’agit en fait d’une forme particulière de la fonction référentielle, puisqu’elle consiste à se servir du langage pour discourir sur le langage (p. ex. pour demander ou donner des informations linguistiques, exposer une analyse grammaticale, etc.), voire sur son propre discours ou celui d’autrui.
Les termes substantif, complément, masculin, proposition subordonnée, etc., qui désignent des catégories de la grammaire française sont des termes proprement métalinguistiques. Il en va de même de tout discours oral ou écrit, scientifique ou didactique, sur une matière linguistique : les dictionnaires et les grammaires sont par définition des ouvrages métalinguistiques. Enfin toute séquence linguistique peut être utilisée de façon autonymique (XVIII : 1.1) pour se désigner elle-même (Je est un pronom).
► La fonction expressive (ou émotive) est un autre avatar de la fonction référentielle, limitée aux cas où le locuteur exprime directement son attitude à l’égard du contenu de son discours. Elle fait principalement appel à l’interjection, aux constructions exclamatives, à divers soulignements accentuels et également à certaines modalisations affectives ou évaluatives (XX : 2.2).
Les trois autres fonctions se réalisent chacune dans un type spécifique d’activité langagière intersubjective :
► La fonction injonctive (ou conative) vise à orienter le comportement du récepteur dans le sens indiqué par l’énoncé, notamment au moyen de l’impératif et des tournures directives équivalentes (XI : 4 et XX : 3). C’est le « Vous me le copierez cent fois » adressé à un élève indiscipliné, le « Sortez » de Roxane à Bajazet, mais aussi les slogans politiques et publicitaires dont la véritable finalité se résumerait dans les formules ouvertement incitatives : « Élisez-moi » / « Achetez-moi ».
► La fonction phatique, centrée sur le contact entre les interlocuteurs, apparaît dans les énoncés (souvent des formules) sans véritable portée référentielle, mais destinés à établir, maintenir, rompre ou rétablir le contact avec le récepteur : Bonjour – Au revoir – Alla ? – Comment allez-vous ? – Il faut que je me sauve, etc. Dans son emploi rhétorique, cette fonction nous permet de « parler de la pluie et du beau temps » lorsque, n’ayant rien à dire à notre interlocuteur, nous nous sentons néanmoins tenus de meubler ce vide communicatif.
► La fonction poétique, axée sur le message en tant que tel, transcende les catégories précédentes. Elle se manifeste chaque fois que le locuteur « travaille » son discours en exploitant :
• les virtualités évocatrices des signifiants (onomatopées, allitérations, assonances, rimes et effets rythmiques, voir I : 3–6) ;
• la disposition des mots et groupes de mots (parallélismes, antithèses, chiasmes, gradations, etc.) ;
• les affinités et les analogies entre signifiés pour produire des figures de contenu (hyperboles, métaphores, métonymies, etc.).
Remarques. — La subversion référentielle qui caractérise certaines formes de poésie moderne représente un cas limite où la fonction poétique occulte les autres fonctions. Cependant, si cette fonction se manifeste de façon privilégiée dans le domaine de la poésie, elle se rencontre aussi dans d’autres productions langagières chaque fois que le discours est surdéterminé par des effets esthétiques. C’est ainsi qu’elle sert à renforcer l’impact des fonctions incitative et affective dans les slogans publicitaires (L’eau, l’air, la vie – Perrier) et électoraux (Giscard à la barre – Mitterand Président, etc., sur le modèle archétypique américain : I like Ike).
Les six fonctions distinguées par Jakobson se manifestent rarement à l’état isolé. L’activité langagière les combine et les hiérarchise en des complexes que par commodité nous identifions souvent à leur fonction dominante :
Dans l’énoncé Vous ici ? ! on reconnaît la manifestation d’au moins trois des six fonctions : référentielle (il y a acte de référence à la présence de l’interlocuteur à l’endroit de renonciation), expressive (le locuteur exprime sa surprise par le tour a la fois interrogatif et exclamatif de son énoncé) et poétique (la cause de la surprise est en quelque sorte « mimée » par la forme elliptique de l’énoncé qui oppose antithétiquement la personne de l’interlocuteur (vous) et l’endroit où il se trouve (ici), le tout étant souligné par une allitération issue de la liaison). La fonction injonctive pourrait même venir se superposer aux précédentes, si le locuteur nuançait le ton de la surprise dans le sens de l’indignation ou du reproche, pour inviter – indirectement (XX : 3.3) – l’interlocuteur à vider les lieux.
La conjonction des six fonctions de Jakobson ne donne toutefois qu’une image partielle – et quelque peu disparate – de l’éventail des usages communicatifs du langage. Plus récemment on a choisi le terme d’acte de langage (XX : 3) pour désigner les différents types d’actes accomplis par le truchement du langage : ceux dits « de référence » quel que soit le type de réalité désigné (XIX : 3) ; ceux qui visent à orienter la conduite d’autrui (ordonner, conseiller, suggérer, etc.) ; ceux par lesquels le locuteur s’engage à accomplir une action future (promettre, jurer, etc.) ; ceux qui expriment le sentiment du locuteur à l’égard de l’état de choses qu’il évoque (s’excuser, féliciter, blâmer, déplorer, plaindre, etc.) ; ceux que le locuteur, s’il est revêtu de l’autorité adéquate, accomplit par le seul fait qu’il dit qu’il les accomplit : p. ex. Je déclare la séance ouverte – Je baptise ce bateau Liberté – Je vous déclare unis par les liens du mariage. La liste est loin d’être close et plusieurs typologies ont été proposées pour classer les actes de langage selon leurs visées communicatives (la nature de l’acte que le locuteur prétend accomplir) et les mécanismes, souvent complexes, censés expliquer l’interprétation des énoncés qui les véhiculent.
Bibliographie. — E. Benveniste, 1966, p. 258–266 et 267-276 – C. Kerbrat-Orecchfoni, 1980 – F. Recanati, 1979 et 1982, p. 267–276 – J. Searle, 1972.
1.2. Les langues, systèmes de signes
1.2.1. La double articulation du langage humain
Comme tout système signifiant utilisé à des fins communicatives, les langues sont organisées sur deux plans solidaires : celui des formes (ou signifiants) et celui des contenus (ou signifiés). Elles relèvent donc d’une théorie générale du signe transposée à leurs unités significatives de tout niveau (XVIII : 1). Elles se distinguent pourtant de la plupart des autres systèmes par la propriété d’être doublement articulées. En effet, nos énoncés sont des séquences continues de sons ou de lettres qui s’analysent successivement en deux types d’unités minimales :
► A un premier niveau, ils sont formés d’unités signifiantes minimales (c’est-à-dire qui ne se décomposent plus en unités signifiantes). Ainsi la suite phonique ou graphique Encore un demi, garçon ! s’articule en quatre de ces unités : encore, un, demi et garçon. Ces unités de première articulation sont généralement appelées morphèmes (XVII : 1.2.1) pour les distinguer des mots (XVII: 1.1), qui sont souvent des morphèmes (p. ex., l’adjectif juste), mais qui peuvent aussi être formés de deux ou de plusieurs morphèmes (p. ex., in-juste, in-juste-ment et anti-constitution(n)-elle-ment).
► A un second niveau, les morphèmes s’articulent en segments distinctifs minimaux appelés phonèmes (II : 2) ou graphèmes (III : 2.1) selon leur mode de réalisation (oral ou écrit). Dépourvues en elles-mêmes de signification, ces unités de deuxième articulation ont pour unique fonction de distinguer entre elles les unités signifiantes de première articulation.
Le mot garçon (prononcé [gaYsT]), par exemple, est une combinaison particulière de cinq phonèmes/graphèmes qui, comme telle, distingue ce mot des autres mots français : elle s’oppose en tous points à celle qui articule le mot tulipe, mais ne se distingue que par son avant-dernier élément, ç ([s]), de celle qui articule le mot gardon.
Remarques. — 1. Le principe de la double articulation fait des langues humaines des systèmes de communication qui allient richesse et économie. En effet, à partir d’un stock limité d’unités de deuxième articulation (entre une vingtaine et une cinquantaine pour la plupart des langues), elles ont formé des milliers d’unités de première articulation et en créent chaque jour d’autres pour répondre à de nouveaux besoins de dénomination. A leur tour, ces unités signifiantes se combinent entre elles selon les règles de la syntaxe pour former un nombre théoriquement infini d’énoncés. 2. Contrairement aux écritures alphabétiques dont les graphèmes transcrivent plus ou moins fidèlement les unités de deuxième articulation, les écritures idéographiques associent directement aux unités de première (et unique) articulation des « signes-mots » globaux dont la structure est indépendante de leur articulation en phonèmes (III : 1).
Bibliographie. — A. Arnauld, C. Lancelot, 1660, p. 22 – A. Martinet, 1970, p. 13–15.
1.2.2. Autres caractéristiques des signes linguistiques
► Les signes linguistiques se réalisent sous une forme orale et sous une forme écrite.
Dans l’orthographe française actuelle (III), la correspondance entre les réalisations orales et écrites est loin d’être univoque. Mais le français écrit et le français parlé (I) ne se distinguent pas seulement par la matière phonique et graphique de leurs signifiants. Les deux systèmes présentent aussi de nombreuses distorsions dans l’économie des marques morphologiques et dans les fonctionnements syntaxiques (1 : 2).
► Qu’il s’agisse de leur structure interne ou de leurs combinaisons, les signes linguistiques sont linéaires. Cette servitude due au caractère d’abord oral du langage (il est impossible d’émettre simultanément deux sons, deux syllabes, deux mots, etc.) se répercute sur la transcription alphabétique dont les unités (lettres et mots) se succèdent sur la dimension de la ligne.
Faisant en quelque sorte de nécessité vertu, le langage exploite doublement cette dimension unique. D’une part, les mêmes phonèmes (p. ex. [i], [p], [1]) combinés diversement forment différents signes : p. ex. pli, lippe et pile. D’autre part, beaucoup de langues, dont le français, investissent d’une fonction grammaticale la position respective des unités significatives (mots et groupes de mots) dans la phrase. Toutefois, à la succession linéaire des catégories grammaticales se superposent les hiérarchies de regroupements qui déterminent la structure proprement syntaxique des phrases (V : 2.2.1 et 2.2.2).
► Les signes linguistiques, mais aussi les parties constitutives de leurs signifiants (phonèmes et syllabes) se comportent comme des unités discrètes. Ce caractère définit la façon dont ces segments s’opposent entre eux : directement et non pas graduellement par un passage insensible d’un mot ou d’un phonème à l’autre.
Même mal articulé, un son sera identifié à un phonème déterminé (p. ex. à /p/ ou à /b/) et non à une unité intermédiaire située entre les deux et qui tiendrait des deux dans des proportions variables (comme 1,86 qui est plus proche de 2 que de 1). D’où la possibilité de segmenter les énoncés en unités qui se suivent comme des quantités discrètes fonctionnant à différents niveaux d’analyse : groupes de mots, mots, morphèmes, syllabes et phonèmes.
Remarque. — Pour segmenter les énoncés, on utilise l’opération de commutation qui consiste à substituer l’un à l’autre des éléments qui entrent dans les mêmes constructions (phonèmes, morphèmes, mots et groupes de mots) ou qui figurent dans les mêmes contextes phoniques (phonèmes et syllabes). Par exemple dans la phrase Il y a de la bière dans le frigo, le segment bière commute avec moutarde, crème, etc. et se distingue ainsi des mots précédents et suivants qui commutent avec d’autres séries de mots; et dans le mot bière le segment initial /b/ qui commute avec /p/, /f/, etc., se distingue des phonèmes suivants /j/, /M/ et /r/.
1.2.3. Le système de la langue
A chaque moment de son existence une langue est formée d’un nombre théoriquement déterminable, mais pratiquement indéterminé de signes stables dont les signifiants et les signifiés sont réductibles à des traits constants dans leurs emplois récursifs. Ces éléments entretiennent entre eux deux types de relations fondamentales [Saussure : 1916, p. 170-175] :
► les relations syntagmatiques qui s’observent entre les termes d’un même construction ;
► les relations paradigmatiques qu’on peut établir entre une unité et toutes celles qui pourraient la remplacer dans un environnement donné.
Ainsi dans la phrase Les petits ruisseaux font les grandes rivières, les adjectifs petits et grandes sont en relation syntagmatique avec l’article défini les qui les précède et avec les substantifs ruisseaux et rivières qui les suivent. Dans la même phrase, la forme les est en relation paradigmatique avec d’autres déterminants : des, ces, mes, quelques, plusieurs, etc. ; ruisseaux avec d’autres substantifs tels que torrents, orages, etc. ; font avec des verbes transitifs directs comme rencontrent, forment, etc. Des éléments en relation paradigmatique sont mutuellement substituables dans un environnement donné, s’y excluent les uns les autres et forment ensemble un paradigme.
Remarque. — L’une des tâches de la linguistique postsaussurienne a été de donner un contenu plus précis aux notions générales de rapports syntagmatiques et paradigmatiques. Dans le cadre de l’analyse syntaxique des structures phrastiques (V : 2.2 et 2.3), elles ont été progressivement précisées par les notions plus opératoires de distribution, de syntagme, de structure hiérarchique, de classe distributionnelle et de sous-catégorisation.
Un élément linguistique peut ainsi se définir différentiellement par ce qui le distingue des autres éléments dans le(s) système(s) où il figure. Ainsi, si l’on excepte les cas d’homonymie (XVIII : 2.2), les signes sont chacun pourvus d’un signifiant tel qu’il s’oppose à ceux des autres signes, la différence pouvant se réduire à la substitution d’un seul phonème (p. ex. lapin / rapin / sapin, mais aussi lapin / lopin / lupin, etc.). Du coup les signifiants apparaissent investis d’une fonction exclusivement distinctive au plan paradigmatique (ou les signes commutent) et contrastive sur l’axe syntagmatique (où ils appartiennent à des paradigmes différents).
Les signifiés eux aussi se conditionnent et se délimitent réciproquement. Si on ne considère que la complémentarité des mots dans la couverture d’un même domaine notionnel, le signifié de rosé semble effectivement se définir par tout ce qui l’oppose à ses « concurrents directs », que sont les signifiés des autres noms de fleurs cohyponymes (XVIII : 2.4) tulipe, lys, violette, etc. Ce sont ces aspects différentiels et strictement négatifs des signes que Saussure [1916 : 158–69] appelle leur valeur.
La valeur d’une forme linguistique s’identifie à un réseau d’oppositions et de contrastes à interpréter positivement pour déterminer l’appartenance catégorielle de cette forme et son (ou ses) contenu(s) sémantique(s). Elle permet notamment de structurer les catégories lexicales et grammaticales en microsystèmes (ou paradigmes) dont les éléments s’opposent sur la base d’une propriété commune.
Remarques. — 1. Des termes de deux langues auxquels nous attribuons en gros la même signification peuvent néanmoins avoir des valeurs très différentes parce qu’ils ne se situent pas dans les mêmes réseaux d’oppositions. Ainsi l’anglais utilise mutton (viande de mouton) et sheep (mouton sur pied) là où le français ne dispose que du seul terme mouton. Dans ces conditions, bien qu’on traduise sheep par mouton, la valeur du terme anglais est différente de celle de son équivalent français dont le signifié n’est pas restreint par l’existence d’un terme spécifique désignant la viande de mouton. 2. Les morphèmes grammaticaux (XVII : 2.1) délimitent également leurs signifiés selon le principe du partage d’un même champ notionnel en domaines complémentaires. En français, où le pluriel englobe toutes les quantités supérieures à l’unité, l’existence d’un duel exprimant la quantité « deux » (comme en grec ancien) modifierait le signifié du pluriel qui s’opposerait alors simultanément à l’unité et à la dualité.
Bibliographie. — G. Serbat, Saussure corrigé par Benveniste, mais dans quel sens ? Raison présente (numéro spécial), 1982, p. 21–37.
1.2.4. La perspective synchronique
Chaque langue a une histoire dont on peut reconstituer les étapes en identifiant les tendances, voire les lois qui expliquent ses modifications successives. Ces changements dans le temps affectent tous les domaines de la langue. Cependant, depuis près de trois siècles, l’évolution de la langue française s’est considérablement ralentie sous l’influence stabilisatrice de l’écrit imprimé et de l’émergence d’une langue officielle strictement régulée. Aujourd’hui les secteurs les plus sensibles au changement sont ceux du lexique, où s’introduisent quotidiennement des néologismes et, bien qu’à un moindre degré, celui de la prononciation. Choisir de décrire une langue à un moment donné (actuel ou passé) de son existence, c’est adopter une perspective synchronique (étymologiquement : de coexistence à une même époque), la seule en vérité qui permette de l’appréhender comme un système de communication régi par des principes qui assurent son fonctionnement effectif. La mise en perspective diachronique (étymologiquement : à travers le temps) révèle les changements successifs qui se sont opérés dans les différents domaines d’une langue ou d’un ensemble de langues.
Ainsi, pour l’historien des langues, les différentes langues romanes sont des langues-sœurs issues d’une même langue-mère: les mots romans nuit(fr.), notte (ital.), noche (esp.) et noite (port.), par exemple, proviennent de la même forme nocte du latin vulgaire. Dans le domaine morphosyntaxique, la déclinaison latine a d’abord été ramenée à deux cas en ancien français, puis a disparu (sauf dans certaines formes pronominales) en français moderne.
Cependant, l’opposition entre les perspectives synchronique et diachronique est loin d’être irréductible. Rien n’interdit, en effet, d’élargir les études diachroniques à la comparaison de systèmes successifs définis synchroniquement. D’autre part, comme un état de langue n’est pas toujours entièrement ni immédiatement aboli par celui qui lui succède, il n’est pas rare que coexistent momentanément des formes appartenant à deux systèmes diachroniquement consécutifs.
► Actuellement beaucoup de Français de moins de trente ans n’observent plus, contrairement à leurs aînés, l’opposition entre /X/ de lundi et /R/ de lin. Ce phénomène de générations est même un trait caractéristique du français d’aujourd’hui. Parallèlement, on observe actuellement une nette tendance à la réduction du groupe/lj/ à /j/ dans milieu (prononcé miyeu), million, millier, etc. et à la chute (en syllabe finale) de /r/ et de /1/ postconsonantiques dans cent mètres (prononcé cent met’), rend (re) la monnaie, un pauv (re) type, être capab (le) de tout, etc.
► La néologie lexicale (XVII : 3) s’observe synchroniquement, mais obéit au mécanisme typiquement diachronique qu’est la création d’une nouvelle forme lexicale complexe (bébé-éprouvette) ou empruntée (scanner).
► Dans toute langue subsistent des vestiges isolés d’états révolus, sortes de buttes-témoins linguistiques, qui se distinguent des autres formes linguistiques par leur caractère hors-système. C’est le cas en français moderne des formes dites irrégulières de certains pluriels de substantifs et d’un verbe comme aller, ou encore des lettres étymologiques (p. ex. g de doigt < digitum et p et s de temps < tempus) conservées par l’orthographe (III : 3.4). Le domaine syntaxique n’est pas exempt de survivances dont la structure relève d’états de langue révolus. Ainsi l’expression idiomatique à son corps défendant (littéralement : en défendant son corps; aujourd’hui : à contrecœur, à regret) s’analyse comme un ancien gérondif (introduit par à et non par en) où le complément d’objet direct son corps était régulièrement antéposé à la forme verbale.
Bibliographie. — E. Genouvrier, J. Peytard, 1970, p. 9–10 et 93–95 – A. Martinet, 1970, p. 28-31 – J. Lyons, 1970, p. 37–40 – St. Ullmann, 1965, p. 38–41.
1.2.5. La fonction sémiotique des langues
Préalablement à tout emploi, les signes d’une langue forment des réseaux conceptuels dont l’originalité tient à la spécificité des éléments et aux rapports qu’ils entretiennent. Comme le remarque A. Martinet, « à chaque langue correspond une organisation particulière des données de l’expérience. Apprendre une autre langue, ce n’est pas mettre de nouvelles étiquettes sur des objets connus, mais s’habituer à analyser autrement ce qui fait l’objet de la communication » [l970 :12]. Ces conditionnements faits de possibilités, de choix et de contraintes spécifiques confèrent à chaque langue son originalité – en un mot ce qu’on appelle son « génie ».
Un Français distingue spontanément encre ce qu’il appelle fleuve, rivière, torrent, gave, ruisseau, ruisselet, ru, etc., parce que son lexique différencie assez finement les cours d’eau selon leur dimension, leur débit, le profil de leur parcours et leur situation géographique. Cette catégorisation n’a pourtant rien d’universel et l’on peut imaginer des langues et il en existe qui analysent la même matière notionnelle de manière plus sommaire. Inversement le français traduit par le seul verbe sonner les trois verbes allemands klingein, lauten et schlagen qui identifient respectivement le son d’une sonnette, d’une cloche et d’une horloge. Un exemple souvent cité est celui du découpage du spectre lumineux. Dans un continuum où le français distingue six couleurs de base, le chona (langue de Zambie) n’en reconnaît que trois et le bassa (langue du Libéria) deux. Le russe et le polonais, en revanche, scindent la zone du bleu français en deux couleurs distinctes.
Bibliographie. — E. Benveniste, 1966, p. 2530 et 56–74; 1974, p.44–66 – H.A. Gleason, 1969, p. 9-10 – J. Lyons, 1970, p. 4547 – A. Martinet, 1970, p. 10–12 – G. Mounin, 1968, p. 81–89.
1.3. La dimension sociale des langues
Le caractère instrumental des langues est à ce point indissociable de la vie en groupe que les préhistoriens lient la naissance du langage à l’apparition simultanée, il y a deux millions d’années chez l’homo habilis, de l’instrument concret qu’est l’outil. Chacun, d’autre part, s’approprie sa langue comme une partie de son héritage socioculturel. Comme, de surcroît, les systèmes symboliques des langues sont partiellement immotivés (XVIII : 1.2), ils s’apprennent et se pratiquent au même titre que les codes conventionnels qui règlent notre vie en société.
1.3.1. Les variétés d’une langue
Les langues contribuent à assurer l’identité et l’unité à l’intérieur des communautés humaines, mais aussi car ce qui réunit peut aussi exclure la différence et la ségrégation. Sensibles aux divers facteurs de différenciation qui traversent et travaillent le tissu social, elles reflètent les clivages internes qui tiennent à la localisation géographique et à l’appartenance à une classe sociale, à un milieu culturel, à un groupe professionnel ou à une classe d’âge. En France, le français standard coexiste avec d’autres variétés du français pour former un grand polysystème que structurent des constantes et des variables. On distinguera à gros traits :
• les variétés régionales : parlers et usages locaux du français ;
• les variétés situationnelles : langue soignée, courante, familière, etc. ;
• les variétés techniques : langues de spécialités (juridique, médicale, technologique, etc.);
• les variétés sociales : parler populaire, argots, etc., et sans doute aussi français standard ;
• les variétés stylistiques : langue littéraire, administrative, philosophique, mais aussi poétique, archaïque, etc.
L’idiolecte d’un locuteur, c’est-à-dire l’ensemble des usages linguistiques qui lui sont propres, se présente généralement comme la conjonction de plusieurs variétés : p. ex., d’une variété régionale et d’une variété sociale, toutes deux fixes, et de plusieurs variétés situationnelles adaptées à divers types d’échanges verbaux.
1.3.2. La norme
L’une des questions centrales traitées en sociolinguistique est justement celle de l’unicité de la norme (ou usage dominant) par rapport aux variations effectives que présente toute langue. Le français standard, par exemple, n’est qu’une variété parmi d’autres, mais qui, promue au rang de langue officielle, se trouve strictement normée et contrôlée institutionnellement. Ainsi entendue, la norme du français telle qu’elle est fixée par l’Académie française, enseignée dans les écoles et codifiée dans les manuels didactiques (grammaires et dictionnaires) ne fait que privilégier l’usage d’une région (Paris) et des milieux cultivés en général. Corollairement, les usages qui s’écartent de cette norme ont souvent été dépréciés, voire décrétés fautifs (cf. les jugements de valeur : « mauvais français », « ne se dit pas », « incorrect », etc.).
à cette conception rigide et mutilante d’un « bon usage » exclusif de tout autre qui est encore celle de la plupart des grammaires prescriptives (2.4) s’oppose aujourd’hui celle, plus fonctionnelle, d’une norme variant selon les situations de communication.
Un même locuteur ne s’exprime pas de la même manière dans une conversation à bâtons rompus avec un vieil ami et dans un discours officiel. Par exemple, les variantes : a. Il a demandé après lui / b. Il a demandé de ses nouvelles et a. C’était vachement chouette / b. Le spectacle était d’une infinie beauté expriment le même contenu référentiel, mais d’abord en français familier, voire vulgaire (a.), puis en français standard et recherché (b.). Le verbe aimer présente trois constructions infinitives : courante (Il aime lire), soutenue/littéraire (Il aime à lire) et complètement vieillie (Il aime de lire). C’est un fait également bien connu que le français dit « populaire » n’opère pas toujours la distinction entre lui et y, mais utilise la forme pronominale indifférenciée /i/ (J’y vais, mais aussi J’y ai dit de venir). Le lexique, enfin, fournit de nombreuses classes d’équivalences dont les termes ne se distinguent que par leur appartenance à des variétés de langue concurrentes : les locuteurs français reconnaissent dans bouffer, boulotter, becquetter et grailler des variantes familières, voire populaires, du terme standard manger.
Dès lors, qu’il s’agisse de la prononciation (accents régionaux ou accents d’affectation tels l’accent faubourien et, à l’opposé, celui de « Marie-Chantal »), du lexique ou des constructions syntaxiques, le français contemporain se démultiplie en usages spécifiques définis par leur appartenance à la gamme des registres de langue esquissée ci-dessus.
Nous savons tous par expérience, et ne serait-ce que pour avoir un jour été identifiés d’après notre « accent » perçu comme régional ou étranger, que les « façons de parler » individuelles sont souvent interprétées comme des indices de notre appartenance à un milieu ou de notre origine géographique.
Enfin, si parler une langue c’est en avoir intériorise la grammaire au sens large du terme (2.3) et avoir ainsi acquis une compétence langagière (3.1), force est de constater qu’un locuteur français possède une gamme plus ou moins étendue de compétences sous-jacentes aux usages qu’il fait de sa langue maternelle. Les unes, que l’on peut qualifier d’activés, correspondent aux formes et aux registres de langue qu’il emploie spontanément ; les autres, dites passives, lui permettent d’identifier et d’interpréter des tournures et des usages qu’il n’utilise pas spontanément.
Bibliographie. — P. Bourdieu, L’économie des échanges linguistiques, Langue française, 33, 1977, p. 17–34 – Cahiers de linguistique sociale, 1, 1977; Langue française, 16, La norme, 1972; 54, Langue maternelle et communauté linguistique, 1982 – H. Frei, 1929 – E. Genouvrier, Quelle langue parler à l’école? Propos sur la norme du français, Langue française. 13, 1972, p. 34–51 ; Naître en français, Larousse, 1986 – W. Labov, Sociolinguistique, Ed. de Minuit, 1976 – B. Muller, Le français d’aujourd’hui, Klincksieck, 1985, p. 35–52 et 134–295 – D. Leeman-Bouix, 1994.
Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993
La transcription phonétique du Nouveau Petit Robert
Pourquoi une transcription phonétique ?
L’orthographe française a été fixée pour l’essentiel, après bien des hésitations, par les grammairiens de la fin du XVIe siècle. Il fallait mettre un peu d’ordre dans l’écriture. Ainsi l’alphabet latin, utilisé pour le français écrit, comprenait 6 voyelles, alors que l’évolution de la langue orale conduit а distinguer 16 voyelles aujourd’hui. Mais le désir de rapprocher l’écrit de l’oral était contrarié par le désir aussi légitime de renforcer les liens graphiques avec la langue mère, le latin : ainsi a-t-on corrigé tens en temps а cause de tempus, doi en doigt а cause de digitum. La langue orale a continué d’évoluer alors que les graphies se sont stabilisées en gardant de nombreuses traces de l’étymologie latine.
L’écart entre le code écrit et le code oral n’a cessé de se creuser, le second ne pouvant être déduit du premier ; d’où la nécessité de noter la prononciation. D’anciens dictionnaires de langue (tels le Dictionnaire général v. 1900, ou le premier Grand Robert) avaient fait des tentatives de notation de « prononciation » en translittérant le mot tant bien que mal à l’aide d’une orthographe simplifiée qui variait d’un ouvrage à l’autre.
Nous avons choisi dès 1964 de donner une prononciation avec les signes de l’Association internationale de phonétique ou A.P.I., utilisés par les phonéticiens (le sigle A.P.I. désigne souvent l’alphabet lui-même par souci de simplification). Le programme de l’A.P.I. est simple mais cependant ambitieux. Il se propose de faire correspondre un symbole à chaque son distinctif, dans une langue donnée, de telle sorte qu’un même son soit noté par le même symbole et qu’un symbole corresponde toujours au même son. L’alphabet de l’A.P.I. est aujourd’hui adopté internationalement.
Le Nouveau Petit Robert a fait l’objet d’une révision intégrale de la phonétique. Une comparaison avec le Petit Robert de 1967 et le Grand Robert permet d’évaluer le chemin parcouru tant sur le plan de l’évolution de la prononciation que sur celui des principes théoriques qui ont guidé notre travail. La comparaison nous a permis de constater que certains points du système phonétique français étaient stables et d’autres en mutation. De même que l’enrichissement du vocabulaire donne l’image d’une langue vivante, de même le réajustement de certaines prononciations selon l’usage actuel peut sensibiliser le lecteur du dictionnaire aux tendances évolutives des sons du français.
Tendances dans l’évolution du système des sons
Les semi-consonnes
La syllabation a une influence sur la prononciation dans différents cas. Pour éviter le hiatus, en général les voyelles les plus fermées du français [i], [y], [u], suivies d’une voyelle prononcée, ne sont pas syllabiques et donc se comportent comme des consonnes. Ainsi on prononce su [sy] mais suie [sPi], pie [pi] mais pied [pje], fou [fu] mais fouet [fwD]. Cette variation consonantique, qui est automatique chez les Parisiens, n’est pas toujours perçue et de plus, elle tend à se produire moins systématiquement. On entend actuellement muette [myDt] et non [mPDt] ou fluide [flyid]. Nous avons cependant transcrit ces mots selon l’ancien usage, en maintenant une règle dont l’application est assez flottante, mais qui aide à maintenir l’opposition entre pied [pjD] et piller [pijD] ainsi que la prononciation [wa] du digramme oi.
La syllabation se manifeste aussi pour isoler par analyse les éléments savants d’un mot : bio/type [bjotip] mais bi/oxyde [biCksid].
Le e instable
Dans la version 1993, nous avons souvent maintenu un [(B)] en syllabe initiale des mots afin de distinguer les cas ou ce e instable peut tomber (ex. petit [p(B)ti], nous gelons [F(B)lT], de ceux où il ne tombe jamais (belette [bBlDt], nous gelions [FBljT]). Nous l’avons toutefois supprimé lorsqu’il figurait entre parenthèses à la fin des mots terminés par deux consonnes prononcées (ex. porte qui était transcrit [pCrt(B)]) ; nous prenions alors en compte la prononciation du mot en discours. Mais actuellement, la prononciation de ce e instable dépend moins de sa place dans l’énoncé et on entend souvent dire une porte fermée [ynpCrtfDrme].
Les liaisons
Le problème posé par les liaisons ressemble à plus d’un titre à celui du e instable. On peut distinguer les liaisons obligatoires (déterminant + nom : un homme [XnCm], un grand homme [XgrStCm] ou pronom + verbe : ils ont [ilzT], ils en ont [ilzSnT], nous nous en allons [nunuzSnalT]), les liaisons « interdites » (principalement nom au singulier + adjectif : l’enfant adorable [lSfSadCrabl] et les liaisons facultatives principalement après les verbes : il chantait une chanson [ilGStD(t)ynGSsT] ou après les noms au pluriel : des enfants adorables [dezSfS(z)adCrabl]). Comme pour le e instable, la liaison facultative joue un rôle important en tant qu’indice du niveau plus ou moins familier du discours ; jongler avec la liaison comme avec le e instable marque l’aisance du locuteur face aux usages multiples de la langue. Il n’y a qu’à écouter les hommes politiques pour sentir comment ils jouent de la liaison facultative ; ils la suppriment quand ils veulent créer une connivence avec les journalistes ou le public, et ils la maintiennent quand ils veulent donner plus de poids à leur dire. Une personne qui fait trop de liaisons facultatives risque d’avoir l’air emprunté, et celle qui fait une liaison « interdite » (ou absente) risque de se disqualifier aux yeux de ses interlocuteurs. La tendance du français commun dans la conversation est de s’en tenir aux liaisons obligatoires même si la maîtrise des liaisons facultatives est souvent souhaitable dans des registres de langue soutenue. Nous avons indiqué à l’intérieur de l’article certaines liaisons obligatoires surtout dans le cas des nasales, car la liaison se fait avec ou sans dénasalisation (ex. bon anniversaire [bCnanivDrsDr] mais aucun ami [okXnami]), et aussi dans certains syntagmes en voie de lexicalisation (ex. de but en blanc [dBbytSblS]).
Un cas de non liaison : le h aspiré
Traditionnellement, il y a élision et liaison devant les mots commençant par une voyelle ou par un h muet (l’eau [lo], les eaux [lezo] ; l’habit [labi], les habits [lezabi]).
En revanche, devant les mots (le plus souvent d’origine germanique) commençant par un h dit aspiré (noté [‘] dans les entrées du dictionnaire), on ne fait ni élision, ni liaison (le haut [lBo], les hauts [leo]). Pour éviter de confondre haut et eau dans le discours, haut est transcrit [‘o].
Cette marque [‘] a été étendue à des mots devant lesquels on ne fait ni liaison ni élision, en particulier les noms de nombre (onze [‘Tz]) et beaucoup de mots commençant par la lettre y suivie d’une voyelle prononcée, car le début de ces mots est perçu comme une consonne (yaourt [‘jaurt]). Ainsi hiéroglyphe a été transcrit [‘jerCglif] malgré son origine grecque, à cause du son [j] initial qui favorise l’absence de liaison.
Consonnes doubles ou géminées
Une tendance à la simplification des géminées apparaît nettement. Ainsi, dans la préface du Petit Robert de 1967, nous disions des géminées : « Elles se prononcent presque toujours dans certains mots savants ou étrangers et à l’articulation d’un préfixe avec un radical (illégal). » Une comparaison des transcriptions de ces mots fait apparaître que beaucoup de géminées, autrefois considérées comme obligatoires, ont été notées comme facultatives ou bien supprimées. C’est dans les mots à préfixe non modifiable que les géminées résistent le mieux, ainsi dans interrègne [RtDrrDQ] plutôt que dans irresponsable [i(r)rDspTsabl].
Consonnes muettes
On constate une tendance à prononcer des consonnes écrites autrefois considérées comme consonnes muettes. Selon l’usage de plus en plus fréquent, nous avons noté un [(t)] à la fin d’un certain nombre de mots (but [by(t)]) et même parfois à l’intérieur de certains mots (amygdale [ami(g)dal], dompteur [dT(p)tZr]). La prononciation de ces consonnes est néanmoins toujours considérée comme abusive par les puristes et par bien des pédagogues. Dans ce cas, l’influence de l’orthographe est déterminante.
Évolution du système vocalique
Si l’on s’en tenait à noter la prononciation commune aux francophones, on aurait noté un seul son (archiphonème) pour les « voyelles à deux timbres », par exemple E pour regrouper [e] et [D], A pour [a] et [A], O pour [o] et [C] et OE pour [V] et [Z] et même [B]. Cette notation réduirait le système vocalique du français à 10 voyelles au lieu de 16. Mais la prononciation standard (notamment à Paris) conserve encore les oppositions e/D (ex. épée/épais) et o/C (ex. saute/sotte).
Pour les personnes faisant une différence entre [e] (fermé) et [D] (ouvert) en syllabe finale de mot, l’usage est de généraliser une prononciation [D] pour la graphie -ai. Ainsi j’ai, quai, gai autrefois prononcés avec [e] ont tendance à se prononcer [FD], [kD], [gD]. De même, le futur et le passé simple des verbes en -er ont tendance à se prononcer avec [D] comme le conditionnel et l’imparfait (ex. : je chantai [GStD] et je chanterai [GStrD]). Quant à l’opposition V/Z (ex. jeûne/jeune), elle se maintient surtout grâce à l’alternance masculin/féminin du type menteur [mStZr], menteuse [mStVz]. Tous ces faits nous ont conduits à garder le système vocalique du français avec 16 voyelles.
Si la prononciation d’Île-de-France est généralement considérée comme une prononciation de référence (à tort ou à raison), un accent trop « parisien » est au contraire considéré comme populaire ou archaïque. Ainsi l’ancienne prononciation des mots en -ation [AsjT] nous a semblé vieillie, nous avons donc noté [asjT] (ex. éducation [edykasjT]). L’ancienne prononciation parisienne gare [gAr], ressentie comme populaire, a été éliminée et là aussi nous avons noté un [a].
Cette évolution nous a amenée à reconsidérer certaines de nos positions sur l’homonymie et à envisager comme de possibles homonymes (notés HOM. poss. dans la rubrique finale) de nouvelles unités :
1) Des mots ne se distinguant que par les voyelles [a] et [A] ou [R] et [X] prononcées de façon identique par beaucoup de Français (ex. ta et tas ; brin et brun).
2) Des mots ne se distinguant que par les voyelles [e] et [D] et même [o] et [C] en syllabe non finale de mot (ex. pécheur et pêcheur ; méson et maison ; chauffard et schofar).
Dans cette révision des homonymes, nous avons mis en relation certaines formes verbales conjuguées qui pourraient être confondues à l’oral. Ainsi le verbe savoir est rapproché des verbes saurer, suer et sucer par l’intermédiaire de formes fléchies homophones, et pour certaines formes, les verbes allaiter et haleter ont une prononciation commune (ex. [DlalDt] pour elle allaite ou elle halète).
Choix de présentation de la phonétique
Dans le cas de réalisations phonétiques multiples, nous avons choisi de noter une seule des variantes possibles, de préférence la plus conforme à la prononciation récente des locuteurs urbains éduqués d’Île-de-France et de régions voisines, en espérant ne pas choquer les utilisateurs d’usages plus anciens, ruraux ou de régions où subsiste soit un bilinguisme, soit l’influence d’une autre langue ou de dialectes (par ex. Occitanie, Bretagne, Alsace...).
Il y a cependant une exception à cette préférence pour la transcription unique : les emprunts. Entre la prononciation proche de la langue d’origine et une prononciation totalement francisée, coexiste toute une gamme de prononciations intermédiaires. En général, nous avons mis en première position la prononciation la plus « francisée », suivant ainsi l’usage du plus grand nombre et les recommandations officielles d’intégration des mots étrangers au système français. Les pluriels des emprunts ont souvent été mentionnés à l’intérieur des articles. Nous avons renoncé à indiquer la prononciation correspondante, en particulier pour le -s final des emprunts à l’anglais ou à l’espagnol. Une transcription normative justifierait que l’on note le s du pluriel, mais pour les emprunts la tendance actuelle est de traiter ces mots « à la française », c’est-à-dire de ne plus prononcer le -s final. Ainsi on prononce actuellement des jeans plus souvent [dFin] que [dFins].
Parfois un mot comporte plusieurs formes graphiques qui peuvent aussi correspondre à plusieurs formes phonétiques.
Dans un souci d’harmonisation de l’orthographe et de la prononciation, il aurait été souhaitable d’assortir chaque orthographe de la prononciation qui lui correspondait le mieux. Mais, à cause d’une certaine indépendance du code oral par rapport au code écrit, cela n’a pas toujours été possible. Parfois, nous avons présenté des entrées différentes assorties chacune de sa prononciation, mais ailleurs, nous avons noté toutes les variantes phonétiques au premier mot en entrée.
La transcription phonétique est systématique pour toutes les entrées. Cependant, il est inutile, et même peu réaliste de transcrire les éléments, car leur prononciation varie souvent selon les mots. De plus, quand certains dérivés constitués selon les principes de dérivation usuels en français ont été traités à l’intérieur d’un article, nous n’avons pas jugé utile de les transcrire : ainsi l’entrée glaciologie ayant été transcrite, nous n’avons pas donné la prononciation de glaciologue dont la terminaison est identique à celle de cardiologue, selon un modèle régulier.
Aliette LUCOT-SARIR
Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992
Orthographe
L’orthographe est la manière de manifester par écrit une langue conformément aux règles en vigueur à l’époque considérée. Cette notion de règle actuellement en vigueur distingue l’orthographe de la graphie : dans le mot orthographe, l’élément ortho- signifie « correct », comme dans le vieux mot orthoépie*, pendant de l’orthographe au niveau du discours oral. Pour un mot, par exemple vêtir, il existe, sauf exception rarissime (type bleuet, bluet; clé, clef), une seule orthographe, mais plusieurs graphies possibles : archaïques, c’est-à-dire conformes aux règles d’une époque révolue (vestir); fautives (*vaitir, *vétire, etc.) ; conformes aux règles, non orthographiques, d’un système de notation phonétique ou phonologique ([vetiR] et /vetir/ selon l’A.P.I.), etc. La forme des langues telle que la manifestent leurs orthographes traditionnelles est rarement en tout point conforme à leur forme orale. En français, la distance entre les deux formes est particulièrement importante. D’où la difficulté de l’orthographe française, et le poids qu’elle a acquis non seulement dans l’appareil scolaire — où l’exercice de la dictée conserve une place déterminante — mais également comme mode de sélection sociale.
Une langue se manifeste essentiellement sous deux aspects : l’aspect sonore (oral) et l’aspect graphique (écrit). Soit la phrase : le colibri est un petit oiseau des îles. Elle peut être manifestée par un enchaînement de sons articulés par une voix humaine (voir phonétique). Mais elle peut également apparaître sous l’aspect d’une suite de dessins, les lettres, traces laissées sur une surface (papier, tableau, écran, etc.) par une substance (encre, poudre de craie, rayonnement, etc.) qui y est mise en forme à l’aide d’un instrument (plume, caractères typographiques, bâton de craie, etc.). Il existe des traits communs entre ces deux façons de manifester le discours : dans l’un et l’autre cas, un effort musculaire (celui des organes phonateurs ou des muscles du bras et de la main) ou mécanique met en mouvement une substance (l’air, l’encre, etc.). Les éléments de la chaîne orale et ceux de la chaîne écrite ont les uns et les autres une fonction distinctive, pour une part indépendante des particularités de leur réalisation : tout comme le phonème /r/ a la même fonction, qu’il soit réalisé comme « roulé », « spirant » ou « grasseyé », la lettre r a la même fonction, qu’elle soit manuscrite, dactylographiée, imprimée, etc. Mais il y a d’importantes différences entre l’oral et l’écrit. La plus évidente est que la manifestation orale est fugitive (sauf si on l’« enregistre » sur un disque, une cassette, etc.) alors que la manifestation écrite est, sauf cas particulier, plus ou moins durable. On observe également que l’écriture fait apparaître des délimitations qui ne sont pas perceptibles au niveau du discours oral : la phrase orale citée ne comporte pas de pause, alors que la phrase écrite présente des plages blanches entre les unités que constituent les mots.
Les relations entre les deux aspects de la manifestation de la langue peuvent être décrites de deux façons différentes :
1. La conception la plus courante consiste à décrire la manifestation écrite comme une représentation (plus ou moins fidèle) de la manifestation orale. L’écriture est alors seconde par rapport à la voix, dont elle n’est en quelque sorte que le vêtement, voire le déguisement.
2. Mais il est également possible de soutenir que chacune des deux manifestations constitue une forme spécifique de la langue, susceptible d’être étudiée de façon indépendante. Ainsi on a pu dire, à propos du français ou de l’anglais, qu’il est tout aussi légitime de remarquer le peu d’adéquation du système oral au système écrit que de faire la constatation inverse, plus conforme à la tradition. Dans une telle optique, on n’institue pas la relation hiérarchique de secondarité (et de subordination) de l’écrit par rapport à l’oral.
Inévitablement, ces deux conceptions opposées entraînent des définitions différentes de l’unité minimale du système graphique, le graphème, distinct de la lettre comme le phonème l’est, mutatis mutandis, du son. Compte tenu de la visée spécifique de cet ouvrage, on s’en tiendra, pour l’essentiel, à la première conception, bien que l’appareil notionnel qu’elle met en place, notamment la définition du graphème, soit sans doute moins rigoureux que celui de la seconde conception.
Il existe plusieurs systèmes de manifestation écrite des langues. Certains systèmes notent, sans les analyser en éléments plus petits, les unités signifiantes que sont les mots ou les morphèmes. Les unités des écritures de ce type reçoivent le nom traditionnel d’idéogrammes (on a proposé la désignation plus exacte de morphémogrammes). Quoique non homogènes — ils comportent l’un et l’autre des éléments phonographiques — le système hiéroglyphique de l’égyptien ancien et le système de caractères du chinois donnent des exemples d’idéogrammes. D’autres systèmes notent les syllabes : les unités en sont les syllabogrammes. Les autres enfin comportent un inventaire d’éléments, les lettres de l’alphabet*, qui correspondent, de façon plus ou moins précise, aux phonèmes de la manifestation orale. Ce sont les systèmes alphabétiques. Les langues européennes contemporaines utilisent de tels systèmes. L’alphabet latin est le plus répandu. Il est concurrencé, en Europe, par l’alphabet cyrillique (pour le russe) et l’alphabet grec. Le français utilise l’alphabet latin. Toutefois il existe au sein de ce système alphabétique certains éléments qui relèvent d’un système idéographique : le signe † utilisé devant un nom propre pour marquer que la personne qui le porte est morte; les signes tels que § (« paragraphe ») et & (« et »), les sigles de certaines monnaies ($ pour « dollar », £ pour « livre sterling », etc.), et surtout les chiffres et autres signes arithmétiques, qui se lisent de façon différente selon la langue du texte où ils apparaissent : 7 est lu sept par un français, sieben par un allemand, sette par un italien, etc. Ce fait indique que 7 représente non pas les signifiants sept, sieben, sette mais le signifié arithmétique, censé unique, auquel de leur côté renvoient les signifiants. L’usage des idéogrammes semble se développer dans certains secteurs de l’usage contemporain : la publicité utilise communément le dessin d’un cœur (en outre souvent de couleur rose) ( ) comme idéogramme du verbe aimer : j’ la grammaire, j’achète la grammaire d’aujourd’hui ! Les catégories grammaticales elles-mêmes ont, épisodiquement, une manifestation idéographique; le redoublement des abréviations MM. (pour Messieurs), pp. (pour pages), §§ (pour paragraphes) marque le pluriel, sans le limiter à deux unités. Enfin, certains signes de ponctuation* ont un fonctionnement idéographique.
Mis à part ces éléments qui restent marginaux, le système est alphabétique. Mais on constate immédiatement que la correspondance entre les deux manifestations écrite et orale est loin d’être parfaite. Dans la phrase citée au début de l’article, le mot colibri présente un exemple de coïncidence terme à terme (biunivoque) entre les 7 phonèmes et les 7 lettres qui le constituent :
-
k
C
l
i
b
R
i
c
o
l
i
b
r
i
Mais il n’en va pas de même pour le mot oiseau, qui comporte quatre phonèmes /w/, /a/, /z/, /o/, et six lettres. Le digramme* oi correspond au groupe de deux phonèmes /wa/, sans qu’il soit possible d’affecter o à /w/ ni i à /a/. La lettre s note ici le phonème /z/, alors que dans d’autres cas elle note le phonème /s/ : sot. Enfin le trigramme* eau note le phonème /o/. Dans le mot petit, le t final correspond effectivement au phonème /t/. Mais celui-ci ne se manifeste oralement que parce qu’il apparaît devant l’initiale semi-vocalique /wa/ de oiseau (voir liaison). Il n’apparaîtrait pas devant l’initiale /v/ de volatile. Il en va de même pour le s de des, qui n’a de correspondant oral, sous la forme /z/, que parce qu’il est situé devant une voyelle. Enfin, le mot îles présente plusieurs phénomènes intéressants : le /i/ pourtant phonologiquement identique aux deux /i/ de colibri, y est noté, de façon différente, par î ; le e et le s ne correspondent à aucun élément de la chaîne orale. Ils n’ont toutefois pas le même statut : le e apparaît constamment dans la graphie du mot île, alors que le s n’est présent que lorsque le mot est au pluriel. La lettre s constitue donc la marque de la catégorie morphologique du pluriel qui, apparente au niveau du code écrit, ne l’est pas au niveau du code oral.
Ces phénomènes, variés, complexes et, pour certains, apparemment étranges, s’expliquent par la structure spécifique de l’orthographe française. On peut en décrire les grandes lignes de la façon suivante.
Les lettres de l’alphabet sont, selon le cas, chargées de trois fonctions différentes :
A. Elles peuvent correspondre aux phonèmes du code oral. Elles ont alors une fonction phonographique, d’où leur nom de phonogrammes. Mais cette correspondance obéit elle-même à des règles complexes, comme le montre le tableau synoptique de correspondance. On y constate en effet les deux ordres de faits suivants :
1. La correspondance quantitative entre un phonème et une lettre, observée dans de nombreux cas (voir l’exemple de colibri) n’est pas généralisée :
a) Il est fréquent qu’un phonème unique soit marqué par un groupe de deux lettres (digramme) ou de trois lettres (trigramme). Exemples :
— voyelles : la voyelle /o/est notée selon le cas par une lettre (o ou ô), par un digramme (au) ou par un trigramme (eau); les voyelles nasales ne sont jamais marquées que par des digrammes ou des trigrammes comportant une consonne graphique n ou m marquant la nasalité : /S/ est noté par les digrammes an, am, en et em et par les trigrammes aon (paon, faon) et aen (Caen).
— semi-voyelles : elles sont notées selon le cas par une lettre, un digramme ou un trigramme. Ainsi /j/ est noté par i (diable), y (yeux), par le digramme il (rail) ou le trigramme ill (feuillage).
— consonnes : une seule consonne, /v/, n’est jamais marquée que par une lettre (v, w, f dans les cas de liaison du type neuf heures). Les consonnes /G/, /Q/ et /E/ ne sont jamais marquées que par des digrammes ou trigrammes (respectivement ch/sch, gn et ng ). Les autres consonnes sont marquées selon le cas par une lettre, un digramme, parfois un trigramme : ainsi /k/ a alternativement pour marques les lettres c, k et q, les digrammes ce, qu, ck, ch (chœur), cq (Lacq) et les trigrammes cqu (acquitter) et cch (saccharine).
Inversement, il existe une lettre, x, qui correspond à un groupement de deux phonèmes, /ks/ dans axe, /gz/ dans examen. Seuls font exception à cet usage dix ([dis]) et six ([sis]), ainsi que quelques noms propres : Bruxelles, Auxerre, Auxonne, etc., qui ont pour prononcia tion traditionnelle [brysDl], [osDr], [osCn], où x correspond au phonème /s/. En liaison, ainsi que dans sixième et dixième, x correspond à/z/.
La lettre h ne correspond jamais à aucun phonème (en dehors du digramme ch où elle contribue selon le cas à la marque de /G/ ou de /k/) :
à l’initiale d’un mot, elle est selon le cas dite « aspirée », et a alors pour effet de bloquer tout phénomène d’élision* et de liaison* (le harnais, les harnais, [lBaRnD], [lDaRnD]) ou dite « muette » (l’huile, les huiles, [lPil], [lDzPil]). Sa fonction linguistique, très résiduelle, se situe alors exclusivement au niveau de l’identification des mots (voir plus bas) ;
à l’intérieur d’un mot entre deux voyelles, elle marque, en alternance avec l’absence de toute lettre, l’hiatus* : cahot/chaos.
d) La lettre e correspond dans certains de ses emplois au e dit « muet » ou « caduc », qui selon le cas se prononce [B] ou ne se prononce pas (voir phonétique). Aux renseignements fournis à cet article on ajoutera ici le traitement de l’e caduc au voisinage d’une voyelle : e n’est jamais prononcé : asseoir [aswaR], nettoiement [netwamS]. En fin de mot, e fonctionne fréquemment comme marque, exclusivement graphique, du féminin : polie, barbue (voir plus bas, ainsi que genre et adjectif).
2. La correspondance qualitative entre les phonèmes et les lettres n’est pas généralisée. Le tableau synoptique donne des exemples des deux types de faits suivants :
à un phonème correspond toujours (sauf pour le phonème /E/ d’introduction récente) plus d’une marque graphique. Pour prendre l’un des exemples les plus simples, le phonème /v/ est noté par v (dans vide), par w (dans wagon) et par f (dans neuf heures).
à une marque graphique correspond presque toujours plus d’un phonème. Ainsi le w marque, dans wagon, le phonème /v/. Mais il marque aussi, dans water, le phonème /w/.
Compte tenu des descriptions qui viennent d’être faites des correspondances entre l’écrit et l’oral, on voit en quoi le système orthographique français s’éloigne de la biunivocité d’un système tel que l’API. Dans ce système, les relations entre les unités des deux plans sont notées de la façon suivante :

Dans le système de l’orthographe, les relations sont notées d’une façon infiniment plus complexe (encore l’exemple choisi est-il des plus simples) :

Ces phénomènes sont encore compliqués par l’intervention des deux autres fonctions des lettres.
B. Comme on l’a aperçu lors de la description du mot îles ou des mots polie et barbue, certaines lettres (ou groupes de lettres), privées de manifestation orale, ont une fonction morphologique : elles indiquent, exclusivement dans la graphie, les catégories morphologiques qui affectent les mots. Si on compare les réalisations écrite et orale de : leurs livres restaient ouverts ([lœRlivRDstDtuvDR]), on constate que la marque du pluriel est manifestée à quatre reprises (3 fois par -s, une fois par -ent) dans la phrase écrite, alors qu’elle ne l’est pas du tout dans la phrase orale, qui est exactement homophone* de la phrase correspondante au singulier. On dit que les éléments qui marquent dans l’écriture les catégories morphologiques sont des morphogrammes.
Les morphogrammes interviennent dans la grammaire et dans le lexique.
Dans la grammaire, ils apparaissent au niveau du syntagme nominal dans la flexion du nom et de l’adjectif, accessoirement dans celle des déterminants et des pronoms. Dans le syntagme verbal, ils jouent une fonction importante dans la flexion du verbe. On se contentera ici de donner quelques exemples simples de faits qui sont étudiés avec plus de détails à adjectif, conjugaison, genre, indéfinis, interrogatifs, nombre, personnels et possessifs.
Genre du nom et de l’adjectif : ami, amie; bancal, bancale. Parmi les déterminants, seuls les interrogatifs-exclamatifs et l’indéfini nul présentent une opposition de ce type, exclusivement graphique : quel, quelle; nul, nulle (on remarquera la gemmation* du l au féminin). À ce titre, on peut dire que -e est le morphogramme du féminin, même s’il apparaît également à la finale de nombreux mots masculins (agile, frêle, obèse, etc.).
Nombre du nom et de l’adjectif : c’est ici l’-s, parfois suppléé par 1’-x qui fonctionne comme morphogramme du pluriel : pomme, pommes; joli, jolis; tableau, tableaux; nouveau, nouveaux. Parmi les déterminants, de nouveau les interrogatifs-exclamatifs : quel, quels, les indéfinis certain(s) et quelque(s), les possessifs de 3e personne leur, leurs, dont la particularité est de marquer graphiquement le nombre sans marquer le genre. Parmi les pronoms, les formes il, ils et elle, elles (ces dernières fonctionnant et comme formes conjointes et comme formes disjointes : elles, elles travaillent), celle et celles.
Les morphogrammes -e du féminin et -s du pluriel peuvent s’enchaîner : ami, amie, amies; bancal, bancale, bancales; quel, quelle, quelles (mais leur, leurs, sans formes *leure ni *leures).
Dans le système verbal, les morphogrammes interviennent comme marque de la personne (j’aime, tu aimes; je (tu) fais, il (elle) fait), comme marque du nombre (il travaille, ils travaillent), de façon plus limitée comme marque du mode (j’ai, (que) j’aie).
Dans le lexique, les morphogrammes interviennent pour signaler la relation entre les formes fléchies d’un mot : le -t final de petit marque la relation avec la forme de féminin petite. Ils indiquent également la relation entre une forme simple et une forme dérivée : le -d de marchand ou le -et de respect indiquent la relation entre les formes simples et leurs formes dérivées telles que marchander, marchandise ou respecter, respectable.
Remarque. — Dans cette description des morphogrammes, on n’a retenu que des éléments qui n’ont pas de manifestation orale. Il ne serait théoriquement pas impossible de considérer comme morphogrammes les marques flexionnelles qui ont en outre une manifestation orale : dans l’opposition je marche, nous marchons, il est incontestable que -e est différent de -ons dans l’écriture, même si cette différence a son pendant dans la prononciation (où elle prend la forme zéro vs [T]). Un tel point de vue, quoique théoriquement légitime, aurait l’inconvénient d’occulter un caractère frappant du français : la distance qui existe entre les manifestations orale et écrite des catégories morphologiques. Il faut toutefois rappeler que plusieurs morphogrammes (par exemple -s, -x, -t) ont une manifestation orale dans les cas de liaison* : trait qui manifeste l’extrême complexité des relations entre l’oral et l’écrit.
C. L’orthographe a fréquemment pour fonction de distinguer entre eux des éléments homophones*. La forme [vDR] de l’oral peut correspondre aux cinq orthographes ver, vers, verre, vert et vair, qui ont pour fonction de distinguer cinq mots différents (encore vers reste-t-il équivoque, puisqu’il correspond à trois homonymes*). Les lettres utilisées dans ces mots continuent à avoir la fonction de phonogrammes : le tableau de la page 463 laisse prévoir la manifestation de [vDR] par ver, vers, verre, vert et vair. Mais elles ont en outre une fonction distinctive à l’égard des unités signifiantes que sont les mots. De ce point de vue, elles se rapprochent des idéogrammes dont il a été question plus haut : les graphies verre et vert opposent les unités « verre » et « vert » sans référence à la réalisation orale [vDR], même si cette manifestation se trouve de surcroît notée. On donne souvent à ces réalisations graphiques le nom de logogrammes. On trouvera p. 462 et suiv. un tableau des principales distinctions opérées par les logogrammes. Ce tableau fait apparaître les faits suivants :
les formes distinguées entre elles sont le plus souvent des mots. Mais il peut également s’agir de groupements de mots : lent est ainsi distingué de l’an, où l’on reconnaît l’article défini l’ et le nom an.
les formes distinguées entre elles sont le plus souvent de peu de syllabes. On remarque notamment la prédominance des formes monosyllabiques. C’est là un aspect important de la structure formelle du français : les monosyllabes (et d’une façon générale les formes ayant peu de syllabes) y sont nombreux. Or les combinaisons de phonèmes dans un monosyllabe — en outre limitées par les règles de compatibilité phonologique — ne sont pas en nombre infini. Il est donc inévitable qu’il y ait, au niveau de l’oral, des collisions homonymiques manifestées par l’homophonie de plusieurs unités. En revanche, l’orthographe rend possible la distinction graphique d’un grand nombre d’homophones, tout en laissant subsister un certain nombre d’homonymes absolus, à la fois homographes et homophones (louche, louer, faux, coupe, vol, vers, etc.).
c) pour constituer les logogrammes, l’orthographe utilise les différentes possibilités de représentation phonographique énumérées dans le tableau de correspondance. Mais elle fait également appel aux lettres étymologiques, qui rappellent la forme de l’étymon* du mot concerné. Ainsi -gt dans doigt (distinct de dois, doit) et dans vingt (distinct de vins, vain, vaint, vainc, etc.) rappelle les étymons latins des deux mots, digitum et viginti. Il arrive d’ailleurs que l’étymologie ainsi signalée soit historiquement inexacte : ainsi le -d- de poids (distinct de pois et de poix) rappelle le latin pondus, alors que l’étymon réel de poids est pensum.
D’une façon plus générale, certaines lettres ont une fonction logogrammatique même lorsqu’il n’existe pas de phénomène d’ho-mophonie. Elles contribuent alors à caractériser graphiquement le mot concerné. Ainsi, on peut dire que le h- de homme (étymologique : latin hominem) et de huit (non étymologique : latin octo) est un logogramme, bien qu’il n’existe pas d’homophone [Cm] (ohm, en physique, se prononce [om]) ni [Pit]. Beaucoup de consonnes doubles (voir gémination) ou de groupements de consonnes contribuent ainsi simultanément à rappeler l’étymon du mot et à le caractériser graphiquement : appeler (susceptible d’être distingué de à peler), descendre (susceptible d’être distingué de des cendres), science, etc. Le plus souvent muettes, les lettres étymologiques en sont venues dans plusieurs cas à se prononcer : phénomène d’influence de l’orthographe sur la prononciation, observé dans des mots tels que objet (comparer avec sujet, qui s’est longtemps orthographié subject), flegme (qui a pour doublet* flemme), présomptueux, exact, verdict, etc., ou les consonnes doublées dans la prononciation de collègue, grammaire, etc. Dans dompter et legs,les consonnes -p- et -g- parfois prononcées, sont faussement étymologiques : dompter a pour étymon domitare, et legs est un déverbal* de laisser.
Comme on a pu le constater, on s’est pour l’essentiel tenu, dans la description de l’orthographe française qui vient d’être donnée, à la première des deux conceptions possibles de la manifestation écrite (voir p. 444) : on a présenté l’orthographe dans ses relations avec la manifestation orale de la langue. Simultanément, on a constaté que la notion de graphème, alléguée page 444 comme pendant de la notion de phonème*, n’a pas eu à être employée : on a pu se contenter de la notion de lettre (et de groupement de lettres : digrammes et trigram-mes). Il n’est toutefois pas impossible, même dans l’optique choisie ici, de donner une définition du graphème. Cette définition sera faite par référence à la triple fonction des unités de la chaîne écrite :
comme phonogramme, le graphème sera défini comme la plus petite unité graphique (lettre, digramme ou trigramme) correspondant à un phonème. Ainsi la lettre o, le digramme au, le trigramme eau sont des graphèmes. Une exception est à prévoir pour x, graphème correspondant le plus souvent (voir p. 447) à un groupement de deux phonèmes ;
comme morphogramme, le graphème sera défini par référence à la catégorie linguistique dont il constitue la marque écrite. Le –e du féminin, l’-s ou l’-x du pluriel des noms et des adjectifs, le -(e)nt de la 3e personne du pluriel des verbes sont à ce titre des graphèmes ;
comme logogramme, le graphème sera défini par référence à sa fonction distinctive. Ainsi, le digramme -gt de doigt ou de vingt est un graphème, dans la mesure où il identifie le mot qu’il affecte par opposition à ses homophones.
Toutefois, l’inventaire des graphèmes que font apparaître ces définitions est très chargé : plus de 130 pour les seuls phonogrammes, beaucoup plus si on y ajoute morphogrammes et logogrammes, ces derniers d’ailleurs difficiles à énumérer de façon limitative.
Sans entrer dans des débats théoriques compliqués, on se contentera ici de signaler que la seconde conception de la graphie, autonome par rapport à l’oral, peut se donner d’emblée une définition plus simple du graphème comme unité minimale distinctive de la chaîne graphique, définition exactement analogue, mutatis mutandis, à celle du phonème. L’inventaire des graphèmes dans une telle conception se ramène à celui des lettres de l’alphabet* munies de leurs signes diacritiques : accents*, tréma*, cédille*, soit :
a, à, â, b, c, ç, d, e, é, è, ê, ë, f, g, h, i, î, ï, j, k, 1, m, n, o, ô, p, q, r, s, t, u, ù, û, ü, v, w, x, y, z, soit 39 graphèmes, inventaire à comparer à celui des 36 phonèmes (toutefois, les lettres liées æ et œ font problème).
Comme le sait par expérience tout sujet parlant et écrivant le français comme langue maternelle ou comme langue étrangère, l’orthographe française est particulièrement difficile à acquérir : seule sans doute l’orthographe anglaise peut à cet égard rivaliser avec elle. Cet aspect du français a des conséquences indéniablement fâcheuses tant du point de vue de la diffusion du français comme seconde langue (il est vrai que l’anglais ne semble pas gêné par son orthographe...) que du point de vue pédagogique de l’apprentissage de l’orthographe. Aussi est-il, depuis le XVIe siècle, périodiquement question de réformer l’orthographe. Certaines initiatives limitées de simplification ont abouti, ainsi lors de l’édition de 1740 du Dictionnaire de l’Académie française, qui, par exemple, remplaça y par i dans ceci, moi, gai, supprima de nombreuses consonnes étymologiques (dans a(d)vocat) ou pseudo-étymologique (dans s(ç)avoir), substitua l’accent circonflexe à l’s dans de nombreux mots ( maître, même, etc.). D’autres éditions apportèrent des innovations limitées, par exemple celle de 1835, qui entérina l’orthographe en -nts (au lieu de -ns) des noms et adjectifs en -ent et -ant. Mais — indice de la résistance à l’innovation — la Revue Des deux Mondes persista jusqu’en plein xxe siècle à écrire des enfans et des dens ! Malgré les efforts de nombreux grammairiens (parmi lesquels Ferdinand Brunot, Gaston Paris et surtout Léon Clédat, qui alla jusqu’à publier sa revue en « ortografe simplifiée »), la France de la fin du xIxe et du xxe siècle n’a pas su se donner la réforme de l’orthographe qu’ont réalisée de nombreux autres pays : l’Allemagne, le Portugal, la Norvège, la Russie, sans parler de la Turquie qui, en 1928, substitua l’alphabet latin à l’alphabet arabe ! À l’époque contemporaine, aucun des projets diversement ambitieux n’a encore (1985) abouti. Seuls progrès dans la voie de la simplification : les décisions de l’Académie française en 1975, relatives notamment au tréma* et au trait d’union* et l’arrêté ministériel du 28-12-1976, qui admet certaines tolérances orthographiques, essentiellement pour les phénomènes d’accord*. Sans poser dans toute son ampleur le problème complexe des raisons de cette résistance obstinée à la réforme de l’orthographe, on se contentera de remarquer que la complexité de la graphie joue à la fois comme cause et comme effet du conservatisme : comme cause, dans la mesure où l’immensité du travail de réforme et, surtout, de ses conséquences pratiques, effraie les réformateurs et, surtout, les responsables (notamment économiques) de l’application d’une éventuelle réforme; comme effet, dans la mesure où l’évolution de la langue — continue, quoique, en synchronie*, peu perceptible — persiste à creuser l’écart entre sa manifestation orale et sa manifestation écrite.
D. Les graphèmes dans leur fonction distinctive : les logogrammes
Comme il a été dit, un certain nombre de graphèmes dépourvus de réalisation sonore ont pour fonction exclusive (ou principale, dans le cas des lettres étymologiques) de distinguer, dans l’écriture, des formes (mots et parfois groupes de mots) qui sont confondues dans leur manifestation orale. On voit que se pose ici le problème de l’homophonie*. Quand elle affecte les mots, elle prend la forme de l’homonymie*, qui, à son tour, présente deux aspects :
l’identité du signifiant peut atteindre les deux formes, écrite et orale, de la manifestation du mot. C’est le cas de vase (« récipient » et « boue ») ou de mousse (« jeune matelot » et « végétal » + « écume »). Cette situation est décrite à homonymie.
l’identité peut n’atteindre que la manifestation orale, les signifiants restant distincts dans l’écriture. Le français (comme l’anglais, mais à la différence, entre autres langues, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien, du finnois, etc.) présente un grand nombre de signifiants de ce type. Sans chercher à en donner une liste exhaustive (il existe des dictionnaires d’homonymes, de dimensions parfois roches de celles de ce livre !), on a relevé, dans le tableau qui suit, les plus intéressants et les plus fréquents d’entre eux. On les a classés selon le procédé de distinction utilisé : emploi des différents phonogrammes, en mettant à part les phénomènes d’accentuation graphique et de gémination de consonnes; emploi des lettres muettes : l’-e muet final, l’h initial, les consonnes muettes, finales ou internes, qui sont, selon le cas, étymologiques (ou pseudo-étymologiques) et/ou morphographiques; délimitation différente des unités.
Pour ne pas alourdir à l’excès ce tableau, on a procédé à deux simplifications :
quand le même couple de signifiants comporte plus d’une distinction graphique (par exemple, haleine/alêne) : h- + opposition ei/ê), on ne l’a fait généralement apparaître qu’une fois.
quand il existe plus de deux homophones distingués par l’orthographe (par exemple vin, vingt, vain, vainc, etc.), on n’a généralement tenu compte que de l’un des procédés utilisés, en énumérant à la suite, entre parenthèses, les signifiants distingués des premiers par d’autres procédés.
Remarque. — On notera ici, pour mémoire, qu’existe aussi la situation inverse de signifiants qui, distincts au niveau de l’oral, sont confondus au niveau de l’écrit. C’est par exemple le cas de fier ([fjDR], adjectif et [fie], verbe ou de fils [fil] (« brins ») et [fis] (« enfant mâle »). Cette situation, plus rare que la précédente, est décrite à homographie.
1. Utilisation des différents phonogrammes
1.1. Cas général
ancre, encre; arrhes, art (hart); ça, sa (ça, sas); ce, se; ces, ses, sais (sait, saie, c’est, s’est) ; camp, khan (quand, quant, qu’en) ; cahot, chaos; car, quart ; cet, sept (cette); cens, sens; cent, sent (sang, sans, c’en) ; chœur, cœur ; coke, coq (coque) ; cygne, signe ; dessein, dessin (des seins, des saints, etc.) ; écho, écot; et, est (à vrai dire souvent réalisé en [D]) ; faim, fin; héros, héraut ; hôtel, autel ; lire, lyre ; mes, mais (mets, met, m’est) ; mètre, maître (mettre) ; meurt, mœurs (toutefois 1’-s final est souvent prononcé) ; mot, maux ; non, nom (n’ont) ; ouate, watt ; pain, pin; paire, père (pair, pers, perd) ; palais, palet ; pan, paon ; panne, paonne ; panneau, paonneau ; panse, pense ; pansée, pensée ; pause, pose; peine, penne ; pic, pique ; poil, poêle (souvent réalisé [pwAl] ; prémices, prémisses; raisiné, résiné ; raisonner, résonner ; repaire, repère; sain, sein, ceint (seing, saint, cinq devant consonne) ; satire, satyre (ça tire, sa tire, s’attire(nt)) ; saut, seau, sceau, sot, Sceaux ; selle, scelle, celle; si, ci, (six devant consonne) ; tan, tant, taon, temps (t’en) ; tain, teint, thym ; té, thé; tante, tente; ton, thon; vain, vin, vainc, vint, (vingt, vins, vînt) ; vanter, venter ; ver, vair (vers, verre) ; voie, voua (voix).
1.2. Cas où l’opposition est exclusivement assurée par un accent dépourvu de manifestation orale
a (verbe), à (prép.) ; ça (pronom), ça (adverbe) ; croit (du verbe croire), croît (du verbe croître) ; cru (de croire et adject.), crû (de croître) ; des (art.), dés (pl. de dé), dès (prép.) ; du (art.), dû (de devoir) ; foret, forêt; la (art.), là (adv.) ; mur, mûr ; ou (conj.), où (adv.) ; pécher (et pécheur), pêcher (et pêcheur) ; il pèche (de pécher), pêche (de pêcheret « fruit ») ; prés (de pré), près (prép., souvent réalisé [pRD] ; sur (prép. et « acide »), sûr (« certain »).
On notera dans cette rubrique l’abondance et l’importance des oppositions entre morphèmes grammaticaux.
1.3. Cas des consonnes doubles
balai, ballet; cane, canne; cote, cotte; date, datte; dégoûtant, dégouttant; détoner, détonner; ère, erre; tête, tette; tome, tomme.
2. Utilisation des lettres muettes
2.1. -e muet final
cru (adjectif), crue (nom) ; dur, dure (de durer) ; fait (souvent prononcé [fDt]), faîte; foi, foie ; lai, laie (remarquer que foi et laie sont féminins, foie et lai masculins) ; heur, heure ; ni (conj.), nie (de nier) ; pair, paire ; par, pare (de parer) ; soi, soie; tu (pron.), tue (de tuer) ; voir, voire (adv.).
On remarque que le -e muet final est assez peu utilisé avec la fonction de distinction de morphèmes lexicaux : c’est la contrepartie de son utilisation extensive comme morphogramme (voir plus haut).
2.2. h- initial
hache, ache (« plante ») ; haie, aie (d’avoir) ; haine, aine ; haire, aire ; haleine, alêne; hallier, allier ; halo, allô; haltère, altère (d’altérer) ; hanche, anche ; hanse, anse ; haras, aras (« perroquets ») ; hart (« corde »), art; hauteur, auteur ; hé, eh (interjections) ; hère, ère ; hêtre, être ; ho, oh, ô (interjections) ; hors, ors, or ; hospice, auspices ; hôte, ôte (de ôter) ; hune, une.
La fonction distinctive de l’h-initial — encore relativement importante — l’était plus encore avant l’introduction, à la fin du xvie siècle, des « lettres hollandaises » j et v, jusqu’alors notées respectivement par i et u. L’h initial fut en effet utilisé pour distinguer par exemple huile de vil(l)e noté par uile ou huit de vit noté par uit. Cet h-initial, bien que non étymologique, a subsisté non seulement dans les deux mots cités, mais encore dans plusieurs autres mots (huis, huître) quoique l’introduction du v lui ait fait perdre sa fonction distinctive : même sans h-, *uit resterait distinct de vit.
2.3. Consonnes muettes
2.3.1. Consonnes muettes finales
ban, banc ; bas, bât; bon, bond ; champ, chant ; chat, chas ; coin, coing ; cor, corps ; cou, coup, coût ; cour, cours, court ; crois, croix, (croît) ; do, dos ; donc (-c non prononcé après impérat. ou dans une phrase négat.), dont, don ; fait, faix ; fier, fiert (de férir) ; foi, fois ; fond, fonds, font, fonts ; heur, heurt ; houe, houx ; lai, laid, lais, legs, les; lie (de lier), lit (de lire et « meuble ») ; mas, mât; moi, mois ; mors, mords, mord, mort ; mou, moût ; on (pronom), ont (d’avoir) ; pare, part ; peu (adv.), peut (de pouvoir), (peuhï) ; plan, plant ; point, poing ; poids, pois, poix, (pouah!) ; porc, port, (pore) ; pou, pouls ; prêt, près ; puits, puis; rat, raz ; sein, seing ; si, six (s’y) ; son (déterm. et nom), sont; tord, tort ; vingt, vint ; ver, vers, vert.
2.3.2. Consonnes muettes internes
comte, compte, (conte) ; conter, compter ; comté, compté (conté) ; seller, sceller ; scène, cène ; scie, si ; scieur, sieur.
Une analyse détaillée de l’ensemble de ces cas montrerait que les lettres muettes étymologiques ont le plus souvent, en plus de leur fonction distinctive (logographique), une fonction morphographique, soit au niveau de la grammaire (le -t de court — du lat. curtum — marque la relation avec le féminin courte), soit au niveau du lexique (le -p de champ — du lat. campum — marque la relation avec le dérivé champêtre). Il n’est pas jusqu’au -d- de poids qui, bien que non étymologique (latin pensum, et non pondus), n’ait une fonction morphographique en marquant la relation, synchroniquement pertinente, avec pondéral, pondéré, etc.
3. Délimitation différente des unités
On atteint ici le domaine où l’homophonie concerne non plus des unités, mais des groupements d’unités. On ne citera évidemment, parmi l’infinité des réalisations possibles, qu’un nombre très réduit d’exemples spécialement fréquents et importants du point de vue grammatical :
autour de, au tour de; aussitôt, aussi tôt (oh ! si tôt !) ; bientôt, bien tôt ; plutôt, plus tôt ; sans, c’en, s’en ; davantage, d’avantage ; laid (et ses homophones, voir plus haut), l’est, l’aie, l’ait, l’ai, l’es, etc. ; la, l’a, l’as ; ma, m’a, m’as ; mes, m’est, m’ait, etc. ; ni, n’y ; quand (et ses homophones), qu’en ; quelque, quel(s) que, quelle(s) que ; quoique, quoi que; ta, t’a ; tes, t’est (fam. t’es pour tu es), etc. ; tous (avec -s prononcé, voir indéfinis), tout ce ; etc.
Compte tenu de l’aspect spécifique que lui confère son orthographe dans ses relations avec sa prononciation, le français est réputé pour l’une des langues qui se prêtent le mieux à certains types de jeux de mots fondés sur l’identité des signifiants oraux, mais bloqués dès qu’apparaît la manifestation écrite. Certains de ces jeux de mots ont été rendus célèbres par un texte littéraire. Ainsi l’anecdote du jeune Rousseau décryptant la devise tel fiert qui ne tue pas en distinguant fiert, forme du vieux verbe férir (« frapper », cf. sans coup férir) de l’adjectif fier ; ou le débat autour de ou/où dans le mariage de Figaro. D’une façon générale, l’homophonie semble particulièrement fréquente en français. D’où la facilité de pratiques ludiques telles que le rébus — par exemple la représentation figurée d’un cygne pour signe — et l’exploitation littéraire de ces pratiques chez de nombreux écrivains de la modernité (Jarry, Mallarmé, Roussel, Desnos, Prévert, etc.) et chez ceux des psychanalystes pour qui « l’inconscient est structuré comme un langage » (Lacan).
Grevisse M., Le bon usage : grammaire française avec des remarques sur la langue française d’aujourd’hui
Emploi des signes de ponctuation et des signes typographiques
1058. La ponctuation (étym. — Ponctuation, dérivé de ponctuer, qui est emprunté du bas latin punctuare, dérivé de punctum, point.) est l’art d’indiquer dans le discours écrit, par le moyen de signes conventionnels, soit les pauses à faire dans la lecture, soit certaines modifications mélodiques du débit, soit certains changements de registre dans la voix.
La ponctuation est, selon le mot de F. Gregh, la respiration de la phrase. Bien des gens la négligent ; c’est à tort, car la ponctuation est un élément de clarté : elle permet de saisir l’ordre, la liaison, les rapports des idées.
Remarque. — L’usage laisse une certaine latitude dans l’emploi des signes de ponctuation. Tel écrivain multiplie les virgules, les points-virgules, les deux points, les tirets ; tel autre n’en use qu’avec modération, laissant au lecteur le soin de faire, aux endroits voulus, certaines pauses demandées par le sens et les nuances de la pensée.
A noter que certains poètes modernes (Apollinaire et d’autres après lui) ne mettent, par principe, aucune ponctuation dans leurs vers1.
1059. Les signes de ponctuation et les signes typographiques sont : le point (.), le point d’interrogation (?), le point d’exclamation (!), la virgule (,), le point-virgule (;), les deux points (:), les points de suspension (...), les parenthèses ( ), les crochets [ ], les guillemets (« »), le tiret (—), l’astérisque (*) et l’alinéa2.
Hist. — Chez les Grecs, la ponctuation n’était pas usitée à l’époque classique ; souvent même les mots n’étaient pas séparés les uns des autres. C’est Aristophane de Byzance (IIe siècle av. J.-C.) qui imagina la première ponctuation nette et précise ; ce grammairien employait trois signes : le point parfait, en haut (•), le point moyen, au milieu, et le sous-point, en bas (.). Ces trois signes correspondaient respectivement à notre point, à notre point-virgule et à nos deux points. — Les signes de ponctuation enseignés dans les écoles de l’antiquité n’étaient d’ailleurs pas employés dans la pratique, si ce n’est que le point se plaçait souvent après chaque mot pour le séparer du suivant, comme cela peut se voir dans les inscriptions latines.
C’est au IXe siècle que l’on commença de faire usage de la ponctuation ; encore cette ponctuation fut-elle mise fort irrégulièrement jusqu’au XVIe siècle. C’est au XVIe siècle, en effet, après l’invention de l’imprimerie, que notre système moderne de ponctuation, dans son ensemble, s’est fixé et développé. Il comprenait alors la virgule, le point, les deux points et le point d’interrogation. On ne tarda pas à ajouter à ces signes les guillemets et le trait d’union. Au XVIIe siècle, on introduisit l’alinéa, le point-virgule, et le point d’exclamation. L’usage des points de suspension date de la fin du XVIIIe siècle, et celui du tiret et des crochets, du XIXe siècle.
Ajoutons qu’un point d’ironie, imaginé et employé par Alcanter de Brahm (1868-1942), n’a pas rencontré de succès.
P. Claudel a préconisé (et employé dans certains de ses ouvrages) une disposition typographique qu’il appelle « pause » et qui consiste à laisser dans certaines phrases de petits intervalles en blanc. « Les points et les virgules, déclarait-il, ne donnent en effet qu’une articulation de la phrase grossière et purement logique. Sans nécessité grammaticale, il y a dans le discours des pauses et des arrêts qui sont absolument indispensables au sens. » (Dans la Corresp. Claudel-Gide, p. 71.)
1. — Le Point.
1060. Le point indique la fin d’une phrase. Il se place aussi après tout mot écrit en abrégé1 :
En Jeanne d’Arc se reflète un village lorrain. Il est possible qu’elle soit celtique, Elle est sûrement catholique. Inutile après tout de songer à la femme celtique, il y a la vierge Marie (M. barrés, Mes Cahiers, t. XII, p. 161). — P.T.T. (Postes, Télégraphes, Téléphones). — T.S.F. — Chap. II, p. 95. — Etc. (et cetera2).
Remarque. — Les écrivains contemporains emploient parfois le point (au lieu de la virgule) pour détacher d’une proposition principale une proposition subordonnée ou un membre de phrase auxquels ils veulent donner un relief plus accusé :
Mais tout de même, il n’y avait plus de joie, nulle part, et plus d’illusions. Ni de fleurs (H. lavedan, Madame Lesoir, t. I, p. 13). — On avait donné dans le Nord un grand coup de pied dans la fourmilière, et les fourmis s’en allaient. Laborieusement. Sans panique. Sans espoir. Sans désespoir. Comme par devoir (saint-exupéry, Pilote de guerre, p. 111). — Elle reste muette devant ce monde de l’inutile qu’il lui découvre. Dont la beauté l’humilie. La trouble (J. benda, Songe d’Éleuthère, p. 65).
2. — Le Point d’interrogation.
1061. Le point d’interrogation s’emploie après toute phrase ex primant une interrogation directe :
Et toi, vis-tu ? Est-il possible que tu vives loin de moi ? Ne souffres-tu pas sans cesse d’une intolérable angoisse ? (E. jaloux, La Branche morte, p. 89.)
Quand une citation ou une exclamation dépendent d’une phrase interrogative, elles s’introduisent par les deux points et se terminent par le point qu’elles auraient, si elles étaient indépendantes : Vous rappelez-vous les mots désespérés de don Diègue : « O rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie ! »
Remarques. — 1. L’interrogation indirecte n’est jamais suivie du point d’interrogation : Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. — Pilate demandait ce qu’était la vérité.
2. Quand une phrase interrogative est suivie d’une incise (dit-il, répondit-il, etc.), on met le point d’interrogation immédiatement après la phrase interrogative : A quoi bon si vite ? balbutiai-je (A. hermant, Xavier, p. 162). — Vous iriez voir mon fils ? me demanda-t-il d’une voix presque indistincte (Fr. ambrière, Le Solitaire de la Cervara, p. 31).
3. — Le Point d’exclamation.
1062. Le point d’exclamation se met après une exclamation, qui peut être une simple interjection, une locution interjective, une proposition :
Hélas ! — J’ai souffert, hélas ! tous ces maux. — O dieux hospitaliers ! — Holà ! Holà ! mon cher notaire, vous vous pressez trop (R. rolland, Les Léonides, II, 3). —Je l’entendais dire tout bas en sanglotant : « Oh ! la canaille ! la canaille ! » (A. daudet, Contes du Lundi, p. 222.) — Vous oseriez renier votre parole !
Remarques. — 1. L’interjection ô ne s’emploie jamais seule ; le point d’exclamation se met non après ô, mais après l’exclamation complète : Ô douleur ! ô regret ! (Ac.) — ô le malheureux d’avoir fait une si méchante action ! (Id.)
2. Quand ô marque le vocatif, on peut faire suivre d’un point d’exclamation l’expression mise en apostrophe : O mer ! Éparpillée en mille mouches sur Les touffes d’une chair fraîche comme une cruche (P. valéry, Poésies, p. 45). — Ne crois pas, ô poète! que ta chanson soit vaine. — Mais souvent aussi, dans ce cas, on remplace le point d’exclamation par une simple virgule : Ne crois pas, ô poète, que ta chanson soit vaine. — Nous ne te lâcherons pas, ô bienheureux, tant que tu ne nous auras pas répondu (A. hermant, Xavier, p. 137). — Mais avec mes périls, je suis d’intelligence, Plus versatile, ô Thyrse, et plus perfide qu’eux (P. valéry, Poésies, p. 77).
3. Dans les locutions interjectives eh bien ! eh quoi ! hé bien ! hé quoi ! le point exclamatif se met après la locution complète, non après le premier élément: Hé quoi ! votre haine chancelle ? (Rac., Androm., IV, 3.) — Comment j’ai fait? Eh bien!... j’ai glissé... (É. henriot, Aride Brun, III, 1).
4. — La Virgule.
1063. La virgule (étym. — Virgule, empr. du latin virgula, petite verge, d’après la forme primitive de ce signe.) marque une pause de peu de durée.
A. — Dans une proposition, la virgule s’emploie :
1° En général, pour séparer les éléments semblables (sujets, compléments, épithètes, attributs) non unis par une conjonction de coordination : Les honneurs, les richesses, les plaisirs nous rendent-ils pleinement heureux ? — La charité est douce, patiente, bienfaisante. — On aime la compagnie d’un homme bon, juste, affable. — Il avait appris seul à nager, à plonger, à lancer le tri dent (É. peisson, Les Écumeurs, p. 103).
Remarques. — 1. Quand un verbe a plusieurs sujets, si le dernier est joint au précédent par et, on ne le sépare pas du verbe par la virgule :
L’injustice, le mensonge et l’ingratitude m’inspirent de l’horreur. — À midi, lapins, lièvres, perdreaux et faisans formaient un assez joli tas (Fr. ambrière, Le Solitaire de la Cervara, p. 142).
Si le dernier sujet est simplement juxtaposé au précédent, on ne le sépare pas du verbe par la virgule :
La paresse, l’indolence, l’oisiveté consument beaucoup de belles énergies. — Un mot, un regard, un geste, un silence, une combinaison atmosphérique l’avaient tenue sous le charme (A. dumas f., Un Père prodigue, Préf.). — Les sacs, les bottes, Us bocaux occupaient les deux murs latéraux (J. romains, Les Hommes de b. vol., t. V, p. 16). — Les montagnes, le ciel, la mer sont comme des visages (A. camus, Noces, p. 25). — Ces paroles, cette menace me déchiraient (M. arland, Terre natale, p. 21). — Le nez, la bouche étaient puissants (vercors, Les Yeux et la Lumière, p. 231).
Mais cet usage n’est pas impérieux, et l’on met parfois la virgule : L’Inde, la Perse, l’Asie Mineure, l’Afrique, sont représentées par des meubles, des stores, des tentures... (R. bazin, Terre d’Espagne, p. 213). — Une confidence, un souvenir, une simple allusion, ouvrait des perspectives insoupçonnées (R. martin du gard, Les Thibault, III, 2, p. 138). — Tuyaux épais, tiges, chaînes, fils, poutres, poutrelles, manches à vent, leviers, commandes, composaient, tout autour de ces créatures étranges, comme des racines de fer qui les garrottaient (H. Bosco, Un Rameau de la nuit, pp. 63-64).
2. Si les sujets forment une gradation ou sont résumés par un mot, cet ensemble ne doit pas être séparé du verbe par la virgule :
Un souffle, une ombre, un rien lui donnait la fièvre. — Un souffle, une ombre, un rien, tout met le lièvre en alarme. — Et tout de suite, sac, couverture, chassepot, tout disparut dans le grand cabriolet (A. daudet, Contes du Lundi, p. 41).
3. On ne sépare pas par la virgule les différentes parties d’une somme :
Une dépense de vingt francs cinquante centimes. L’espace parcouru en deux heures dix minutes trente secondes.
Dans les nombres écrits en chiffres, la virgule s’emploie uniquement pour séparer de la partie entière la partie décimale : 2 693,25 ; 0,275 42.
4. En principe, on ne sépare pas par la virgule les éléments coordonnés par et, ou, ni1 :
La richesse et les honneurs séduisent bien des hommes. — 7/s veulent vaincre ou mourir. — Ni Corneille ni Racine n’ont encore été surpassés (Sainte-Beuve, Caus. du Lundi, t. IX, p. 318).
Mais quand et, ou, ni servent à coordonner plus de deux éléments, on sépare ces éléments l’un de l’autre par la virgule :
Et les champs, et les bois, et les monts, et les plaines, s’éclairaient brusquement. — Il arrivait que, soudain, l’un de ces chiffonniers contraints aperçût une commode, ou une potiche, ou un secrétaire de bois de rosé (G. duhamel, Cri des profondeurs, p. 182).
— Un bon financier, dit La Bruyère, ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni ses enfants.
2° Pour séparer tout élément ayant une valeur purement explicative :
Saint-Malo, riche cité de pierre, ramassée sur son Ile entre ses nobles remparts était vers 1740 une ville prospère, vigoureuse et hardie (A. maurois, Chateaubriand, p. 14).
N. B. — Le complément d’objet, direct ou indirect, ne se sépare jamais du verbe par la virgule : La lecture procure un plaisir délicat, — La fortune sourit aux audacieux.
3° Après le complément circonstanciel placé en tête de la phrase, s’il a une certaine étendue :
Sur tous les coteaux d’alentour, le père de ces petits Peyral possédait des bois, des vignes, où nous devînmes les maîtres absolus (P. loti, Le Roman d’un enfant, XLIV). — Dans les champs, c’était une terrible fusillade. À chaque coup, je fermais les yeux (A. daudet, Contes du Lundi, p. 290).
Remarques. — 1. En principe, on ne met pas la virgule si le complément circonstanciel en inversion est très court : Ici nous trouverons le calme et le silence. — Quand le complément circonstanciel en inversion est suivi immédiatement du verbe, on le sépare facultativement par la virgule (mais s’il est très court, en principe, on ne met pas la virgule) :
Devant l’entrée, gisaient des amas de débris monstrueux (P. loti, La Galilée, p. 191). — Lentement, le long des maisons de la rive, glissaient ses trois mâts [d’un voilier] (H. Bosco, Un Rameau de la nuit, p. 39). -— Par la fenêtre, entrait un rayon de soleil (H. troyat, Étrangers sur la terre, p. 511). — Vers le milieu de la pièce, plus près des fenêtres, régnait une très grande table (J. romains, Les Hommes de b. vol., t. VII, p. 285). — Sur une des chaises traînait une robe de chambre usagée (Id., ibid.). — Partout régnait un profond silence.
2. En principe, on ne met pas la virgule après le complément d’objet indirect ou après le complément déterminatif en inversion : A un tel homme comment désobéir ? — D’un pareil adversaire les attaques sont redoutables.
3. Il ne faut pas omettre la virgule après le nom du lieu dans l’indication de la date : Paris, le 5 janvier...
4° Pour isoler les mots qui forment pléonasme ou répétition : Rompez, rompez tout pacte avec les méchants. — Je vous assure, moi, que cela est.
5° Pour isoler les mots mis en apostrophe : Observe, Phèdre, que le Démiurge, quand il s’est mis à faire le monde, s’est attaqué à la confusion du Chaos (P. valéry, Eupalinos, p. 120).
B. — Dans un groupe de propositions, on emploie la virgule :
1° En général, pour séparer plusieurs propositions de même nature non unies par une conjonction de coordination :
On monte, on descend, on débarque les marchandises (É. peisson, Les Écumeurs, p. 103). — Il y a des gens qui cachent leurs passions, qui entendent leurs intérêts, qui y sacrifient beaucoup de choses, qui s’appliquent à grossir leur fortune.
2° Avant les propositions introduites par les conjonctions de coordination autres que et, ou, ni :
Même je me suis arrêté de souhaiter franchement cette vie, car j’ai soupçonné qu’elle deviendrait vite une habitude et remplie de mesquineries (M. barrés, Un Homme libre, p. 12). — Il ne faut pas faire telle chose, car Dieu le défend (Ac.). — Il est fort honnête homme, mais il est un peu brutal (Id.). — Je pense, donc je suis.
Remarque. — Les conjonctions et, ou, ni ne sont pas, en général, pré cédées de la virgule :
Il croit et il espère. Je ne le plains ni ne le blâme. — Il ne faut ni s’en étonner ni s’en indigner (J. lemaitre, Jean Racine, p. 186). — J’ignore s’il restera ou s’il partira. La philosophie stoïcienne enseigne que toutes les fautes sont égales et que tous les mérites se valent.
Cependant les conjonctions et, ou, ni sont précédées de la virgule quand elles servent à coordonner plus de deux propositions ou encore quand elles joignent deux propositions qui n’ont pas le même sujet, ou qui s’opposent l’une à l’autre, ou que l’on disjoint pour quelque raison de style : Je ne veux, ni ne dois, ni ne puis obéir. — La tempête s’éloigne, et les vents sont calmés (musset, Le Saule, II). — L’ennemi est aux portes, et vous délibérez ! Nous vaincrons, ou nous mourrons !
3° Avant les propositions circonstancielles ayant une valeur simplement explicative : Je le veux bien, puisque vous le voulez (Ac.).
Mais, dans des phrases telles que les suivantes, on ne met pas la virgule, parce que la proposition circonstancielle est intimement liée par le sens à la principale et qu’aucune pause n’est demandée : Il est tombé parce que le chemin est glissant (Ac.). — J’irai le voir avant qu’il parte (Io.). — J’irai vous voir quand je pourrai (Id.). — Je ne puis parler sans qu’il m’interrompe (Io.).
4° Après les propositions circonstancielles placées en tête de la phrase :
Quand la démission de l’ambassadeur fut publique, la presse ministérielle attaqua Chateaubriand (A. maurois, Chateaubr., p. 397). — S’il pensait me mortifier par cette pratique, il y a pleinement réussi (G. duhamel, Cri des profondeurs, p. 31).
5° Pour isoler une proposition relative explicative :
Bérénice, qui attendait son amie de Nîmes, ne tarda pas à nous quitter (M. barrés, Le Jardin de Bérénice, p. 77).
Remarque. — La proposition relative déterminative ne se sépare pas de l’antécé dent par une virgule, mais si elle est assez longue, on la fait suivre de la virgule : La vertu dont nous parlons le plus volontiers est quelquefois celle qui nous manque le plus. — L’homme qui ne pense qu’à soi et à ses intérêts dans la prospérité, restera seul dans le malheur.
6° Pour séparer la proposition participe absolue ou la proposition incise :
La pèche finie, on aborda parmi les hautes roches grises (A. daudet, Contes du Lundi, p. 275). — // devrait, toute honte cessant, enfourcher un âne (taine, Voy. aux Pyrén., p. 213).
7° Pour marquer l’ellipse d’un verbe ou d’un autre mot énoncé dans une proposition précédente :
Les grands yeux étaient éteints et mornes, les paupières, striées de rides, les commis sures des narines, marquées de plis profonds (E. jaloux, La Branche morte, p. 112).
Cependant on ne met pas la virgule si aucune équivoque n’est à craindre et si aucune pause n’est demandée : Parmi les contemporains, les uns le trouvaient [Pyrrhus] trop violent et trop sauvage, et les autres trop doucereux (J. lemaitre, Jean Racine, p. 150).
5. — Le Point-virgule.
1064. Le point-virgule marque une pause de moyenne durée. Il s’emploie pour séparer dans une phrase les parties dont une au moins est déjà subdivisée par la virgule, ou encore pour séparer des propositions de même nature qui ont une certaine étendue :
Le devoir du chef est de commander ; celui du subordonné, d’obéir. — Ce que nous savons, c’est une goutte d’eau; ce que nous ignorons, c’est l’océan.
6. — Les Deux points.
1065. Les deux points s’emploient :
1° Pour annoncer une citation, une sentence, une maxime, un discours direct, ou parfois un discours indirect :
Montaigne dit quelque part dans ses « Essais » : « N’est rien où la force d’un cheval se connaisse mieux qu’à faire un arrêt rond et net ». (A. siegfried, Savoir parler en public, p. 183.)
2° Pour annoncer l’analyse, l’explication, la cause, la conséquence, la synthèse de ce qui précède :
Je finis cependant par découvrir trois documents : deux imprimés, un manuscrit (H. Bosco, Un Rameau de la nuit, p. 112). — Ne riez pas : Molière lui-même trouverait que cette chanson-là vaut bien cette du roi Henry (A. hermant, Savoir parler, p. 63). — Ce ne sont pas des idées que je leur demande : leurs idées sont le plus souvent fumeuses (G. duhamel, Cri des profondeurs, p. 71).
7. — Les Points de suspension.
1066. Les points de suspension indiquent que l’expression de la pensée reste incomplète pour quelque raison d’ordre affectif ou autre (réticence, convenance, émotion, brusque repartie de l’interlocuteur, etc.) ; parfois ils marquent une pause destinée à mettre en valeur le caractère de ce qu’on ajoute1 :
Maubrun : Si le marquis... La Marquise : Le marquis est le plus honnête et le meilleur homme du monde (J. lemaitre, Le Député Leveau, I, 3). —J’ai reçu ce matin une lettre de Bertrand... Je voulais vous la montrer; il est follement heureux chez vous... Il me parle de votre mère... Cela ne m’étonne pas qu’elle soit bonne et charmante... Tenez, il faut que vous lisiez... Il a déjà monté votre poney... Il est émerveillé! (Fr. mauriac, Asmodée, III, 10.) — Ma parole ! dit la mère avec une admiration tendre, on te donnerait vingt ans. Quand je pense que tu viens d’en avoir dix-sept... (Fr. ambrière, Le Soli taire de la Cervara, p. 120). — L’abbé Martin était curé... de Cucugnan (A. daudet, Lettres de mon moulin, p. 125). — Cette publication mensuelle parais sait... quelquefois (E.-M. de vogué, Le Roman russe, p. 264). — Les livres recommandés par... les autres, sont rarement à notre goût (A. gide, Journal 1942-1949, p. 149).
Parfois les points de suspension indiquent simplement une sorte de prolongement inexprimé de la pensée : Et bientôt, elle a même disparu tout à fait, celte ville rosé noyée dans les verts printaniers ; on doute si réellement on l’a aperçue ; plus rien, que les profondes ramures qui la gardent... (P. loti, La Galilée, p. 129). —-C’est à partir de Khartoum que je voudrais remonter le Nil... (A. gide, Journal 1942-1949, p. 248).
8. — Les Parenthèses. Les Crochets.
1067. Les parenthèses (étym. — Parenthèse, empr. du lat. parenthesis, action de mettre.) s’emploient pour intercaler dans la phrase quelque indication, quelque réflexion non indispensable au sens, et dont on ne juge pas opportun de faire une phrase distincte :
Il y a de Balzac (brochure de H. Favre, p. 124) une lettre sur la jeunesse qui ne respecte rien, ne coupe pas les têtes, mais les ravale (M. barrés, Mes Cahiers, t. XII, p. 63). — L’épouvante (elle vit naturellement dans un pareil monde), l’épouvante elle-même surgit d’une fiction (H. Bosco, Un Rameau de la nuit, p. 62).
L’ensemble des mots placés entre parenthèses porte le nom de parenthèse. Ouvrir la parenthèse, c’est placer le premier des deux signes ; fermer la parenthèse, c’est placer le second.
Remarque. — Si, à l’endroit où se place la parenthèse, la phrase demande un signe de ponctuation, ce signe se met après que l’on a fermé la parenthèse (voir ci-dessus l’exemple de H. Bosco).
1068. Les crochets servent au même usage que les parenthèses, mais ils sont moins usités. On les emploie surtout pour isoler une indication qui contient déjà des parenthèses : Chateaubriand s’est fait l’apologiste du christianisme [cf. Génie du Christianisme (1802)].
On emploie aussi les crochets pour enfermer les mots qui, dans un texte, ont été rétablis par conjecture : Il a adopté nos péchés, et nous a [admis à son] alliance ; car les vertus lui sont [propres et les] péchés étrangers (pascal, Pens., 668).
9. — Les Guillemets.
1069. Les guillemets (Guillemet : peut-être tiré du nom de celui qui aurait inventé ce signe : Guillemet ou Guimet (selon Ménage) ou Guillaume (selon le Dictionn. des Arts et Métiers) s’emploient au commencement et à la fin d’une citation, d’un discours direct, d’une locution étrangère au vocabulaire ordinaire ou sur laquelle on veut attirer l’attention1. Dans le passage guillemeté, on se contente ordinairement de placer les guillemets au début de chaque alinéa et à la fin du dernier ; parfois on met les guillemets au commencement de chaque ligne ou de chaque vers :
On pense involontairement à la chanson de la tante Boisteilleul : « Un épervier aimait une fauvette... » (A. maurois, Chateaubriand, p. 137). — Maintenant, ils trouvaient dans tout ce qu’il avait écrit des traces de « bochisme » (R. rolland, Clerambault, p. 147). — La mode est en train de gagner la France de ces publications que l’on nomme des « digests » dans le monde anglo-saxon (G. duhamel, Tribulations de l’espérance, p. 594). — Les bonheurs profonds qu’il avait découverts pouvaient-ils passer pour un simple « amusement » ? (Fr. ambrière, Le Solitaire de la Cervara, p. 121.) — L’accusé déclara qu’il « travaillait » dans le cambriolage et dans le vol à main armée.
Remarques. — 1. Lorsque, dans le texte guillemeté, vient s’insérer un pas sage de l’auteur qui cite, les guillemets se ferment avant ce passage et se rouvrent après, à moins qu’il ne soit de peu d’étendue : dit-il, répondit-il, etc.
2. Si le passage guillemeté, considéré isolément, demande après lui un signe de ponctuation, celui-ci se place avant les derniers guillemets : Mais quand le bois ne contenait pas de nœuds, il opinait : « On les aura ! » (G. duhamel, Civilisation, p. 33.) — Il demanda : « Que faites-vous ici ? » Je répondis : « J’attends le départ. »
Autrement, la ponctuation se place après les derniers guillemets : M. Fellaire se donna beaucoup de mal pour échauffer « son cher insulaire, son très honorable gendre ». (A. france, Jocaste, p. 53.) — Musset ne s’est-il pas moqué de la « boutique romantique » ? — Quel homme que ce « Père la Victoire » !
3. Quand on s’adresse à des auditeurs (à la radio ou à la télévision, par exemple), si l’on vient à citer un texte, on en marque le début par je cite, et on le clôt par fin de citation; formules correspondant, la première à des guillemets ouvrants, la seconde à des guillemets fermants.
Dans l’imprimerie, on met généralement en caractères italiques — parfois aussi en caractères espacés — les mots sur lesquels on veut attirer l’attention.
10. — Le Tiret.
1070. Le tiret s’emploie dans un dialogue pour indiquer le changement d’interlocuteur ; il se met aussi, de la même manière que les parenthèses, avant et après une proposition, un membre de phrase, une expression ou un mot, qu’on veut séparer du contexte pour les mettre en valeur :
Il rattrapa Louvois :
Dites. Quel âge a-t-il à peu près ?
Dans les trente à trente-cinq.
Pas plus ? Vous êtes sûr ?
Non (J. romains, Les Hommes de b. vol., t. VII, p. 244).
Ainsi — et ce point réservé que nul poète ne fut plus grand par l’imagination et par l’expression — sous quelque aspect que nous considérions Victor Hugo, nous lui voyons des égaux et des supérieurs (J. lemaitre, Les Contemp., t. IV, p. 149). — Les mœurs se sont adoucies, et il ne pouvait être question de mettre à mort les élèves — irresponsables — de ce mauvais plaisant de M. Paul (A. hermant, Savoir parler, p. 83). — Après tout, ce jeune homme ne mérite aucun reproche — à moins que ce ne soit un crime d’avoir vingt ans et de marquer plus que son âge... (Fr. mauriac, Asmodée, II, 2). — Il me fallut plusieurs jours de travail — et de travail soigné, utile — pour me faire une raison (H. Bosco, Un Rameau de la nuit, p. 106).
Remarque. — Parfois le tiret se place après une virgule, comme si l’on estimait que cette virgule indique trop faiblement la séparation qu’on veut marquer1 :
Je voudrais essayer de dire maintenant l’impression que la mer m’a causée, lors de notre première entrevue, — qui fut un bref et lugubre tête-à-tête (P. loti, Le Roman d’un entant, IV). — Figurez-vous que cette dinde avait porté tout cet argent, — cet argent en somme qui n’était plus à elle et qu’elle m’avait promis, — au bazar, en se faisant indignement voler naturellement, pour acheter de la parfumerie ! (P. claudel, Figures et Paraboles, pp. 30-31.) — Nous savons aussi qu’une grande nation est, d’abord, — oh ! ne nous lassons pas de le répéter, — une nation capable de produire de grands hommes (G. duhamel, Tribulations de l’espérance, p. 52). — Le piéton, — qu’il soit tel par plaisir ou par nécessité — devra tant bien que mal s’aventurer dans ce concert des puissances furieuses (Id., Manuel du protestataire, p. 131).
11. — L’Astérisque.
1071. L’astérisque (étym. — Astérisque, empr. du lat. asteriscus, proprement « petite étoile ») est un petit signe en forme d’étoile qui indique un renvoi ou qui, simple ou triple, tient lieu d’un nom propre qu’on ne veut pas faire connaître, sinon parfois par la simple initiale :
Il allait chez madame de B*** (musset, Confess., III, 5). — A la sœur Louise au couvent de *** (Id., On ne badine pas avec l’amour, III, 2). — Les trains ne vont pas plus loin que S* (J. de lacretelle, La Bonifas, XI).
Dans les ouvrages philologiques, l’astérisque placé devant un mot indique qu’il s’agit d’une forme supposée : Accueillir. Lat. pop. *accoligere (bloch-wartburg, Dict. étym., s. v.). — Ce n’est pas par une simple évolution phonétique que upupa est devenu huppe en français ; il n’aurait pu aboutir qu’à *ouppe (M. grammont, Traité de Phonet., p. 401).
12. — L’Alinéa.
1072. L’alinéa (étym. — Alinéa, empr. du lat. a linea, en s’écartant de la ligne) marque un repos plus long que le point. C’est une séparation qu’on établit entre une phrase et les phrases précédentes, en la faisant commencer un peu en retrait à la ligne suivante1, après un petit intervalle laissé en blanc.
L’alinéa s’emploie quand on passe d’un groupe d’idées à un autre groupe d’idées.
On donne aussi le nom d’alinéa à chaque passage après lequel on va à la ligne.
Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R., Grammaire méthodique du français, P., PUF, 1994
La grammaire dans tous ses états
2.1. Il y a grammaire et grammaires
Une grammaire, c’est d’abord un « livre, traité, manuel de grammaire » (Petit Robert). Mais c’est aussi au sens du terme tel qu’il est employé dans la paraphrase définitoire précédente une matière d’enseignement et une activité scolaire. Cette deuxième acception courante apparaît dans les expressions faire de la grammaire, un cours de grammaire et être bon/nul en grammaire où le terme renvoie à la transposition didactique d’une discipline scientifique, la linguistique, parfois encore appelée grammaire.
Ce dernier usage renoue avec une tradition ancienne qui remonte à la Grammaire générale et raisonnée d’Arnauld et Lancelot [1660] et même au-delà, aux Summae Grammaticae du Moyen Age et à toutes les Artes Grammaticae de l’Antiquité. Elle se poursuit jusqu’à l’avènement de la philologie historique à la fin du XIXe siècle, pour renaître sous la forme plus moderne de la grammaire générale entendue comme la science générale du langage (2.2). Les terminologies linguistiques d’inspiration générativiste ajoutent encore à la polysémie du mot en l’appliquant aussi bien à l’organisation implicite d’une langue qu’à sa description sous la forme d’une construction théorique.
Bibliographie. — J.-L. Chiss, La grammaire entre théorie et pédagogie. Langue française, 41, 1979, p. 49–59 – B. Combettes, J.-P. Lagarde, Un nouvel esprit grammatical, Pratiques. 33, 1982, p. 13-25 – N. Flaux, La grammaire, puf, 1993 (« Que sais-je ?») – F. François, L’enseignement et la diversité des grammaires. Hachette, 1974.
On distinguera également trois conceptions techniques concurrentes (mais non indépendantes) du terme grammaire :
► Toute langue présente un ensemble de régularités qui président à la construction, à l’usage et à l’interprétation des énoncés. Les locuteurs apprennent, puis appliquent ces principes d’organisation qui constituent la grammaire immanente à la langue. Il s’agit donc de l’ensemble des propriétés intrinsèques d’une langue et que l’on appelle aussi son système.
► Tout locuteur dispose d’une grammaire intériorisée de sa langue, dont il n’a pas conscience, mais qui lui permet de produire et d’interpréter des énoncés et par rapport à laquelle il juge intuitivement si un énoncé est bien ou mal formé.
► La grammaire intériorisée qui conditionne notre pratique langagière ne se décrit clairement qu’au terme d’observations et d’analyses minutieuses, qui sous leur forme achevée et synthétique constituent une grammaire-description (ou grammaire-théorie). C’est à cette activité réflexive que l’usage courant réserve le terme de grammaire. « Faire de la grammaire française » est une chose ; « parler français » ou « s’exprimer en français » en est une autre.
Remarques. — 1. Système immanent à la langue ou réalité mentale source de nos réalisations langagières, la grammaire correspond à la notion statique de langue (1.1.), que les structuralistes opposent au discours et à celle, plus dynamique, de compétence, que les générativistes opposent à la performance (3.1).
2. Contrairement à une opinion encore fort répandue (« Les patois n’ont pas de grammaire », « Cette langue n’a pas de grammaire puisqu’elle ne s’écrit pas »), il n’y a pas de langue sans grammaire, ce qui serait d’ailleurs une contradiction dans les termes : une telle langue (?) ne pourrait ni s’acquérir ni se transmettre (il n’y aurait rien à acquérir ni à transmettre) et ne se prêterait, faute de régularités, ni à la confection ni à l’interprétation d’énoncés significatifs.
Bibliographie. — N. Chomsky, 1957, p. 15–19 – F. Dubois-Charlier, D. Leeman, 1975, p. 29-31 – N. Ruwet, 1967, p. 18 et 49–50.
2.2. Grammaire et linguistique : les grammaires descriptives
Comme discipline générale vouée à la description des langues, la grammaire aujourd’hui synonyme de linguistique se présente comme un ensemble mixte d’observations, de procédures de découvertes et de généralisations. Selon leur objet spécifique, on distingue quatre branches ou types de grammaires :
• la grammaire synchronique (ou descriptive) qui décrit un état donné d’une langue, qu’il soit contemporain ou ancien (1.2.4) ;
• la grammaire diachronique (ou historique) qui étudie les différentes étapes de l’évolution d’une langue et qui, sous sa forme idéale, étudie les rapports entre ses états successifs (1.2.4) ;
• la grammaire comparée qui confronte deux ou plusieurs langues dans un ou plusieurs domaines pour établir entre elles des différences et des ressemblances typologiques, voire des parentés génétiques (p. ex. entre les langues romanes) ;
• la grammaire générale qui, à partir des données fournies par les trois autres types de grammaires, se propose de dégager les règles générales qui président à l’économie et au fonctionnement du langage humain.
Une grammaire descriptive est un modèle théorique qui se propose de décrire de façon explicite la grammaire-système, par définition implicite, d’une langue. D’où l’adjonction fréquente au mot grammaire de qualificatifs qui évoquent les courants théoriques particuliers dont s’inspirent les descriptions grammaticales : distributionnelle, fonctionnelle, structurale, transformationnelle, etc.
Remarque. — Au cours des quarante dernières années, les connaissances empiriques sur le langage et sur les langues se sont accumulées, alors que se développaient et se complexifiaient les appareils descriptifs. A chaque stade de cette histoire correspondent des courants de pensée, des théories et des écoles: Cercle de Prague, distributionnalisme, fonctionnalisme, générativisme, linguistique de renonciation, pragmatique, linguistique cognitive, etc.
Bibliographie. — C. Fuchs, P. Le Goffic, Les linguistiques contemporaines. Repères théoriques, Hachette, 1992.
2.3. Grammaires partielles et grammaires globales
Les grammaires se distinguent également par l’étendue du domaine qu’elles couvrent. Les grammaires scolaires et les grammaires dites « traditionnelles » se limitaient encore récemment au couplage d’une morphologie (étude des mots, de leur structure interne et des variations de leur forme) et d’une syntaxe (étude des parties du discours et de leurs combinaisons dans les phrases).
Les grammaires au sens étroit sont parfois réduites, sur le modèle des anciennes grammaires latines, à une morphosyntaxe qui n’étudie que les variations formelles des mots conditionnées par des processus syntaxiques (flexions). Les différents modes de construction des mots (dérivation et composition) relèvent alors de l’étude du lexique. Quant à l’absence d’une composante phonétique / phonologique (3.5.1), elle s’explique par l’intérêt longtemps porté aux seuls aspects écrits des langues.
Les travaux des linguistes générativistes ont popularisé une conception plus ambitieuse du domaine et des objectifs de la grammaire. Il s’agit de grammaires au sens large ou grammaires globales décrivant l’ensemble des principes d’organisation et de fonctionnement de la langue, c’est-à-dire le complexe d’aptitudes qu’un locuteur active inconsciemment lorsqu’il produit ou interprète des énoncés. Ce qui inclut, outre une morphosyntaxe, un modèle des connaissances phonologiques, sémantiques et même pragmatiques des locuteurs toutes connaissances dont la conjonction et l’interaction constituent la compétence langagière (3.1) des sujets parlants.
Bibliographie. — M. Chomsky, 1957, p. 15–19; 1966, p. 126–128.
2.4. Grammaires descriptives et grammaires prescriptives
Une grammaire descriptive se propose de rendre compte des régularités sous-jacentes au comportement langagier effectif des sujets parlants. Les seules données qu’elle peut valablement enregistrer sont celles qui se dégagent des productions des locuteurs, ce qui revient à adopter un point de vue strictement descriptif. Il appartient donc au linguiste non pas de trancher entre des formes et des usages concurrents (1.3.1), mais de les rapporter aux situations de communication où il les rencontre habituellement ou aux groupes de locuteurs dont ils constituent l’usage ordinaire. Telle n’est ni l’attitude ni l’objet des grammaires dites normatives ou prescriptives, qui se proposent d’enseigner le bon usage de la langue et qui édictent à cet effet des règles privilégiant un usage particulier au détriment d’un autre, fût-il le plus répandu (1.3.2). En voici quelques exemples :
• Une grammaire scolaire de 3e [A. Souche, J. Grunewald : 1966] conclut sa présentation des « subordonnées conjonctives complément d’objet » par l’avertissement : « Attention ! La lourde constuction » à ce que « doit être évitée chaque fois qu’il est possible : » Je consens qu’une femme ait des clartés de tout « (Molière), (et non : à ce qu’une femme..). Il faut dire : demander que, de façon que... ».
• Les auteurs d’un ouvrage grammatical récent citent alunir et avénusir comme exemples pour illustrer « la formation parasynthétique de verbes du deuxième groupe ». Mais l’éditeur (!) condamne ces deux formes dans une note en bas de page: « Verbes à éviter : on préférera atterrir sur la lune, atterrir sur Vénus ».
• Ailleurs se trouvent stigmatisés : après que suivi du subjonctif; les constructions indirectes du verbe pronominal se rappeler et du verbe pallier; la réduction de la négation à son deuxième élément: Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause (titre de film) ; le non respect des règles d’accord du participe passé précédé de l’auxiliaire avoir (VII : 2.5.2) ; la non-coréférence entre le sujet non exprimé du participe passé apposé et le sujet de la phrase régissante : Sitôt habillés, elle envoie ses enfants à l’école et bien d’autres constructions qui sont aujourd’hui largement utilisées, surtout dans le discours parlé.
Pourtant les usages proscrits ne constituent pas tous des « fautes » contre le système immanent de la langue française, qui est en fait un polysystème adapté à différents types de styles et de situations de communication. Au contraire, utilisées à bon escient, ce sont souvent des façons de parler tout à fait normales, donc correctes, mais parfois encore condamnées au nom d’une échelle de valeurs implicitement idéologique.
Sous sa forme extrême, le parti pris normatif débouche sur le purisme, attitude esthétique visant à figer la langue à un certain stade de son évolution censé représenter un idéal intangible (p. ex. le français des grands auteurs « classiques »). Les puristes se reconnaissent souvent à leur goût immodéré pour les bizarreries de la langue qu’ils collectionnent, cultivent et défendent à la manière des entomologistes.
Les vraies fautes contre la langue sont d’un tout autre ordre. Les unes sont des formes irrécupérables qui contreviennent aux règles communes à l’ensemble des sous-systèmes d’une même langue : *Je courirai *Je lui ai écrit afin que je l’avertisse *Est Paul encore là ? *la romaine armée. Les autres ne concernent pas les formes proprement dites, mais le fait qu’elles soient employées mal à propos (p. ex. un discours de réception à l’Académie française truffé d’expressions argotiques ou, inversement, des propos familiers émaillés d’imparfaits et de plus-que-parfaits du subjonctif). Les effets comiques provoqués par ce genre de disconvenances montrent clairement que le véritable « bon usage » consiste à choisir celui des « français tels qu’on les parle » qui correspond à la situation de discours, au statut respectif des interlocuteurs et à leurs intentions communicatives.
Bibliographie. — D. Leeman-Bouix, 1994 – F. Brunot, La pensée et la langue. Préface. Masson, 3e édition, 1965 – F. Dubois-Charlier, D. Leeman, 1975, p. 28–29 – E. Genouvrier, ). Peytard, 1970 p. 84–88 – Le français dans le monde, 34, 1982 – J. Lyons, 1970, p. 35–36 – A. Martinet, 1970, p. 6–7 – J.-C. Milner, 1989, p. 76–77 – N. Ruwet, 1967, p. 63.
L’analyse grammaticale
3.1. La description de la compétence langagière
La compétence, ou ensemble structuré des connaissances et des aptitudes communes aux locuteurs d’une langue, est l’objet explicitement affiché ou implicitement assumé des grammaires descriptives. Les représentations de ce savoir varient en fonction de l’extension que les théories linguistiques fixent à leur objet (2.3) et des objectifs pratiques que s’assignent les grammaires. Dans son acception la plus commune, la compétence se manifeste à travers deux aspects fondamentaux du comportement proprement linguistique des sujets parlants :
• La créativité dite « gouvernée par des règles » est le ressort essentiel de la dynamique langagière. Le cerveau humain n’est capable de stocker qu’une quantité finie de connaissances grammaticales. Pourtant, les sujets parlants sont capables à tout moment de produire (et d’interpréter) des phrases qu’ils n’ont jamais prononcées ni même entendues. Cette aptitude suppose que dans une langue donnée un nombre théoriquement illimité de phrases puisse être produit à partir d’un nombre fini d’éléments et de règles permettant de les combiner.
• La connaissance tacite que le locuteur ordinaire a de l’économie de sa langue lui permet de porter des jugements intuitifs sur la bonne formation des énoncés ou des parties d’énoncés, aussi bien sur leur forme que sur leurs propriétés interprétatives : On ne dit pas des chevals, mais des chevaux Dans la phrase Plusieurs candidats sont très compétents, plusieurs va avec candidats et très avec compétents Mon ami anglais dit toujours adresser quelqu’un alors qu’il faut dire s’adresser à quelqu’un, etc.
Qu’un locuteur émette de tels jugements ne signifie pas qu’il soit aussi capable de justifier ses appréciations, par exemple en les fondant sur des règles explicitement formulables (ce qui serait déjà faire œuvre de grammairien!). En tant qu’énoncés métalinguistiques spontanés, ces jugements ne sont que des données d’un type particulier à traiter comme telles, mais qui jouent un rôle essentiel dans la reconstitution de la compétence des sujets parlants.
Le terme de performance désigne les résultats de la mise en œuvre effective de leur compétence par les locuteurs. Il s’agit non seulement des énoncés émis et interprétés dans des situations de communication concrètes, mais aussi des jugements portés sur la bonne formation des phrases et sur leurs propriétés structurales et interprétatives. Tout produit discursif (par exemple la présente phrase et celles qui la précèdent ou qui la suivent) consume donc une performance. L’opposition compétence / performance se retrouve dans d’autres domaines du comportement humain chaque fois qu’une aptitude (p. ex., être capable de nager ou de calculer un pourcentage) est effectivement mise en œuvre (p. ex., pour traverser la Manche à la nage ou pour calculer la TVA sur le prix d’un article).
Les erreurs systématiques de performance dans les productions langagières spontanées s’interprètent comme autant d’indices d’une compétence défaillante ou lacunaire. Émises par un locuteur anglais, les phrases a. *Je connais lui b. *Jules César commandait la romaine armée c. *Il a rencontré le père de moi d. *Je sais il viendra révéleraient a contrario quatre aspects de la compétence du locuteur ordinaire français : l’antéposition et la forme du pronom personnel complément du verbe dans la phrase assertive (a) ; la postposition de l’adjectif relationnel au substantif (b) ; la substitution du déterminant possessif mon au pronom personnel moi complément d’un nom précédé de l’article défini (c) ; et le caractère obligatoire de la conjonction que en tête d’une subordonnée complétive.
Pourtant, même chez des locuteurs maîtrisant très bien la grammaire de leur langue, la performance n’est pas toujours le reflet fidèle de la compétence. Elle reste, en effet, toujours tributaire de facteurs internes ou externes (tels que la fatigue, les défauts de mémoire, la distraction, l’émotion, voire l’ébriété), généralement indépendants de notre volonté, mais susceptibles de gripper les mécanismes psychiques de la mise en œuvre de notre compétence.
Bégaiements, lapsus, dyslexies, pléonasmes, constructions inachevées, ruptures de constructions émaillent sporadiquement notre discours, particulièrement dans ses réalisations orales. Voici quatre exemples d’audientiques « ratés de la performance », les deux premiers entendus à la radio, le troisième et le quatrième relevés respectivement dans une annonce publicitaire et dans une copie d’étudiant : Le sujet de l’émission de demain sera consacré à [...] Ils n’ont dû leur salut qu’en se jetant à la mer Ce cintre léger en fil de fer souple [...] empêche, particulièrement pendant le séchage, tout vêtement pendu bien étiré de ne pas se déformer, se froisser ou de glisser du cintre La quête de notre personnalité, si elle s’effectue effectivement dans le monde extérieur, celui-ci est cependant limité.
3.2. Les règles grammaticales
« La personne qui a acquis la connaissance d’une langue a intériorisé un système de règles qui relie les sons et les significations d’une manière particulière. Le linguiste qui construit la grammaire d’une langue ne fait que proposer un système sur ce langage intériorisé » [N. Chomsky : 1970, p. 26]. En d’autres termes, le linguiste s’emploie à décrire de façon explicite la grammaire implicite (2.1) intériorisée par les usagers de la langue et sous-jacente à leurs productions écrites et orales. Or, une telle description ne peut qu’être hypothétique, bien que les ouvrages pratiques de ce nom ne se présentent jamais comme tels. En effet, la grammaire intérieure des sujets parlants (leur compétence) est une réalité mentale et, comme telle, reste inaccessible à l’observation immédiate. Faute d’un accès direct aux systèmes communicants que sont les langues, nous ne pouvons qu’observer leurs manifestations particulières et individuelles dans les actes de communication. L’unique solution consiste alors à partir des régularités décelées dans les énoncés pour « remonter » au système caché de règles dont elles sont la mise en œuvre et le résultat. C’est d’ailleurs ce que fait inconsciemment l’enfant lorsqu’à coup d’essais plus ou moins réussis il reconstitue progressivement la grammaire de sa langue à partir des énoncés auxquels il est confronté. C’est ce que fait à sa façon, c’est-à-dire méthodiquement et explicitement, le linguiste lorsqu’il décrit la grammaire d’une langue en termes de catégories et de règles abstraites dont devraient pouvoir se dériver les phrases bien formées de cette langue.
Ce qui caractérise une règle et qui la distingue des productions individuelles dont elle décrit une propriété commune, c’est son abstraction. Ce terme peut s’entendre de deux manières : est abstrait ce dont on n’envisage que les aspects jugés pertinents pour les besoins de la cause ou bien ce qui n’est pas directement accessible à l’observation.
Dans son entreprise de reconstitution de la compétence à partir de la performance, le grammairien s’estime fondé à ne pas tenir compte des inévitables mécomptes de la performance (3.1) au même titre que le physicien, lorsqu’il étudie le mouvement d’une bille descendant un plan incliné, tient pour négligeables les frottements et les déformations des corps solides. Car c’est précisément en faisant abstraction des épiphénomènes décrétés non pertinents, c’est-à-dire en écartant provisoirement tout ce qui est étranger à ses préoccupations, qu’une discipline détermine la spécificité théorique de son objet et se donne les moyens de l’étudier pour ainsi dire à l’état pur. Autre aspect de l’idéalisation descriptive : un phénomène linguistique décrit par une règle est toujours isolé artificiellement d’autres phénomènes linguistiques qui lui sont concomitants dans les réalisations discursives. Toute phrase, même la plus simple, est de ce point de vue la conjonction d’un grand nombre de règles.
Bibliographie. — N. Chomsky, 1957, p. 126–128 – N. Ruwet, 1967, p. 18–19 et 50–52.
3.3. Les données grammaticales
On peut rassembler un ensemble de textes ou d’énoncés jugés représentatifs de la langue ou, plus modestement, d’un domaine ou d’un axe de recherche bien déterminés. Une telle collection ne comprenant que des données attestées (des énoncés effectivement produits) constitue un corpus. Mais, le nombre des énoncés possibles étant infini, la grammaire basée sur un corpus aussi vaste soit-il, ne sera jamais que la grammaire du fragment de langue qu’est le corpus, avec toutes les contraintes médiodologiques et épistémologiques induites par cette limitation. En revanche, un corpus est incapable de fournir à volonté des phrases déviantes (p. ex. *Je veux que je parte) susceptibles de conforter a contrario la règle qu’elles violent (ici : l’effacement du sujet de la complétive s’il est coréférent de celui du verbe régissant vouloir et les modifications consécutives à cet effacement).
Les phrases jugées agrammaticales ne servent pas seulement à falsifier les hypothèses linguistiques. L’examen de leurs défectuosités nous révèle aussi par contraste les règles du fonctionnement normal. Car c’est souvent lorsqu’un mécanisme se détraque qu’il nous révèle les principes qui régissent son bon fonctionnement.
A la pratique d’observation statique qu’est la confection d’un corpus, s’oppose la pratique expérimentale et dynamique qui consiste à utiliser la compétence des locuteurs pour obtenir des données selon les besoins de l’étude. Cette méthode, popularisée par la grammaire générative, pallie certains inconvénients des travaux sur corpus (les philologues déplorent souvent l’absence de locuteurs ayant la compétence d’états de langue révolus). La langue y est accessible à travers une série toujours ouverte de nouveaux énoncés, spontanés ou provoqués. N’étant plus limités en nombre, les échantillons de performance étayent les hypothèses sur la langue, mais permettent aussi leur vérifications en les confrontant à de nouvelles données.
3.4. Acceptabilité et grammaticalité
Les jugements intuitifs que tout locuteur est capable de porter sur les énoncés qui lui sont soumis sont loin d’être homogènes. Comme ce sont des données qui relèvent de la performance, la première tâche du linguiste consiste à les évaluer dans le cadre de sa propre théorie. Dans ces appréciations, on se gardera de confondre ce qui relève de l’acceptabilité (au sens large) des énoncés avec ce qui ne concerne que leur grammaticalité (au sens étroit). La phrase :
(1) L’élève dont le devoir que j’ai lu hier soir était mauvais est votre fils
est grammaticalement bien formée, comme le prouve sa parenthétisation :
(1) a- [L’élève [ont le devoir [que j’ai lu hier soir] était mauvais] est votre fils]
Mais sa structure relativement complexe (elle comporte une relative enchâssée à l’intérieur d’une autre relative, elle-même enchâssée dans la phrase L’élève est votre fils) est difficilement accessible, et à plus forte raison interprétable dans les conditions normales d’un échange oral. Il suffit pourtant de supprimer le dernier enchâssement pour qu’elle ne pose plus problème :
(1) b- L’élève dont le devoir [...] était mauvais est votre fils.
Ce qui montre bien que c’est l’enchâssement supplémentaire grammaticalement tout à fait banal qui produit une structure trop complexe pour consumer un énoncé « acceptable », c’est-à-dire accepté spontanément.
L’acceptabilité est fondamentalement une propriété des phrases énoncées et dépend donc de tous les facteurs qui conditionnent la performance : conformité aux règles de bonne formation grammaticale, mais aussi adéquation à la psychologie du sujet parlant, à la situation, aux normes discursives en vigueur, etc. Une phrase acceptable serait, en quelque sorte par anticipation, une phrase pour laquelle il n’y aurait aucune difficulté à imaginer un ou des contextes où son interprétation ne poserait pas de problème. La grammaticalité ne recouvrirait alors que la partie de l’acceptabilité qui est déterminée par les règles de bonne formation intrinsèque des énoncés : règles morphologiques et syntaxiques dans une grammaire traditionnelle (grammaticalité au sens étroit) ; règles morphologiques, syntaxiques, sémantiques et éventuellement pragmatiques, si l’on conçoit la grammaire comme un dispositif global associant à des formes des contenus et des pratiques communicatives (grammaticalité au sens large).
Dans une première perspective, une phrase comme :
(2) D’incolores idées vertes dorment furieusement (N. Chomsky)
est grammaticale mais asémantique, à l’inverse de :
(3) *Lui être intelligent beaucoup.
qui est interprétable mais agrammaticale, alors que :
(4) *Bière te avec je perroquets.
est à la fois agrammaticale et asémantique.
Dans la seconde perspective, (24) seront toutes les trois déclarées agrammaticales, mais respectivement sémantiquement (2), syntaxiquement (3) et à la fois syntaxiquement et sémantiquement (3) mal formées. Une phrase grammaticale au sens large du terme mais néanmoins non-acceptable serait alors une phrase qui pour d’autres raisons (longueur, complexité, obscurité, etc.) serait jugée impropre aux usages communicatifs ordinaires.
Remarque. — Il est particulièrement gênant que ce qui devrait être la pierre de touche de toute analyse grammaticale ne soit pas toujours l’objet d’un consensus. Il n’est pas rare, en effet, que les jugements des locuteurs ne soient pas concordants. Tantôt ces derniers émettent des jugements normatifs qui proscrivent des énoncés appartenant à des niveaux de langage jugés incorrects. Tantôt ils sanctionnent des sociolectes qui leur sont inconnus ou peu familiers. Enfin, même à compétence égale, les seuils d’acceptabilité peuvent varier considérablement.
Bibliographie. — J.-P. Boons, Acceptabilité, interprétation et connaissance du monde. Actes du Colloque Franco-Allemand de Grammaire Transformationnelle, Ch. Rohrer, N. Ruwet, éds.1974, Tübingen, M. Niemeyer, p. 11–39 – J. M. Carroll, T. Bever, C.R. Pollack, The non-uniqueness of linguistic intuition, Language, 57, 1981, p. 368–383 – F. Kerleroux, L’exception et la règle, Le gré des langues, 2, 1991, p. 67–81 – D. Leeman-Bouix, 1994 – L. Picabia, A. Zribi-Hertz, 1981, p. 146–154.
3.5. Les domaines de la description grammaticale
Tout énoncé opère une association entre une suite de sons et une interprétation. Ce couplage est pourtant loin d’être direct, parce qu’entre ces deux niveaux extrêmes d’organisation s’étagent des niveaux intermédiaires. Chacun de ces niveaux se définit par la spécificité de ses unités et de leurs règles de combinaison, mais aussi par le type de rapport qu’il entretient avec les autres niveaux. La structure générale des énoncés apparaît d’emblée régie par un principe propre au langage humain, la double articulation (1.2.1), qui les organise en deux niveaux successifs. Mais au niveau même de la première articulation, les formes de l’expression (morphèmes, mots et constructions syntaxiques) et les configurations de leur contenu (sens grammatical et communicant) s’étagent encore sur au moins quatre niveaux dont chacun doit être pris en charge par une composante spécifique de la grammaire.
3.5.1. La composante phonologique
Qui ne sait qu’en français le [r] se prononce de deux, voire trois manières différentes : roulé, grasseyé et standard ? Qui ne croit pouvoir énumérer les voyelles françaises ou articuler un mot en syllabes ? Vraies ou fausses, ces certitudes concernent les domaines de la phonétique et de la phonologie, qui décrivent la matière et la forme sonores des signifiants.
En effet tout énoncé oral se présente comme une séquence plus ou moins continue que l’on peut segmenter en unités minimales ou sons. La phonétique (du grec phonê : son, voix) détermine les caractéristiques physiques et physiologiques des sons (II : 1.1 et 2.3) En d’autres termes, elle décrit comment ils sont produits (phonétique articulatoire), transmis (phonétique acoustique) et perçus (phonétique auditive). Quel que soit le mode de caractérisation retenu, la description phonétique des sons se veut indépendante de leur fonction linguistique.
La phonologie (II : 1.2) décrit également les sons ; mais comme leur fonction proprement linguistique est de s’opposer entre eux pour former des mots différents, elle ne retient que les caractéristiques qui les opposent effectivement les uns aux autres. Une fois inventoriés, les 36 phonèmes du français peuvent être classés selon :
► leurs propriétés internes. Chacun est alors défini par un faisceau de traits distinctifs ou caractéristiques articulatoires minimales distinguant un phonème d’un autre (11 : 2.2).
► leur distribution, c’est-à-dire leurs propriétés combinatoires en tant qu’éléments constitutifs des mots. Contrairement au polonais, où les noms propres Sypnicki et Kasprzak se prononcent /sipnitski/ et /kaspGak/, les séquences */t/ + /s/ + /k/ et */s/ + /p/ + /G/ sont phonologiquement mal formées en français. En revanche, les combinaisons /s/ + /k/ + /r/ (scruter, escroc) et /p/ + /s/ + /t/ +/r/ (obstruer, abstrait) sont possibles, bien que la majorité de ceux qui les prononcent quotidiennement n’en soient pas conscients.
Les regroupements phonémiques s’effectuent à l’intérieur de l’unité d’émission qu’est la syllabe (II : 3.1). Mais la chaîne parlée présente aussi des caractéristiques (dites suprasegmentales ou prosodiques) qui dépassent la dimension du phonème et souvent de la syllabe, mais apportent une contribution essentielle à la structure orale des énoncés français et à leur interprétation.
L’accentuation (II : 3.3) met en valeur des syllabes parmi d’autres à des fins démarcatives, rythmiques ou affectives. L’intonation (II : 3.5) surimpose aux structures phrastiques des profils mélodiques qui servent surtout à opposer différents types de phrases, mais peuvent aussi, à l’intérieur de la phrase, marquer par un décrochage de hauteur les contours d’une apposition. Ces deux paramètres interprétatifs sont généralement renforcés par les phénomènes secondaires de la pause (II : 3.4) et de la jointure (II : 3.2).
3.5.2. La composante morphologique
Le féminin de l’adjectif franc est franche, le pluriel du nom cheval est chevaux et la forme verbale repassait s’analyse en un radical (pass-) précédé d’un préfixe (re-) et suivi d’une désinence (-ait) : ces observations élémentaires relèvent de la morphologie (du grec morphê : aspect, forme), traditionnellement définie comme l’étude de la forme des mots. Cette composante étend aujourd’hui son domaine à tout ce qui relève de la structure interne des mots. On distingue, d’une part, la morphologie lexicale (XVII : 3) qui décrit les mécanismes, notamment de dérivation et de composition, qui président à la formation des mots ; de l’autre, la morphologie flexionnelle ou grammaticale (XVII : 2) qui traite des variations de la forme des mots selon les catégories du nombre, du genre, de la personne, etc. Dans la mesure où ils sont fortement tributaires de la syntaxe, la plupart de ces phénomènes relèvent d’une composante mixte, la morphosyntaxe, qui traite leurs variations formelles dans des cadres syntaxiques tels que l’accord ou l’allomorphie fonctionnelle.
Les deux types de morphologie impliquent l’existence d’une unité minimale constitutive du niveau morphologique : le morphème (XVII : 1.2), qui se manifeste souvent sous la forme de segments inférieurs à la dimension du mot (radicaux, préfixes, suffixes, désinences).
3.5.3. La composante syntaxique
Traditionnellement, la syntaxe (du grec syntaxis : mise en ordre, disposition, assemblage) décrit la façon dont les mots se combinent pour former des groupes de mots et des phrases. En français, l’existence d’une dimension syntaxique est d’emblée confirmée par le caractère non arbitraire de l’ordre des mots. La combinatoire proprement syntaxique, loin de se réduire au seul ordre linéaire des mots, détermine leur regroupement en syntagmes qui fonctionnent comme des unités intermédiaires entre le niveau des mots et celui de la phrase (V : 2.2.1). Car c’est la phrase qui constitue le cadre naturel de ces regroupements dans la mesure même où elle représente le niveau supérieur de l’organisation hiérarchique des énoncés, un niveau au-delà duquel il n’y a plus de regroupements syntaxiques. Aussi la première tâche de la syntaxe consiste-t-elle à mettre en évidence les principes selon lesquels les expressions complexes (phrases et syntagmes) se décomposent récursivement en éléments plus simples : c’est ce que systématise la procédure d’analyse dite « analyse en constituants immédiats » (V : 2.2.2).
Comme les éléments constitutifs de la phrase et les façons dont ils se combinent ne sont pas donnés à l’avance, leur identification suppose des procédures de segmentation et de classification. Il s’agit d’abord de reconnaître des segments identiques qui réapparaissent dans des combinaisons toujours renouvelées mais néanmoins gouvernées par des règles. Dans cette perspective, la description syntaxique établit les classes d’unités simples (les parties du discours, V : 23) et complexes (les syntagmes : V : 2.2.1) d’une langue ainsi que les règles qui président à leurs combinaisons (V : 2.2.4 al 2.2.5). En d’autres termes la structure syntaxique des phrases peut être représentée comme une configuration de segments identifiés par leur nature (le segment x appartient à la classe X) et par leur fonction (le segment x est en relation avec le segment y dans la construction d’ensemble z). Si néanmoins les descriptions syntaxiques divergent, c’est parce qu’elles ne retiennent pas nécessairement les mêmes critères pour définir ces deux notions fondamentales (V : 1.3 et 2.3.1).
L’analyse syntaxique ne se réduit pas pour autant aux seules procédures de « démontage » des phrases. Elle s’étend également aux rapports non contingents entre les constructions.
► Lorsqu’un type de construction bien déterminé implique l’existence d’un ou de plusieurs autres types de constructions, ce fait peut être décrit sous la forme d’un ensemble de correspondances systématiques entre les structures syntaxiques de ces constructions.
Ainsi une phrase passive (p. ex. L’épave de l’avion a été examinée par une commission d’enquête) est généralement mise en rapport avec la phrase active correspondante (Une commission d’enquête a examiné l’épave de l’avion) au moyen d’un ensemble d’opérations convertissant une structure de départ en une structure d’arrivée (XI : 7.1).
Le même traitement s’applique aux différents types (XI : 1) d’une même phrase (Son amie a écrit cette lettre Son amie n a pas écrit cette lettre C’est son amie qui a écrit cette lettre Son amie a-t-elle écrit cette lettre ? Qui a écrit cette lettre ? etc.), aux pronominalisations (Jean a confié ses impressions aux journalistes Il les leur a confiées), aux nominalisations (Pierre est fier la fierté de Pierre), etc.
► Il arrive aussi qu’une construction se décrive avantageusement à partir d’une structure de départ hypothétique, pas nécessairement réalisée telle quelle, mais retenue pour ses vertus explicatives (elle fait apparaître des éléments et des relations qui ne sont pas directement observables dans la forme de la construction étudiée).
On supposera, par exemple, à la phrase : (2) Jean désirait prendre des vacances une source (ou structure profonde dans les grammaires transformationnelles) comportant une subordonnée complétive dont le sujet est coréférentiel à celui de la principale : (2a). *Jean désirait qu’il [=lui-même] prenne des vacances. Cette hypothèse permet d’abord de justifier l’interprétation du sujet non exprimé de (2). Elle explique aussi la possibilité d’une coordination de la construction infinitive avec une subordonnée complétive non réduite dont elle partage le statut syntaxique : Jean désirait prendre des vacances, mais que sa femme reste à la maison. Elle oblige parallèlement à postuler pour (2) une règle d’effacement (ou de non réalisation) du sujet de la complétive lorsqu’il est coréférentiel au sujet du verbe de la principale. Du coup s’expliquent :
• l’agrammaticalité de (2a). et de (2b). *Je désire que je prenne des vacances.
• l’accord de l’attribut de l’infinitif avec son sujet effacé, mais néanmoins interprété comme coréférent au sujet du verbe principal : Il désire être heureux / *heureuse Elle désire être heureuse / *heureux.
• les contraintes de coréférence sur la forme réfléchie des verbes essentiellement pronominaux à l’infinitif et sur les formes réfléchies disjointes: Il désire s’enfuir / *t’enfùir / *les enfuir Elle veut tout faire elle-même / *lui-même / *vous-mêmes.
Bibliographie. — A. Daladier, Quelques hypothèses « explicatives » chez Harris et chez Chomsky, Langue française, 1980, 46, p. 58–72. – A. Delaveau, F. Kerleroux, 1985, p. 514 – C. Fuchs, P. Le Goffic, Initiation aux problèmes des linguistiques contemporaines. Hachette, 1975, p. 29–34, 64–70 et 82–8 – Langue française, 1, La syntaxe, 1969 L. Picabia, Deux analyses transformationnelles des pronoms français. La transformation comme principe explicatif. Langue française, 46, 1980, p. 41–57 – A. Zribi-Hertz, La démarche explicative en grammaire générative : autour du concept de transformation, Langue française, 46. 1980, p. 8–31.
3.5.4. La composante sémantique
La sémantique (du grec sèmantikos, dérivé adjectival de sèmainein : signifier) a pour objet l’étude du sens véhiculé par les formes linguistiques. Elle décrit la partie de notre compétence qui nous permet d’interpréter les énoncés, d’évaluer leur bonne formation au regard du sens et de reconnaître intuitivement des relations de sens tels que la synonymie et la paraphrase (XVIII : 2.3), l’implication (« Si quelque chose est une tulipe, alors c’est une fleur »), l’incompatibilité (« Si c’est une tulipe, ça ne peut pas être une rose, et réciproquement »), etc.
La sémantique lexicale (XVIII) se fonde sur ces intuitions pour construire des représentations théoriques du sens des morphèmes lexicaux. A partir de leurs rapports paradigmatiques (1.2.3) et pour rendre compte de la compatibilité sémantique des unités de la phrase entre elles, on assigne généralement aux noms des traits sémantiques inhérents (+ / animé, + / humain, etc.) et aux verbes et adjectifs des traits dits de sélection contextuelle (v : 2.3.2) spécifiant les contraintes combinatoires qu’ils exercent sur leur entourage nominal. Ces descriptions sont vérifiées par la pratique lexicographique qui associe aux unités lexicales des paraphrases défînitoires fondées sur des équivalences sémantiques paradigmatiques (Un oculiste, c’est un médecin spécialiste des y eux).
L’étude du sens des morphèmes grammaticaux (XVII : 2.1) relève davantage de ce qu’il conviendrait d’appeler la sémantique grammaticale ou phrastique (XVIII : 3.1). Cette dernière décrit, d’une part, ce qu’on appelle les valeurs des catégories flexionnelles de la personne, du nombre, du temps, du mode et de la voix ; d’autre part, la signification des relations syntaxiques entre les constituants de la phrase, qu’elles soient ou non marquées par un mot fonctionnel (préposition ou conjonction). Au total, l’interprétation sémantique d’une phrase peut être décrite sous la forme d’un ensemble d’instructions (XVIII : 3.3) permettant à l’allocutaire de construire une représentation sémantique à partir de ses connaissances grammaticales et lexicales.
3.5.5. La composante pragmatique
La pragmatique (du grec pragma : action), ou pragmalinguistique pour la distinguer d’autres formes de pragmatiques (p. ex. philosophique, logique ou sociologique), constitue le domaine le plus récent de la recherche linguistique. Sous ce terme se regroupent depuis le début des années 70 un ensemble de travaux qui envisagent les énoncés linguistiques comme des outils d’interaction communicative et décrivent les conditions effectives de leur emploi. En dépit de leur diversité, ces approches reposent sur la même hypothèse fondatrice. Elles postulent en effet que l’activité langagière est une pratique intersubjective, finalisée et réglée par des principes d’efficacité et de bonne conduite communicative. On peut en effet imaginer un locuteur produisant des phrases en tout point conformes aux règles de bonne formation phonologique, morphologique, syntaxique et sémantique du fiançais, mais communicativement incongrues et inefficaces (voir l’exemple (l) ci-dessous). Un tel locuteur serait tout simplement dépourvu de la compétence communicative du locuteur ordinaire.
Il n’est pas étonnant que la dimension proprement pragmatique du langage nous soit directement révélée par des phénomènes dont l’explication ne se situe à aucun des autres niveaux d’analyse traditionnels. C’est le cas, par exemple de la déviance de la phrase (l) comparée à (2) :
(1) *Louis XIV est mort en 1715. mais je ne le sais pas.
(2) Louis XIV est mort en 1715. mais Paul ne le sait pas.
Formellement, les deux phrases s’analysent comme la coordination de deux phrases assertives dont chacune est morphologiquement et syntaxiquement bien formée. Sémantiquement, elles s’interprètent comme la conjonction de deux propositions (au sens logique du terme) qui décrivent chacune un état des choses : le décès de Louis XIV à une certaine date et l’ignorance de ce fait historique par un certain individu. Pourtant, (l) est communicativement incongrue : l’énoncer serait contrevenir à un principe implicite qui régit toute conversation « sérieuse » : lorsqu’on affirme quelque chose, on se présente simultanément comme garant de sa vérité. Faute d’un tel principe (la maxime de qualité de H.P. Grice [l975] ou, plus simplement, la norme de sincérité), toute communication effective serait abolie, puisque l’interlocuteur ne saurait jamais comment « prendre » les énoncé des autres.
Bibliographie. — J.-C. Anscombre, O. Ducrot, 1983 – M. Bakhtine, Le marxisme et la philosophie du langage, 1929, Ed. de Minuit (1977) – H.P. Grice, 1975 – O. Ben Taleb, 1984 – G.H. Halliday, Language Structure and Language Function, New Horizons in Linguistics. J. Lyons, éd., Londres, Pen-guin, 1970, p. 140–165 – C. Kerbrat-Orecchioni, 1986 – G. Kleiber, Les différentes conceptions de la pragmatique ou pragmatique, où es-tu?. L’information grammaticale, 1982, 12, p. 3–8 Langue française, 42, La pragmatique, 1979 – J.R. Searle, 1972 – D. Sperber, D. Wilson, 1989 – A. Berrendonner. Éléments de pragmatique linguistique, Minuit, 1981.
En substance, une description linguistique est pragmatique si elle ne réduit pas les énoncés à des constructions dotées d’un sens intrinsèque, mais envisage leur interprétation dans les types de situations où elles pourraient être employées. L’extension du domaine de la pragmalinguistique et les rapports complexes qu’elle entretient avec les autres composantes d’une grammaire apparaît à travers toute une série de phénomènes interprétatifs que l’analyse grammaticale ne saurait ignorer : actes de langage (XX : 3) accomplis directement ou indirectement par renonciation d’une phrase, expressions référentielles (XIX : 3), déterminants (VI : 2) et pronoms (VI : 5) dont l’interprétation dépend de la situation de communication ou du contexte linguistique (termes embrayeurs, XX : 2.1 et anaphoriques XXI : 3), sens des connecteurs argumentatifs (XXI : 4) qui permettent d’orienter l’interprétation du destinataire vers un certain type de conclusion, etc.
Les phénomènes qui manifestent ce type de régularité relèvent de la langue en action et de la langue en contexte. Leur prise en compte par la description grammaticale implique une double distinction entre phrase et énoncé et, par voie de conséquence, entre sens phrastique et signification énonciative (XVIII : 3.1 et 3.2). Une phrase donnée est une entité structurale abstraite que l’on peut caractériser par un ensemble de règles de bonne formation phonologique, morphologique et sémantique. Elle se réalise sous la forme concrète d’énoncés. Ainsi la suite ordonnée des trois mots comment, allez et vous constitue, en dehors de toute situation de communication ,et de tout contexte linguistique, une phrase (V : 1) : c’est-à-dire un assemblage grammaticalement bien formé, n’entrant pas dans une construction plus vaste et appartenant à un type déterminé (ici : interrogatif). Mais chaque fois que l’on prononce ou que l’on écrit la phrase : (l) Comment allez-vous ? une même structure lexico-syntaxique abstraite se réalise à travers autant d’énoncés particuliers : (l a), (l b),... (1 n).
Chacun de ces énoncés (identifié ici par un indice alphabétique) est unique et différent des autres, parce qu’il résulte d’un acte individuel, dit d’énonciation (XX : 1), effectué par un locuteur particulier engagé dans une situation de communication particulière. Ainsi non seulement la valeur référentielle du sujet de la phrase (l), c’est-à-dire l’identité du destinataire, varie d’un énoncé à l’autre, mais aussi ses objectifs communicatifs : selon la situation, (l) peut en effet être interprétée comme une formule purement phatique (à la suite, par exemple, de Bonjour !), une question de bonne foi (adressée par un médecin à son patient) ou un commentaire ironique (si le locuteur veut laisser entendre malicieusement qu’il sait que le destinataire ne va pas bien).
D’autre part, une phrase ne peut se concevoir que sous une forme normalisée, voire canonique (V : 2.1), qui n’est pas toujours reproduite intégralement par ses énoncés. Plutôt ou Pas trop, par exemple, s’interpréteront contextuellement comme des formes abrégées de phrases complètes (équivalant à Je suis plutôt fatigué ou de Je ne suis pas trop fatigué, en réponse à la question Es-tu fatigué ?). Ailleurs, c’est la situation de communication qui permet de faire l’économie de l’information normalement véhiculée par une partie de la phrase. C’est le cas du chirurgien en train d’opérer qui, pour demander un instrument, se contente habituellement d’en énoncer le nom (Bistouri = Passez-moi le bistouri).
Bibliographie. — S. Delesalle, 1974 – M.-N. Cary-Prieur, 1985, p. 45–56.
Le nouveau Petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, P., 1993
Évolution du lexique
à observer l’ensemble des entrées ajoutées dans cette nouvelle édition, on peut apercevoir assez clairement dans quelles directions évolue le lexique. Quelques pessimistes parlent du français comme d’une langue qui aurait perdu sa créativité et qui ne vivrait plus que d’emprunts à l’anglais : le Nouveau Petit Robert leur apportera la preuve du contraire et montrera que les néologismes, toujours aussi nombreux, sont en outre formés selon de nouveaux modèles ; l’époque actuelle invente d’autres procédures pour créer des mots.
Mots composés
Les mots savants sont traditionnellement formés avec des radicaux latins (octogénaire) ou grecs (stéthoscope), parfois hybrides (monocle) et autrefois critiqués par les puristes. Aujourd’hui on va plus loin : un très grand nombre de mots mêlent le grec ou le latin au français, et ce modèle est de plus en plus productif (stratosphère, agroalimentaire, écomusée, hydrocarbure, narcotrafiquant, cryoconservation, hélitreuiller, xénodevise ; voyoucratie, boulodrome, pochothèque, plombémie, profilographe, fraisiculteur avec ajout d’un o ou d’un i de liaison).
Parfois même, on compose de cette façon avec deux mots français (placoplâtre, alcalinoterreux, filoguidé, vagotonique, riziculture). Cette composition des mots reste « savante » dans la mesure où l’ordre des mots est inversé par rapport à la désignation ordinaire (placoplâtre : plâtre en plaques ; riziculture : culture du riz ; filoguidé : guidé par un fil). Nous pouvons donc maintenant, comme les anglophones, produire des composés courants de ce type tout en disposant du système sans inversion comme jupe-culotte, voiture-bar ou abribus. De plus, l’adjonction du o ou du i de liaison produit en fait un nouvel élément : placo-, filo-, rizi-, etc. Déjа, nous avons légitimé moto- de moteur (motocycle, mototracteur, etc.), toxico- de toxique (toxicomane), séro- de sérum (sérodiagnostic).
On voit comment, partie de règles très contraignantes, la composition des mots s’est libérée au profit de la néologie. Il n’est plus possible aujourd’hui de dire que la morphologie lexicale du français est une entrave à la créativité. Ce point de vue puriste est dépassé par les faits, et il faut accepter qu’une langue vivante change de normes.
Troncations
Les dernières décennies ont été marquées, pour le vocabulaire, par un écourtement des formes qui s’étend et s’accélère dans tous les registres de la langue, des mots irremplaçables comme cinéma (déjà ancien, cinématographe étant hors d’usage) aux mots courants de bonne compagnie, comme mélo, météo, écolo, et aux mots assez familiers comme appart (appartement), beaujo (beaujolais), intox (intoxication), impec (impeccable), mob (mobylette), maso (masochiste), stup (stupéfiant), etc. Toutes ces formes, parfois sibyllines, surtout pour les étrangers, ont été signalées dans le dictionnaire, et beaucoup figurent à la nomenclature où elles renvoient le lecteur au mot complet. Leur brièveté, en effet, est un avantage pour les locuteurs, mais comme la coupure survient quasiment n’importe où (prof pour professeur, pro pour professionnel ; écolo pour écologiste, proche de école), la restitution du mot complet est très aléatoire.
Une autre difficulté de « reconnaissance » du mot est due au double phénomène de troncation avec suffixation populaire, qui se manifeste dans de nombreux mots apparentés à l’argot : alcoolo (alcoolique), apéro (apéritif), dico (dictionnaire), dirlo (directeur), chômedu (chômage).
Enfin, on peut constater que le raccourcissement frappe aussi les éléments, tant par des décisions volontaires que par des confusions dans la coupe des mots : hélico- (hélicoptère) devient héli- (héliport), pétrolo- de pétrole devient pétro- (pétrochimie), toxico- (toxicomane) devient toxi- (toxi-infection), etc. De plus, de nombreux éléments prennent le sens du mot très connu dans lequel ils figurent : oxy- « pointu » a acquis le sens de « oxygène » (oxyhémoglobine), psycho- « âme », celui de « psychologie » (psycholinguistique), narco- « sommeil », celui de « narcotique, stupéfiant, drogue » (narcotrafiquant), etc. Tous ces mouvements profonds témoignent d’une grande vitalité du français.
Sigles
Une autre façon d’écourter est l’emploi des sigles. D’abord surtout réservés aux sociétés, institutions, partis et syndicats (B.H.V., B.N.P., S.D.N., U.D.F., C.G.T., etc.), ils représentaient des noms propres dans l’écriture. Leur usage s’est massivement répandu pour les noms communs (C.C.P., H.L.M., I.V.G., P.M.E., O.P.A.) et même les adjectifs (B.C.B.G). On les a de plus en plus employés à l’oral ; certains sont si courants que la forme complète correspondante est souvent ignorée (C.R.S. « agent des Compagnies républicaines de sécurité »). En outre, lorsque la suite de lettres est prononçable, les sigles se lisent, pour la plupart sans être épelés, comme des mots ordinaires et perdent leurs points, parfois aussi leurs capitales (ZUP, SICAV, DOM-TOM, écu, ovni, sida) ; ce système rétroagit sur l’écriture des sigles non prononçables (B.D., bande dessinée qui a donné bédé). Tous les cas sont susceptibles de produire des dérivés qui, n’étant jamais des noms propres, trouvent leur place dans le dictionnaire de langue (cégétiste, capésien, cébiste, bédéphile, énarque, sidéen, opéable, vépéciste). On voit que se développe un puissant système de création lexicale, marqué par la démotivation graphique, comme celle qui s’est produite en passant de nième à énième, avec la même prononciation. Le Petit Robert, qui répertorie ces mots et donne leur étymologie, garde heureusement la mémoire de leur curieuse formation.
Mots étrangers
Parmi les nouvelles entrées, il y a un nombre important de mots étrangers récemment implantés en français. L’anglicisme est quantitativement dominant, mais on observe un afflux d’emprunts à d’autres langues, notamment des mots italiens, arabes, espagnols, allemands, japonais et russes. L’internationalisation de l’information et les grands mouvements du tourisme, en rétrécissant le monde, rendent toutes les langues plus poreuses ; ces emprunts sont justifiés par la nécessité de désigner les choses qui viennent de loin et qui restaient ignorées. C’est un rapprochement entre les peuples et entre les langues car ces mots, généralement non assimilés, deviennent des mots universels (l’aquavit, le fugu, l’omerta, etc.).
Certains anglicismes, on le sait, sont plus contestables dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires, et de loin. Le prestige des États-Unis, leur puissance économique et leur avance technoscientifique suscite un flot d’emprunts et ceci, même lorsque nous avons déjà le mot français qui convient. La situation est aggravée par la rapidité de l’information (les agences de presse et les traducteurs n’ont pas le temps de chercher un équivalent français). Par ailleurs, l’anglicisme qui était autrefois un snobisme des classes aisées exerce aujourd’hui une pression qui touche toutes les classes de la société, et largement les adolescents. Dans le domaine des terminologies, des commissions ministérielles se réunissent en France, des institutions ont été créées au Québec pour proposer des mots français en remplacement des anglicismes, et parfois l’entreprise est couronnée de succès (ordinateur pour computer). Nous avons signalé comme tels les anglicismes récents et indiqué le mot français correspondant proposé par les commissions, sans jamais faire apparaître à la nomenclature ce qui n’est pas attesté par l’usage. Comme on l’a déjà dit, la vocation du Nouveau Petit Robert, comme naguère celle de l’édition de 1967, n’est pas de légiférer, mais d’observer la langue en attirant l’attention sur ce qui fait problème. Il faut signaler aussi — et les commissions ne s’en préoccupent pas — que les emprunts récents à l’anglais ont fortement amplifié le phénomène de l’acronymie, ou formation d’un mot avec certaines syllabes extraites de plusieurs mots. Cette formation sauvage se manifeste par exemple dans contraception (angl. contra- + conception), navicert (angl. navigation certificate), brunch (angl. breakfast + lunch) ; en français nous avons créé progiciel (programme + logiciel), velcro (velours + crochet), héliport (hélicoptère + aéroport), tapuscrit (taper + manuscrit), volucompteur (volume + compteur) et bien d’autres. Là encore, l’avantage de la brièveté s’accompagne de l’impossibilité de l’analyse morphologique utile à la compréhension des mots. Néanmoins, la morphologie des composés savants n’étant plus maîtrisée que par des lettrés, cette façon de former librement des mots a un aspect ludique qui la rend très productive.
La dérivation française sur des mots anglais continue de se développer : après avoir inventé footing, tennisman, etc., nous avons créé relooker, révolvériser, glamoureux, footeux, flashant, débriefer. Camping-car est aussi un produit français inconnu des anglophones.
Verlan
De tout temps on a forgé des parlers subrogés qui permettent de déguiser les mots selon des règles instaurées pour des initiés. Nous avons eu le « javanais », le « loucherbem » (prononcé [luGebDm]), aujourd’hui le verlan, qui présente les mots à l’envers. Il n’est évidemment pas dans notre propos de décrire un tel système, qui par ailleurs est limité à un milieu restreint. Mais certains mots se sont répandus dans l’usage familier courant et ne pouvaient être raisonnablement rejetés. Nous avons donc traité les mots beur, meuf, ripou sur le même pied que certains mots familiers, sans nous alarmer de leur étymologie.
Graphies et prononciations
Les façons d’écrire et les façons de prononcer le français n’évoluent pas au même rythme. Si l’écriture change plus lentement, c’est qu’elle reste socialement valorisée par rapport à l’oral qui, aujourd’hui encore, est considéré comme une expression libre, familière et sans conséquence (alors que c’est la langue orale qui fonde l’objet d’étude de la linguistique). L’écrit laisse par essence une trace et constitue le lieu de la norme et de la stabilité. Cette pesanteur de l’écrit constitue parfois une gêne, comme lorsque la prononciation s’éloigne trop de l’écriture ; mais elle constitue aussi un frein pour la langue parlée qui est massivement déviante et inventive. De plus, c’est le français écrit qui garde le passé en mémoire et assure la continuité du système. Si doigt s’écrivait doi, la relation formelle avec digital serait perdue. Néanmoins il ne faudrait pas croire que l’écrit est un système régulier dans son ensemble. Il a subi des réformes autoritaires (justement l’ajout de gt au XVIe s.) et il lui est arrivé maints accidents qu’on appelle pudiquement « exceptions ».
Nous n’avons pas entériné les « Rectifications de l’orthographe », rapport présenté par le Conseil supérieur de la langue française et publié le 6 décembre 1990 au Journal officiel ; nous nous sommes expliqués sur ce sujet dans une brochure publiée en 1991. Néanmoins le Nouveau Petit Robert est très attentif aux évolutions des graphies, qui souvent tendent naturellement à plus de simplicité. On peut observer la soudure des éléments préfixés (le trait d’union était malvenu puisqu’il ne joignait pas deux mots) ; ainsi cérébro-spinal devient cérébrospinal ; hydro-électrique, hydroélectrique. La soudure intervient aussi pour les mots composés comme plate-forme, que l’on écrit plateforme. Il arrive que pour certains mots récemment empruntés, plusieurs graphies soient d’abord attestées (jusqu’à sept pour casher dans viande casher). Mais le temps les sélectionne et la forme se stabilise, généralement au profit de l’assimilation.
Les emprunts anglais offrent de nombreux noms en -er prononcés tantôt comme dans revolver, tantôt comme dans freezer, tantôt des deux façons (scooter, etc.). La tendance actuelle est de franciser le suffixe -er en -eur (bluffeur, crawleur, kidnappeur, mixeur), et ceci d’autant plus lorsqu’il existe déjà un verbe en -er (bluffer, kidnapper, etc.) ; ces emprunts s’alignent alors sur le système français danse, danser, danseur : bluff, bluffer, bluffeur.
On observe aussi une francisation des pluriels des mots étrangers au fur et à mesure que l’emprunt est plus usité : des supermans, des sandwichs, des whiskys, des minimums, des adagios, des tatamis. Et pour les langues qui prennent un s prononcé au pluriel, la tendance progresse vers le s muet du français : des paellas, des chorizos, des goldens.
On peut remarquer aussi qu’avec le temps, la prononciation traditionnelle et irrégulière de certains mots (dompteur, magnat, arguer, homuncule, etc.) est plus ou moins abandonnée au profit de la règle générale (comme dans somptueux, magnifique, narguer, homoncule) ; cependant compter, comme tous les mots très fréquents, ne peut guère changer, pas plus que femme ou monsieur. Mais on oublie souvent que chaque moment s’inscrit dans une évolution globale de la prononciation dont les causes sont difficiles à démêler. Or les 26 années entre 1967 et 1993 constituent déjà une période historique où les évolutions phonétiques sont sensibles : regain du e caduc prononcé, neutralisation des a et aussi des é, des o dans certaines positions, disparition de nombreuses géminées. La comparaison des notations phonétiques de 1967 et de 1993 dans le Petit Robert est très instructive à cet égard. Et déjà deviennent perceptibles une nouvelle articulation des mots, un déplacement des liaisons et une montée terminale de l’accent de phrase destinée à stimuler l’attention. Ces tendances donnent parfois lieu à de pénibles excès, notamment dans le discours des médias, mais le bon goût reprend généralement ses droits. Il faut aussi admettre, à l’encontre des puristes, que ce discours est, pour beaucoup d’auditeurs, moins fautif et plus riche que ceux qu’ils peuvent entendre dans leur vie quotidienne.
Le sens des mots
Le projet fondamental d’un dictionnaire de langue est le recensement et l’analyse des significations ; il n’existe aucun ouvrage spécial qui assume cette fonction, alors que tous les autres aspects du lexique peuvent faire l’objet d’un dictionnaire (de prononciation, d’orthographe, d’étymologie, d’analogies, de synonymes, etc.). C’est pourquoi la vérification d’un sens passe si souvent par le recours aux dictionnaires les plus connus, comme en témoignent les innombrables citations de nos définitions dans la presse et les écrits didactiques. C’est pourquoi aussi les recherches sur le sens, sémantique linguistique ou informatique " cognitive ", s’appuient sur le dictionnaire de langue comme corpus ou base de données. Le dictionnaire de langue est la mémoire lexicale d’une société, et c’est le lexique qui est porteur de la quasi-totalité des significations qu’aucun de nous ne peut mémoriser. Même et peut-être surtout les écrivains qui ont de plus grands besoins d’expression recourent constamment au dictionnaire.
LA CIRCULATION DU SENS
Quand on parle de sens, on pense généralement aux définitions des mots, telles qu’on peut les trouver dans un dictionnaire encyclopédique. Mais un véritable dictionnaire de langue comme le Nouveau Petit Robert ou le Grand Robert va beaucoup plus loin en décrivant toutes les manifestations du sens et sa circulation dans le lexique. La nomenclature d’un dictionnaire ne doit pas nous abuser : c’est une liste d’unités formelles qui permet, en fait, d’accéder au fin réseau des significations que l’article tout entier va tenter de mettre au jour. Les définitions multiples s’organisent en arborisation ; d’autres glosent les groupes de mots (sous-entrées) et les locutions ; les définitions sont elles-mêmes balisées par des synonymes et clarifiées par des contraires. Les expressions renvoient elles aussi а des mots qui sont leurs synonymes, appelés analogies (fonction onomasiologique) ; synonymes et analogies développent un champ de significations. Enfin, l’emploi du mot en contexte, dans des exemples forgés ou des citations signées, montre la signification en action, avec ses connotations. Cette richesse d’information permet de comprendre le mot dans toutes ses nuances (fonction de décodage) et de l’employer dans le contexte et la situation qui conviennent (fonction d’encodage). L’actualisation du Nouveau Petit Robert porte sur tous ces aspects. Un important travail sur les synonymes et les analogies montre comment le sens s’est déplacé dans l’expression de nouveaux thèmes et de nouvelles valeurs propres à notre époque (à cet égard, on peut comparer, par exemple, les articles de 1967 et 1993 pour pauvre, calme, fécondation, aliment, allumer, préserver, sans même citer les mots spécialement créés pour désigner des réalités nouvelles).
L’exemple et la citation
L’exemple est une phrase ou une partie de phrase où figure l’entrée, qui est produite par le lexicographe (exemple forgé) ou empruntée а un auteur, avec mention de son nom, et dans les gros ouvrages comme le Grand Robert, avec la référence complète du texte (citation). Les deux types de textes présentent des fonctions communes : montrer le mot en action, sa place dans la phrase, sa morphologie (formes conjuguées de verbes, formes au féminin et au pluriel), montrer que le sens du mot est bien compatible avec la définition - mais sans plus, aucun exemple ne pouvant manifester tout et seulement ce que la définition exprime. L’exemple et la citation apportent des éléments de preuve en montrant ce qu’a dit par ailleurs le lexicographe. Certaines citations appelées citations-attestations sont même simplement destinées а rassurer le lecteur sur l’existence effective d’un néologisme ou d’un emploi récent. Le Nouveau Petit Robert présente de nombreuses citations de journaux qui ne sont que des attestations, la presse " allant plus vite " que la littérature dans l’emploi spontané des mots et des sens nouveaux.
Néanmoins, l’exemple produit et la citation sont fondamentalement différents dans leur signification globale, leur contenu. L’exemple du lexicographe, qui est traditionnellement appelé exemple forgé, est en effet " forgé pour la circonstance " ; mais l’adjectif forgé fait songer а tort а " forgé de toutes pièces ", avec le sens péjoratif de " sans existence réelle ". Or, les exemples du lexicographe sont au contraire des énoncés tout prêts qui sont inscrits dans sa mémoire, ce sont les phrases qu’il a lues ou entendues le plus fréquemment. Et cette grande fréquence sélectionne l’emploi le plus attendu du mot, un lieu commun dans un sens non péjoratif, aujourd’hui nommé stéréotype. L’ensemble des exemples d’un dictionnaire n’est autre que ce qui se dit le plus souvent а une époque donnée dans une langue donnée. La somme de ces exemples et notamment la phraséologie fixe pour nous et notre postérité un état présent de la société, de ses préoccupations et de ses valeurs. Il n’y a donc rien de forgé dans un bon exemple, alors qualifié de " naturel ", bien au contraire. Quant а la circonstance de sa production elle n’est guère plus artificielle que celle du contexte littéraire de fiction pour l’écrivain.
La citation d’auteur, pour sa part, ne se donne pas comme lieu commun : le texte émane d’une seule personne qui, en général, ne prend pas la plume dans l’intention d’écrire ce que tout le monde sait déjà. La citation littéraire manifeste un contenu intéressant dans une forme personnelle qui le met en valeur ; la seule limite а l’incongruité d’une citation, c’est le choix raisonnable du lexicographe (la poésie moderne notamment ne peut servir а l’éclaircissement des significations). Ainsi la citation littéraire est complémentaire de l’exemple forgé, elle se présente comme un modèle supérieur d’expression et une référence culturelle, mais aussi comme un ancrage dans le particulier et un surgissement de l’individu sur fond de stéréotypes sociaux. Le texte littéraire est le plus apte а manifester " l’expérience des limites ", comme dans cet exemple de Jean Genet pour l’adjectif habitable : " Quand j’étais misérable, marchant dans la pluie et le vent, la plus petite anfractuosité, le moindre abri devenait habitable ". Cette édition bénéficie de l’apport des meilleurs écrivains actuels : Duras, Tournier, Modiano, Cioran, Grainville, Pennac, Quignard, Sollers, Simenon, Yourcenar, Godbout, Kateb Yacine, Hampaté Bâ et bien d’autres.
Tous les dictionnaires de langue sont établis а partir d’un corpus de citations : fichiers manuels d’autrefois, puis mécanographie, puis base de données informatisées. Mais c’est le lexicographe qui, en amont, décide de la composition du corpus et en aval du choix des textes qui conviennent а son projet d’illustrer les mots. La part d’inattendu que le corpus impose au lexicographe est surtout de nature néologique (mots, sens nouveaux, constructions nouvelles).
Locutions et allusions
Le dernier quart de ce siècle semble caractérisé, pour le français, par le foisonnement de nouvelles locutions, familières ou non : renvoyer l’ascenseur, remettre les pendules а l’heure, ne pas faire dans la dentelle, jouer dans la cour des grands, revoir sa copie, vouloir le beurre et l’argent du beurre, avoir plusieurs casquettes, se faire une toile, bronzer idiot, donner des boutons ; cas de figure, alibi en béton ; а deux vitesses, а fond la caisse, а l’aise Blaise, etc., et aussi des locutions-phrases On se calme ! Ça fait fort ! La balle est dans son camp. C’est la faute а pas de chance, etc. Le Nouveau Petit Robert en signale un très grand nombre soigneusement distribuées dans les articles а l’endroit convenable pour le sens, répétées pour chaque mot de la locution mais traitées une seule fois.
Mais l’unité la plus originale de l’époque est l’allusion, expression ou phrase empruntée а une personne connue sans la citer nommément (cryptocitation). Alors que la locution est proche du mot, l’allusion est proche de la citation. Autrefois, l’allusion était surtout chose personnelle, et renvoyait а la littérature ; lorsque Stendhal écrit " M. Villeraye, se promenant au jardin avec madame de Nintray ... lui tint а peu près ce langage ", chacun reconnaît La Fontaine. Aujourd’hui l’allusion s’est socialisée et renvoie au discours politique (les " petites phrases " et les slogans comme " Touche pas а mon pote ", Harlem Désir) aussi bien qu’aux dialogues de films (" Majesté, votre sire est trop bonne ", François Ier), aux chansons à la mode et aux numéros des grands comiques et humoristes (" C’est étudié pour ", Fernand Raynaud). Cette complicité entre les personnes qui s’établit par l’allusion lui confère le statut de stéréotype, et c’est pourquoi nous lui avons réservé une place dans le Nouveau Petit Robert.
D’autre part, nous avons souvent cité des titres d’œuvres surtout de littérature et de musique, titres français ou traduits d’une autre langue : La Bête humaine de Zola, La Femme et le Pantin de Pierre Louяs, Par-delà le bien et le mal de Nietzsche, La Symphonie pastorale de Beethoven, La Veuve joyeuse, opérette de Franz Lehár. La présence de ces titres-exemples (que la toute récente 9e édition de l’Académie utilise aussi) répond а plusieurs fonctions. La plus importante est évidemment l’allusion culturelle, avec ses connotations, qui peut être réutilisée en situation. Mais le titre peut servir d’exemple pour illustrer un mot rare ou ancien parce qu’il s’impose avant tout autre exemple (Les Trois Mousquetaires de Dumas, Terraqué de Guillevic). Inversement des titres très connus mais dont le sens n’est pas clair sont cités pour l’explicitation du titre, alors traité comme une locution (La Peau de chagrin, Les Hauts de Hurlevent, L’Essai sur les données immédiates de la conscience, La Ballade des pendus).
Ainsi, ce Petit Robert 1993 est doublement nouveau. Nécessairement, parce que le français évolue en lui-même et dans ses usages ; délibérément, car le point de vue que nous prenons sur notre langue s’est enrichi : connaissances nouvelles, enjeux et combats (la pression accrue de l’anglais américain, les nouveaux équilibres langagiers en Europe, au Maghreb...), sensibilité linguistique en constant mouvement. Ces facteurs justifiaient largement un investissement très important, en travail intellectuel, en technique informatique, en repérage et en analyse des évolutions contemporaines du lexique, en expertise non seulement linguistique et littéraire, mais aussi scientifique, technologique, juridique, économique. Ceci explique le nombre important de collaborateurs réunis pendant cinq ans pour cette édition, auxquels nous tenons а rendre un hommage а la mesure de leur compétence et de leur travail remarquables. Modifié, enrichi, parfois abrégé, rarement élagué, le texte entier du Petit Robert a été revu — y compris les parties qui, jugées aujourd’hui encore pertinentes, n’ont pas été touchées. C’est une description plus riche, plus claire encore, plus homogène, que l’on présente au lecteur, sans rupture cependant avec le passé, car le Petit Robert est et doit rester l’héritier d’une tradition où l’Académie française depuis 1694, Furetière, Littré, Pierre Larousse, le Dictionnaire général ont défini les règles du jeu. Au XXe siècle, la tradition du dictionnaire de langue, un moment négligée en France, a été remise en honneur par Paul Robert. Son œuvre, poursuivie par ceux qui furent ses principaux collaborateurs, occupe une place notable dans l’histoire des dictionnaires. L’évolution du français, celle des connaissances sur la langue, celle du monde où vit une communauté francophone variée mais unie par son langage, nécessitent une évolution rapide des dictionnaires, soutenue par les récents progrès techniques : le Nouveau Petit Robert, sans rompre avec le passé du genre, témoigne de son état le plus actuel. La lexicographie de langue française forme une longue chaîne de savoirs а la fois érudits et artisanaux, où s’affirment parfois le génie de la langue française et la richesse spécifique des cultures qu’elle exprime. S’inscrire dans cette tradition suppose une innovation continue et une durable passion impliquant une foi solide dans l’avenir du français. Nous espérons en avoir témoigné dans ce livre.
Josette REY-DEBOVE et Alain REY
Arrivé M., Gadet F., Galmiche M., La grammaire, d’aujourd’hui : guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion, 1992
Français
Le français est l’une des langues romanes (voir latin). Le français est actuellement parlé, à titre de langue maternelle ou de langue seconde utilisée quotidiennement, par près de 80 millions de personnes. Compte tenu de la difficulté de ce type de dénombrement, le français se situe à peu près au dixième rang des langues parlées dans le monde, après le mandarin, l’anglais, l’espagnol, le portugais, le russe, le japonais, l’allemand, à peu près à égalité avec l’arabe, le bengali, l’hindi et l’italien.
Le français a longtemps eu le statut de langue internationale. Il l’a progressivement perdu au profit de l’anglais depuis le début du XXe siècle.
En France, le français est pratiqué par la quasi-totalité des habitants, à la réserve des immigrés récents. Cependant, il existe sur le territoire national un certain nombre de parlers pratiqués par un nombre non négligeable d’usagers, dont la grande majorité ont par ailleurs une bonne connaissance du français. Il convient, parmi eux, de distinguer les parlers non romans et les parlers romans.
1. Parlers non romans
l’alsacien : dialecte germanique proche des parlers de la Suisse alémanique, l’alsacien est pratiqué, parfois exclusivement, par plus d’un million de personnes ;
le breton : langue celtique diversifiée en quatre dialectes, le breton est pratiqué — très rarement à titre exclusif — par près d’un million de sujets ;
le flamand : sensiblement différent des formes de la langue parlée en Hollande et en Belgique, le flamand est utilisé par environ 150 000 personnes ;
le basque : langue non indo-européenne qui s’étend également de l’autre côté de la frontière espagnole, le basque est parlé en France par moins de 100 000 personnes.
2. Parlers romans
Il convient de les répartir dans les classes suivantes :
parlers d’oïl : oïl est l’ancienne forme du mot oui, commune aux états anciens de ces parlers. Depuis le début du xxe siècle, ces parlers, autrefois nettement distincts du français standard, sont, à des degrés divers, en voie de disparition. Il est cependant encore possible, même dans la zone centrale, d’en repérer les traces et d’établir, pour chaque région, un Atlas linguistique et ethnographique.
parlers d’oc : oc est l’équivalent de oui dans ces parlers, séparés des dialectes d’oïl par la ligne figurée sur la carte de la page 272. Également recensés par les Atlas linguistiques, ces parlers sont, notamment par leur système phonologique, plus éloignés du français standard que ne le sont les parlers d’oïl. Ils résistent mieux que ceux-ci à la francisation, et l’on évalue généralement à 7
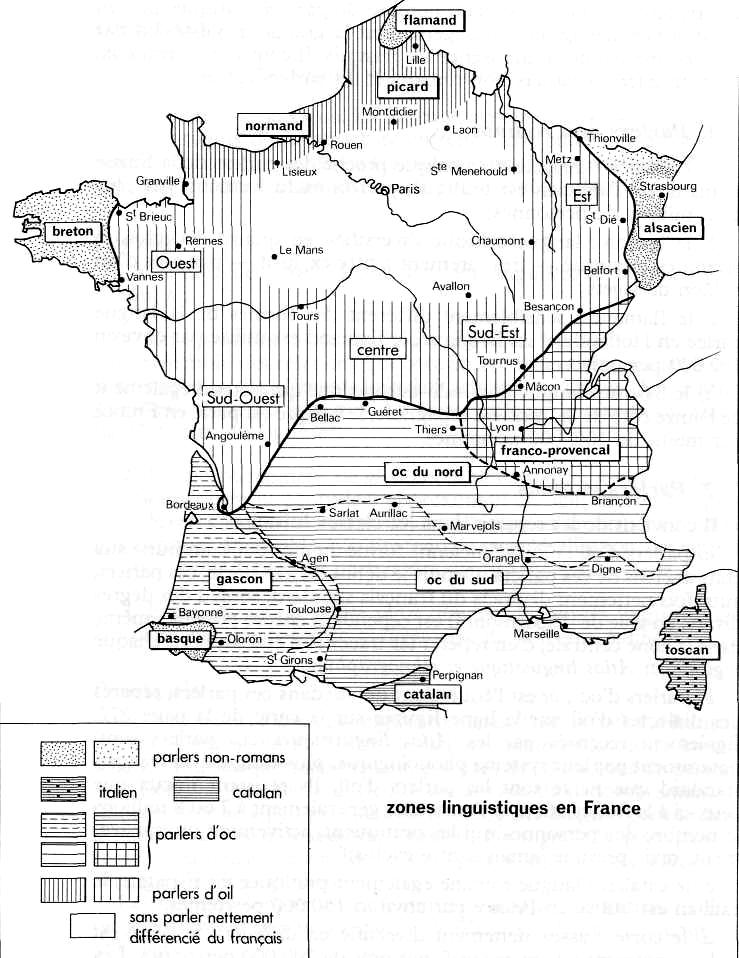 ou
8 millions le
nombre des personnes qui les pratiquent, activement ou passivement,
mais presque jamais à titre exclusif.
ou
8 millions le
nombre des personnes qui les pratiquent, activement ou passivement,
mais presque jamais à titre exclusif.le catalan : langue romane également pratiquée en Espagne, le catalan est utilisé en France par environ 150 000 personnes.
le corse : assez nettement diversifié en dialectes, le corse est utilisé, rarement à titre exclusif, par près de 200 000 personnes. Les parlers corses sont proches des dialectes italiens de Toscane.
En dehors des frontières nationales, le français est parlé dans les pays suivants :
Le français est, avec l’allemand, l’italien et le romanche, l’une des quatre langues nationales de la Confédération helvétique. Il y est parlé par environ 2 millions de personnes ;
En Belgique, le français est la langue maternelle d’environ 4 millions de sujets parlants. Une bonne partie des 370 000 Luxembourgeois ont une connaissance au moins passive du français ;
Le Canada est une nation bilingue. Le français y est la langue maternelle de plus de 6 millions de Canadiens ;
De façon plus ou moins résiduelle, le français est parlé dans le Val d’Aoste, dans les îles Anglo-Normandes et en Louisiane ;
Le français est la langue officielle de la république d’Haïti, dont la plupart des 5 millions d’habitants ont le créole pour langue maternelle. À l’île Maurice, le français est en concurrence non seulement avec le créole local, mais aussi avec l’anglais ;
En Martinique, Guadeloupe, Guyane, Polynésie française, à la Réunion et en Nouvelle-Calédonie, le français, langue de l’administration et de l’enseignement, n’élimine pas la pratique quotidienne des créoles locaux ou des langues locales ;
Le français est la langue officielle d’un certain nombre d’États africains, anciennes colonies françaises. Mais la pratique quotidienne du français y est très variable, et souvent réduite ;
Enfin, dans la plupart des pays étrangers, le français, autrefois appris comme langue seconde de préférence à toute autre, a laissé progressivement la place à l’anglais à peu près partout, à l’espagnol dans les pays anglophones (notamment aux U.S.A.), parfois à l’allemand, au russe et au japonais (notamment en Chine).
Registres de langue
L’hypothèse de l’existence de registres de langue est une abstraction par laquelle les dictionnaires et les grammaires cherchent à rendre compte du continuum de la variation, à la fois stylistique et sociale (voir sociolinguistique).
En termes de norme*, il s’agit de traduire le fait que certains usages sont recommandés, d’autres neutres, et d’autres enfin condamnés par la communauté linguistique. Ce point de vue conduit à traiter les registres en termes d’écart par rapport à un code.
En termes de situation, il s’agit de montrer que les différentes « manières de parler » sont plus ou moins adaptées à une situation : on ne parle pas de la même manière en faisant une conférence ou en discutant avec un ami. Ce second point de vue conduirait donc à définir le français standard en liaison avec une série de situations et de genres, et non à le représenter comme un absolu stable.
En analysant la langue comme un système régulièrement différencié, comme lieu structuré d’homogénéité, on constate que la reconnaissance des registres, conjointement disponibles pour tous les membres adultes de la communauté, est partie intégrante de la maîtrise de sa langue maternelle* par un locuteur. Il peut être incapable de produire un énoncé dans un registre qui ne lui est pas habituel, tout en étant apte à le comprendre et à lui attribuer la signification sociale qui lui est attachée. La variation s’accompagne donc toujours de jugements, une forme jouissant du prestige ou souffrant du discrédit qui s’attachent aux groupes qui les emploient ou aux situations qui les appellent. C’est ce que le rejet fréquent du terme équivalent « niveau de langue », généralement écarté pour ses connotations hiérarchiques implicites, semble oublier trop rapidement : niveau ou registre, la valorisation existe, parce qu’elle existe dans la communauté.
L’opération de désignation des registres part de l’hypothèse selon laquelle il y a homogénéité dans l’emploi, ce qui est à peu près vrai sur le plan lexical, quand il s’agit de caractériser un mot. Ainsi, un dictionnaire* distinguera la plupart du temps les niveaux : « vieux », « classique », « littéraire », « poétique », « familier », « populaire » et « trivial », éventuellement « soutenu », « vulgaire » et « argotique ». Mais si l’on cherche à caractériser les registres non plus au plan de l’usage, mais au niveau du contenu linguistique, et qu’on les définisse comme l’emploi conjoint de constructions syntaxiques particulières, d’éléments lexicaux et de faits de prononciation et d’intonation particuliers, il semble alors difficile d’en isoler plus de trois ou quatre : populaire, familier (mais correct), courant ou moyen, et soigné (soutenu, éventuellement littéraire), tout en tenant compte de la différence (qui ne les recouvre pas) entre oral et écrit. Il semble alors difficile de les caractériser autrement que par différence et par tendances.
Le plan phonétique est le plus révélateur, parce qu’il est le moins accessible à l’intervention consciente du locuteur. On y trouve, en passant du niveau populaire au niveau soigné, une augmentation des traits suivants :
nombre de liaisons* : très peu de liaisons sont réalisées dans le registre populaire et familier ; liaison des mots peu accentués aux mots accentués en conversation soignée ; liaison même entre mots accentués en style oratoire ;
résistance à la neutralisation* des voyelles inaccentuées ;
refus des harmonisations vocaliques (prononciation [RediR] ou [RDdiR] ;
nombre des [B] muets (compte tenu, naturellement, des amuïssements obligatoires ou interdits) ;
refus des assimilations (prononciation [isRaDl] ou [izRaDl]) ;
degré de tension articulatoire (plus ou moins grande netteté des timbres et des articulations) ;
tendance à la relative égalité syllabique ;
refus des régionalismes ;
maintien des groupes consonantiques.
Dans les registres populaire et familier, on trouvera des combinaisons comme [pisk] (puisque), [kekGoz] (quelque chose), [idi] (il dit), [suRtu] (surtout), [Fjedi] (je lui ai dit), [kattab] (quatre tables)... Les registres familier et courant sont à mi-chemin entre tendances conservatrice et transformatrice. Ainsi, il y a des raisons pour qu’un mot comme essayer se prononce [esDje] (tendance conservatrice) : le rapport à essai, et la pression de la graphie. Mais il y en a aussi pour qu’il se prononce [eseje] (tendance transformatrice) : la position syllabique du [e], et l’influence dilatrice du [e] final.
Les registres s’opposent aussi par la mélodie, les pauses et les hésitations ; pour celles-ci, c’est plutôt leur nature que leur fréquence qui est pertinente : il relèverait d’une conception simpliste de l’oral de supposer qu’un oral soutenu (sauf lecture orale) en serait exempt : des mots d’appui comme euh, bien, donc, bon... se trouvent à tous les registres. Par contre, la fréquence des changements intonatifs, due surtout aux accents d’insistance, est, quant à elle, caractéristique du registre familier.
La possibilité de variation est liée au caractère facultatif d’un élément. Aussi le plan lexical permet-il facilement la distinction des registres, avec des « synonymes » comme par exemple soufflet (littéraire), gifle (courant), claque (familier), baffe ou torgniole (populaire), encore qu’il n’y ait pas toujours une telle richesse d’équivalents. Mais il n’en est pas de même au plan syntaxique, où la notion de choix se fait plus restreinte. Tout au plus peut-on indiquer quelques phénomènes : l’existence de formes propres à l’usage populaire (par exemple, la relative de français populaire, comme l’homme que je te parle, ou certaines interrogations comme quand c’est ti qu’i vient ?) ; la plus ou moins grande fréquence d’emploi de formes, comme les constructions segmentées (moi, ma mère, la télé, elle aime pas).
La caractérisation de la variation en termes de registres appelle plusieurs commentaires :
rien n’est jamais désigné comme normal ou comme standard : on ne dit que l’écart.
les désignations retenues visent des phénomènes de nature différente : par exemple, « populaire » désigne une classe sociale, et « familier » une situation. De même pour le rapport entre variété sociale et variété régionale : ce qu’on appelle français populaire n’est pas parlé par le peuple partout en France, c’est une variété originellement liée à la région de Paris et de l’île-de-France, ayant donc son origine géographiquement commune avec le français standard.
il y a souvent désaccord, dans les caractérisations d’un mot, d’un dictionnaire à l’autre, et encore plus d’un locuteur à l’autre.
Le clivage entre les registres peut être d’ordre exclusivement lexical (par exemple entre langue courante et argot*), ou complet, (entre français populaire et français cultivé). On peut donc donner un statut particulier aux « langues spéciales », et principalement à l’argot.
La difficulté qu’il y a à cerner et à décrire les différents registres et à les homogénéiser justifie le choix grammatical fondamental de ne décrire que la seule langue standard.
Delbecque N. (éd.), Linguistique cognitive : comprendre comment fonctionne le langage, Bruxelles, De Boeck, Duculot, 2002
La classification et l’étude comparée des langues
Dans le chapitre 6 portant sur la sémantique interculturelle, nous avons étudié certaines similitudes et divergences dans les lexiques, grammaires et scripts culturels de diverses communautés linguistiques. Dans le présent chapitre, nous examinerons les classifications qui peuvent être faites des langues selon différents types de critères : le point de vue adopté peut être sociologique, génétique, typologique ou contrastif. Dans un premier temps, les langues peuvent être classées sur base de critères sociologiques externes à celles-ci, tels que leur statut et importance dans le monde. Ce genre d’étude comparée va de pair avec la question de savoir quelles sont l’origine et l’évolution des langues. D’autre part, il est également possible de les comparer à partir de caractéristiques structurelles internes aux langues. Bon nombre de langues sont génétiquement apparentées les unes aux autres ; elles forment des familles de langues. Néanmoins, des langues sans lien génétique peuvent également être regroupées à partir de certaines caractéristiques structurelles. La recherche typologique utilise comme critères les caractéristiques structurelles saillantes d’une langue – l’ordre des mots par exemple – dans le but de procéder à des regroupements typologiques entre les langues. À la question de savoir s’il existe des éléments universaux – tels les "primitifs sémantiques universaux" du chapitre 6 –, la réponse est positive, sur base de la théorie du prototype. Il est également possible de comparer de façon détaillée les caractéristiques structurelles ou "champs conceptuels" de deux langues. Ceci est le domaine de la linguistique comparée. Plus orientée vers la pratique, elle met l’analyse de la structure et du fonctionnement des langues au service de l’apprentissage des langues, de la traduction et de la confection de dictionnaires bilingues.
10.1 L’identification et le statut des langues
L’identification des langues se heurte à plusieurs difficultés (10.1.1). Du point de vue linguistique, le passage d’une langue à l’autre s’avère être graduel tant sur l’axe géographique que sur l’axe historique, et la délimitation de leur extension fluctue en fonction des critères utilisés (10.1.2). Du point de vue sociologique, le statut des langues se définit en termes politiques, institutionnels et démographiques (10.1.3).
10.1.1 Inventaire et délimitation des langues
à l’heure actuelle, il n’est toujours pas possible de fixer le nombre exact des langues parlées dans le monde. Certaines sources parlent de 5 000 langues, d’autres avancent le chiffre de 6 000. Les estimations variant à ce point, on est en droit de se demander pourquoi les linguistes ne parviennent pas à dresser l’inventaire des langues. Il semble qu’il y ait plusieurs raisons à cela.
Tout d’abord, nous manquons encore d’information quant aux langues parlées dans certaines régions du monde. En effet, il s’avère que certains territoires africains et australiens n’ont été que très peu explorés à cet effet. Remarquons entre parenthèses qu’une recherche sur le terrain requiert beaucoup de temps, de moyens financiers et de savoir-faire. De récents sondages font apparaître que dans certaines de ces régions, il reste un très grand nombre de langues à répertorier. Ainsi, Comrie (1987) annonce qu’à cet égard, et contre toute attente, la Nouvelle-Guinée s’avère être extrêmement digne d’intérêt : pas moins d’un cinquième de l’ensemble des langues parlées dans le monde y seraient localisées. Il se peut même que cette proportion soit à revoir à la hausse, dans la mesure où une partie des langues de cette île n’a pas encore pu être identifiée. Cette dernière observation vaut également pour bon nombre de langues parlées en Australie et en Afrique.
Une deuxième raison de l’imprécision est qu’il subsiste toujours un doute quant à la délimitation des langues : pour deux variétés linguistiques se trouvant dans le prolongement ou dans la proximité l’une de l’autre, il n’est souvent pas aisé de déterminer s’il s’agit de deux langues différentes ou seulement de dialectes appartenant à une seule langue. Même en Europe, où ce genre d’incertitude a pour ainsi dire disparu, le statut accordé à une variété linguistique – langue autonome ou dialecte – est autant le résultat de considérations politiques que de classifications linguistiques.
10.1.2 Critères linguistiques pour la reconnaissance des langues
Le critère le plus fréquemment utilisé pour reconnaître une langue est celui de l’intelligibilité réciproque. Lorsque deux interlocuteurs se comprennent mutuellement, on en conclura qu’ils parlent des dialectes de la même langue. Dans le cas contraire, s’ils ne se comprennent pas, on considérera qu’ils parlent chacun une langue différente. La réalité est cependant plus complexe et parfois paradoxale, même dans des régions d’Europe qui nous sont familières. La raison en est que la reconnaissance officielle d’une langue par l’État a pour corollaire l’établissement de frontières linguistiques officielles, fixées constitutionnellement. Dès lors, il est fait abstraction de certaines réalités du terrain. Dans des territoires étendus, tels l’Allemagne et l’Italie, les dialectes parlés par les habitants du nord sont pratiquement incompréhensibles pour les habitants du sud du pays, et vice versa. Il est bien connu que les Italiens de la région des Alpes ont besoin de sous-titres pour comprendre les dialogues de films mettant en scène la mafia sicilienne. L’intercompréhension n’est même pas garantie à l’intérieur d’une région comme la Flandre : les Ouest-Flamands ont beaucoup de mal à comprendre les Limbourgeois, et vice versa. En revanche, ces derniers comprennent mieux l’allemand que l’ostendais ou le brugeois. En effet, dans la zone frontalière entre l’Allemagne d’une part, et la Flandre et les Pays-Bas d’autre part, les habitants peuvent facilement se comprendre entre eux, bien qu’ils aient pour langue officielle respectivement l’allemand et le néerlandais. De leur côté, les langues Scandinaves présentent elles aussi un indice non négligeable de compréhension mutuelle. Il semble donc que la compréhension mutuelle concerne généralement des dialectes très proches les uns des autres, qu’ils appartiennent ou non à la même langue officielle.
Il existe un autre problème concernant l’intelligibilité. La compréhension d’une langue ou d’un dialecte n’est pas une question de tout ou rien. Le degré de compréhension varie en fonction de facteurs tels la familiarité, la régularité du contact et la volonté de comprendre. Il arrive aussi que seul un des deux locuteurs comprenne la langue de l’autre.
Le problème de la compréhension mutuelle et celui des frontières linguistiques et dialectales se pose en termes de continuum dialectal. Ce concept permet de rendre compte de la compréhension mutuelle qui existe entre dialectes voisins ressortissant à des langues officielles différentes au sein de la même famille linguistique. D’autre part, le concept de continuum dialectal éclaire également le fait qu’il ne suffit pas que deux dialectes appartiennent à la même langue pour que la communication soit assurée. Plus la distance entre les dialectes est grande, plus la compréhension mutuelle sera problématique. Il n’en est pas moins vrai que tous les dialectes d’un groupe ou famille de langues forment ce qu’on appelle un continuum. Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, le continuum dialectal germanique va du Tyrol à la mer du Nord, du côté ouest, et à la mer Baltique, du côté nord.
Tableau 10.1 Quelques réalisations d’énoncés équivalents à
Comment allez-vous ?
|
(sub)standard écrit |
réalisation phonétique |
bavarois |
wia geht s da jetzat ? |
via gD:ts da jetsat |
allemand standard |
wie geht’s dir jetzt ? |
vi: ge:ts dia jDtst |
bas-allemand |
wo geit di dat nu ? |
vo: gait di dat nu: |
néerlandais |
hoe gaat het met u ? |
hu: xa:t hBt mDt y |
danois |
hvordan har du det nu ? |
voadan ha: du de: nu: |
norvégien |
hvordan har du det no ? |
vurdan har dy de: no: |
À côté du continuum géographique, il existe également un continuum historique. À travers toutes les transformations que peut subir une langue, au point de donner naissance à d’autres langues, nombre de caractéristiques communes peuvent être préservées. Alors que certaines langues disparaissent de la carte – et deviennent des "langues mortes" –, de nouvelles langues surgissent à différents stades de l’histoire. Ce fut le cas du latin : les nombreuses variétés du latin (populaire) se propagèrent dans toute la zone de l’Europe allant de la Roumanie à l’Italie, et de l’Espagne jusqu’au nord de la France. On y assista à l’éclosion et au développement de langues indépendantes : le roumain, le sarde, l’italien et le rhéto-roman dans l’axe est-ouest, et l’espagnol, le portugais, le catalan, le provençal et le français, dans l’axe nord-sud.
Conventionnellement, on considère qu’une langue est morte lorsqu’elle n’est plus du tout parlée au quotidien. Toutefois, la mort d’une langue n’a pas lieu du jour au lendemain. Elle ne coïncide pas avec le décès du dernier locuteur de cette langue. La plupart du temps, une communauté linguistique connaît une période de transition au cours de laquelle ses membres abandonnent progressivement leur ancienne langue pour en utiliser une autre. Ainsi, il est possible que durant cette période transitoire l’ancienne langue reste encore vivante chez les aînés et qu’une partie de la communauté en garde la compétence (latente), alors même que la nouvelle langue est déjà communément employée.
Une autre question fondamentale se pose ici : comment peut-on constater la genèse d’une nouvelle langue si celle-ci ne se développe que progressivement à partir d’une variété d’une langue existante ? Là-dessus, les positions adoptées ne sont pas toujours consistantes. En effet, pour les langues romanes, nous avons l’habitude de dire qu’elles sont issues du latin. L’histoire retrace l’émergence de plusieurs langues différentes à partir de ce qu’il est convenu de considérer comme une seule langue. Or, pour le grec, qui a connu une tradition beaucoup plus longue que le latin, nous continuons à ne parler que d’une seule langue hellénique, nous contentant de distinguer entre le grec classique et le grec moderne, appelé aussi plus techniquement dhemotikè ‘langue du peuple’. Cette différence de traitement se justifie dans la mesure où, contrairement au latin, le grec n’a pas subi l’influence de différents substrats (voir chapitre 9.2) et que jusqu’à ce jour l’on hésite entre deux normes, la katharévousa, "l’épurée", plus proche de la forme classique, et la démotique, ou populaire, plus proche de la réalité parlée.
Comme nous pouvons le constater, il est très difficile – même pour les linguistes – d’identifier et de dénombrer avec exactitude les langues actuellement parlées dans le monde. Il reste à collecter des données supplémentaires et à affiner les critères pour arriver à un inventaire sur lequel tout le monde puisse être d’accord. Nous verrons dans la suite que la définition de ce qu’est une langue – et la classification des langues qui en résulte – est étroitement liée aux résultats et aux progrès de la sociolinguistique et des recherches en diachronie (concernant l’évolution des faits linguistiques dans le temps).
10.1.3 Le statut politique et international d’une langue
Au 16e siècle, une nouvelle conception de l’État se fit jour sous le règne de monarques puissants tels que Henri VIII, François I, Charles Quint ou encore Philippe II. Dans le façonnement de ce nouveau concept de l’État, la langue et la religion étaient appelées à jouer un rôle de tout premier ordre. Le slogan "un royaume, une langue, une religion" en reflète bien l’idée centrale.
Vu l’enjeu public et politique, il est clair que la décision de savoir quelle langue sera reconnue comme langue nationale et officielle dépend avant tout des autorités politiques, assistées ou non d’experts en linguistique. La définition linguistique d’une langue est une chose, la définition sociologique et politique en est généralement une autre. La situation du serbo-croate est révélatrice à cet égard. Bien que l’on parle cette langue tant en Serbie qu’en Croatie, l’alphabet usité est différent : en Serbie l’on se sert du cyrillique, en Croatie de l’alphabet latin. D’un point de vue linguistique il s’agit d’une seule langue, mais politiquement parlant, l’on en compte deux.
Un pays peut avoir intérêt à ne reconnaître qu’une seule langue officielle. Cela a été le fondement de la politique linguistique française, déjà du temps des colonies. D’autres pays que la France ont préféré officialiser plusieurs langues : ainsi, la Grande-Bretagne reconnaît l’anglais et le gallois, l’Espagne l’espagnol, le catalan, la galicien et le basque, la Belgique le français, le néerlandais et l’allemand, la Suisse le français, l’allemand, l’italien et le rhéto-roman. Il arrive même qu’un pays accorde le statut de langue officielle à un parler que les pays étrangers considèrent comme étant un dialecte. Dans le contexte européen, c’est le cas du luxembourgeois – langue parlée au Luxembourg – que certains linguistes définissent comme étant un dialecte de l’allemand. Néanmoins, contrairement aux dialectes allemands, le luxembourgeois possède une riche tradition littéraire. Qui plus est, ce parler est largement utilisé dans les médias tels les journaux, la radio et la télévision. Par conséquent, on ne peut pas assimiler son statut à celui des autres dialectes de l’allemand. Quoi qu’il en soit, promouvoir cette langue au rang de troisième langue officielle du Luxembourg – l’inscrivant ainsi parmi les langues officielles de l’Union Européenne – reste une décision politique.
En Malaisie, on utilise plusieurs variétés dialectales dérivées du malais bazaar pour communiquer dans la vie de tous les jours, mais le premier rang est réservé à la langue officielle qu’est le malais standard. En Indonésie, bien avant l’indépendance, les politiciens ont écarté l’idée d’adopter comme langue officielle une des langues nationales. Au lieu de favoriser le javanais, qui est utilisé par plus de 70 millions de personnes, ils optèrent pour une variété standard du malais, adaptée à l’Indonésie. Actuellement, elle est connue sous le nom d’indonésien bahasa ou malais indonésien.
Le statut de langue officielle n’est en aucun cas synonyme de prééminence typologique ou statistique. Or, comme l’octroi de ce statut en implique l’emploi systématique dans la fonction publique, il favorise à la longue l’instauration de règles et l’enrichissement lexical dans les domaines relevant de l’usage institutionnalisé tels l’administration, l’éducation, l’armée, la justice, etc. Dans de nombreux pays où des minorités jouissent d’une certaine autonomie, il existe des lois linguistiques. Celles-ci déterminent de façon précise quelle langue doit être utilisée en quelle occasion. Pareille spécification reflète souvent l’existence d’une gradation. Pensons notamment à la situation du gallois à côté de l’anglais au pays de Galles. Quand il existe plusieurs langues officielles, on assiste généralement à une sorte de répartition des rôles : au Luxembourg, le français reste la langue administrative (écrite), l’allemand la langue des médias, et le luxembourgeois s’est vu élever de langue véhiculaire ordinaire à langue parlée officielle.
L’importance d’une langue ne dépend pas seulement de son statut officiel, mais également du nombre de locuteurs. Pour déterminer quelles langues sont actuellement les plus utilisées dans le monde, il existe plusieurs critères. Si l’on prend comme critère uniquement le nombre d’utilisateurs d’une même langue, les langues asiatiques arrivent en tête de classement, comme le montre le tableau 2 :
Tableau 10.2 Les langues les plus parlées au monde (en millions de locuteurs, natifs et autres), d’après Grimes 1996
le chinois mandarin |
885 |
le portugais |
175 |
l’anglais |
450 |
le russe |
160 |
l’espagnol |
366 |
l’arabe |
139 |
le hindi/ urdu |
233 |
le japonais |
126 |
le malais indonésien |
193 |
le français |
122 |
le bengali / assam |
181 |
l’allemand |
118 |
En revanche, si, en plus du nombre d’utilisateurs, on considère d’autres critères comme par exemple le nombre de pays où la langue
Tableau 10.3 Les langues les plus "internationales" du monde
Langue |
locuteurs natifs |
pays où elle est officielle |
continents où elle est parlée |
PNB en millions de US $ dans les pays clés |
|
anglais |
300 |
47 |
5 |
1,069 |
Royaume-Uni |
français |
68 |
30 |
3 |
1,355 |
France |
arabe |
139 |
21 |
2 |
38 |
RAU |
espagnol |
266 |
20 |
3 |
525 |
Espagne |
portugais |
175 |
7 |
3 |
92 |
Portugal |
allemand |
118 |
5 |
1 |
2,075 |
Allemagne |
malais |
193 |
4 |
1 |
167 |
Indonésie |
en question jouit du statut de langue officielle, le nombre de continents où cette langue est utilisée, ou encore la puissance économique des utilisateurs, on obtient un tout autre résultat, comme l’indique le tableau 3.
L’anglais arrive loin en tête tant par le nombre de locuteurs natifs que par le nombre de pays où il a le statut de langue officielle et par sa répartition sur l’ensemble des continents. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que l’anglais soit devenu la langue "mondiale" par excellence.
Aussi importants que soient ces faits sociologiques, ils sont exclusivement basés sur des critères de comparaison externe. Dans la section suivante, nous abordons des critères d’ordre structurel interne.
